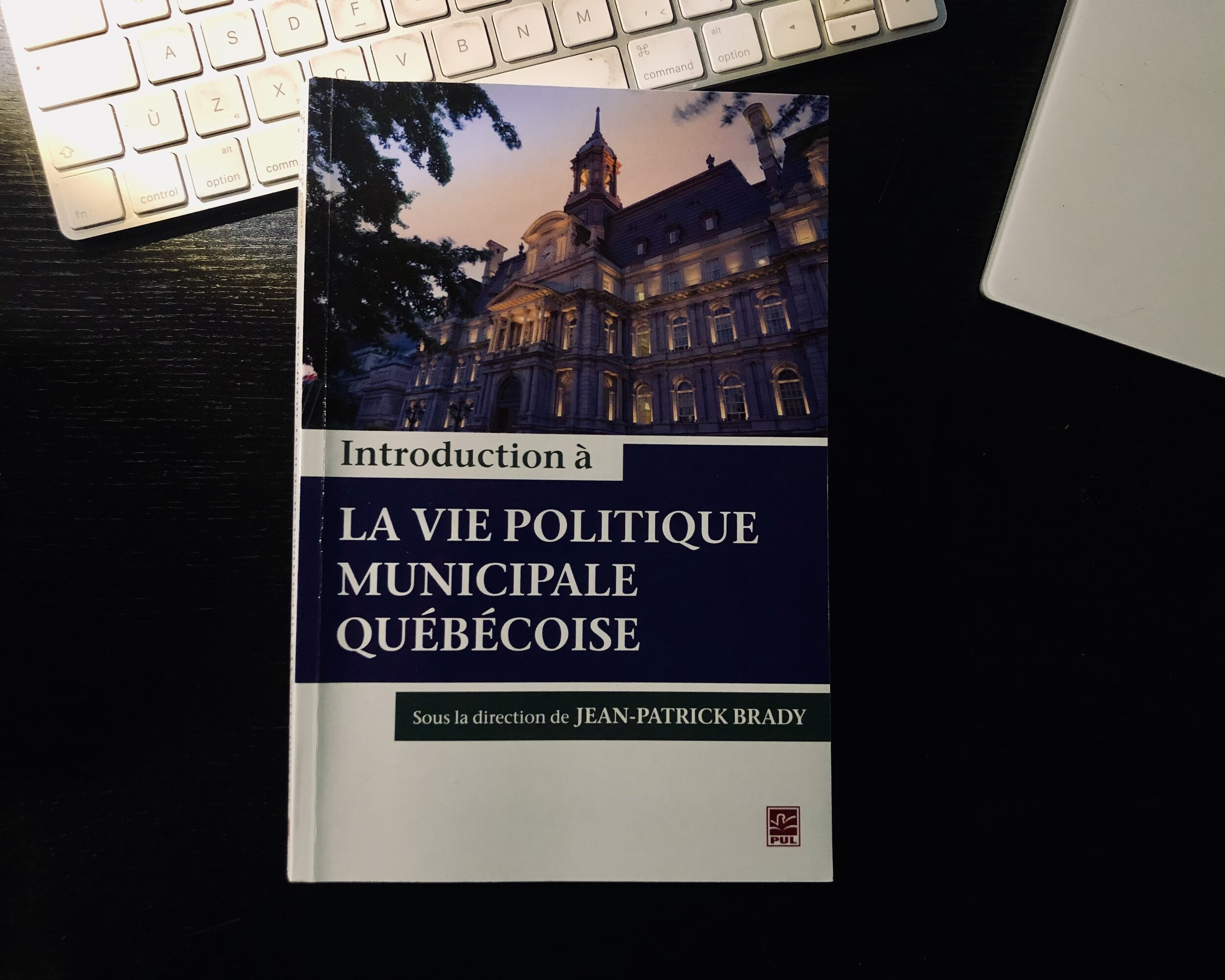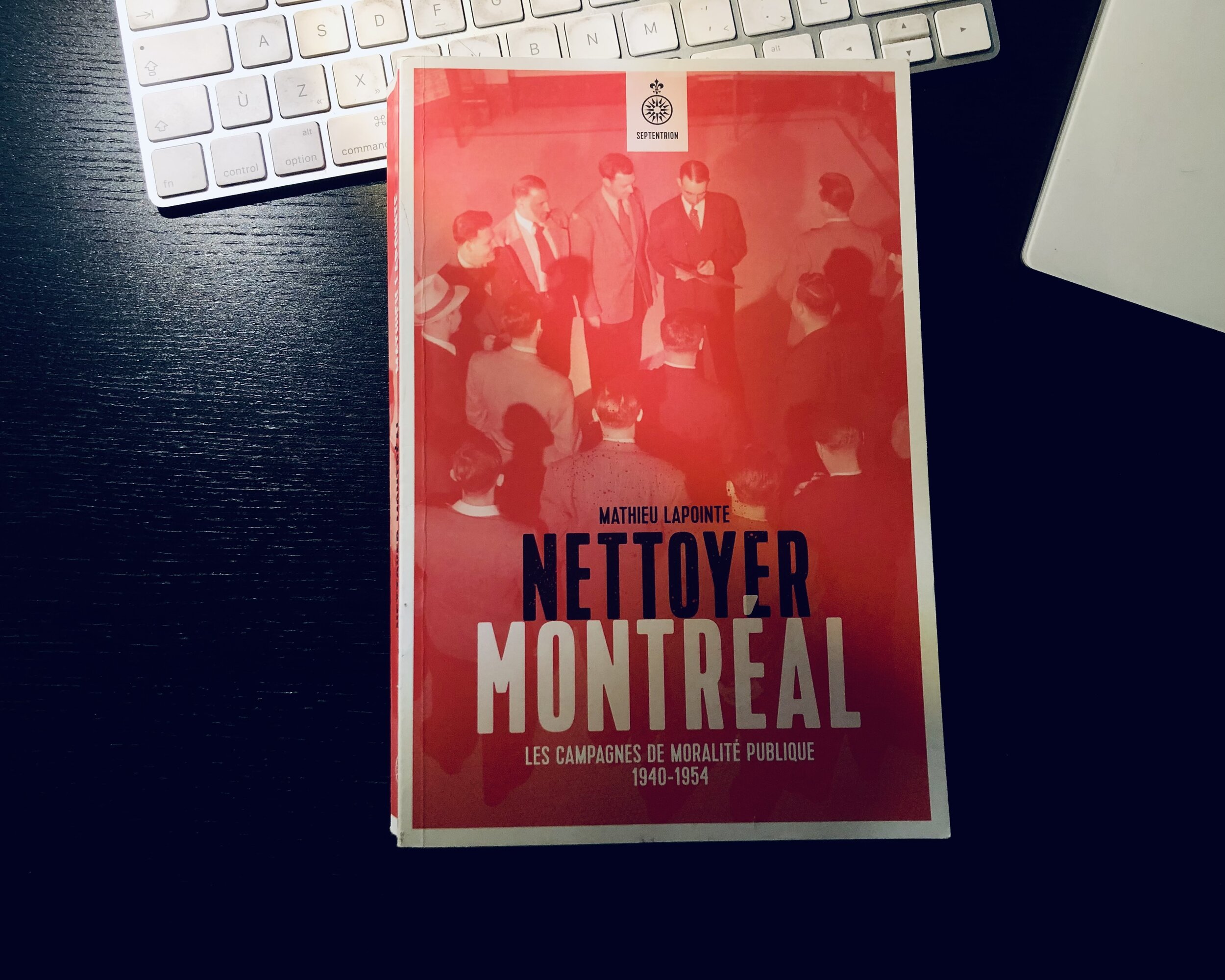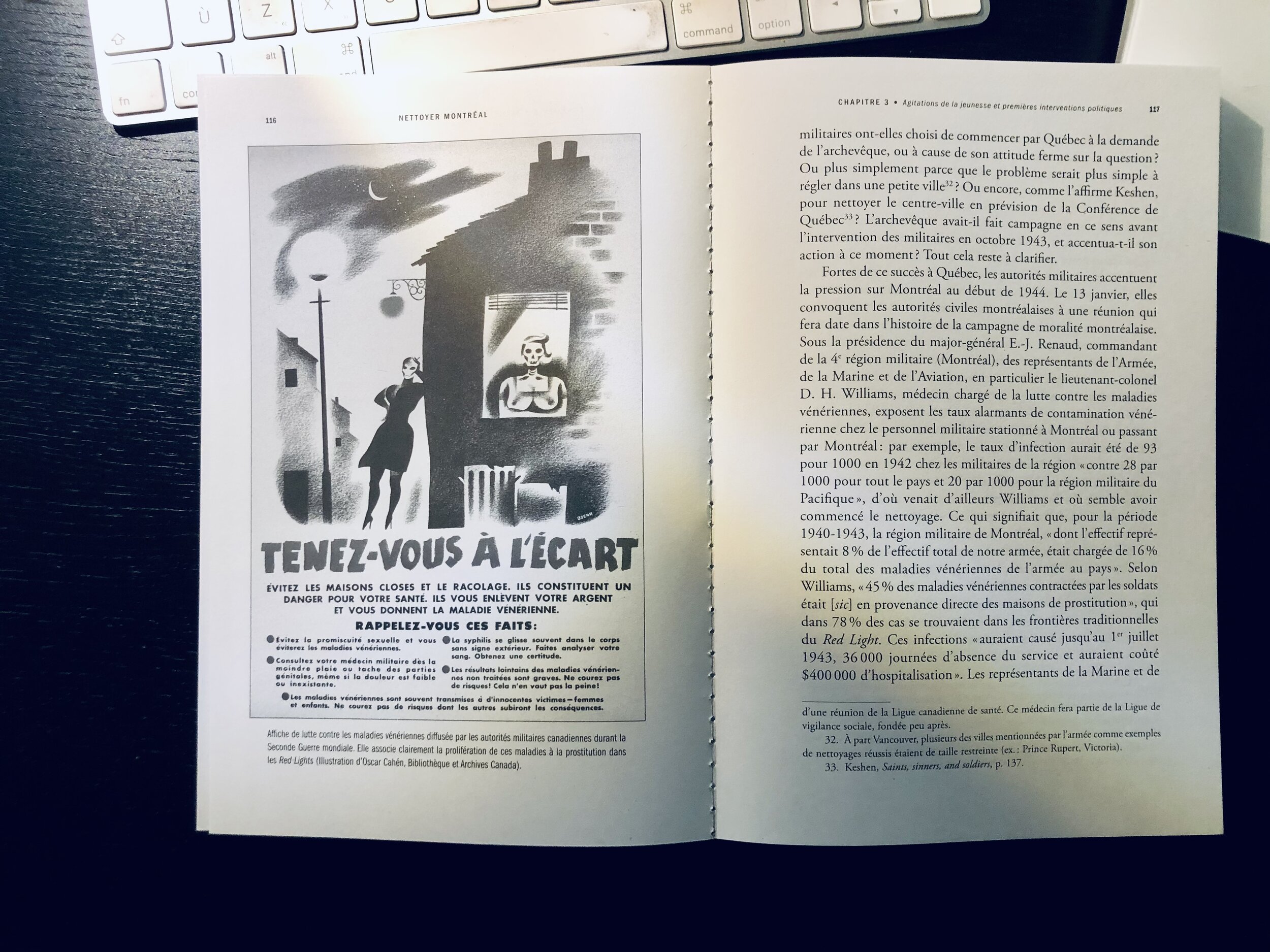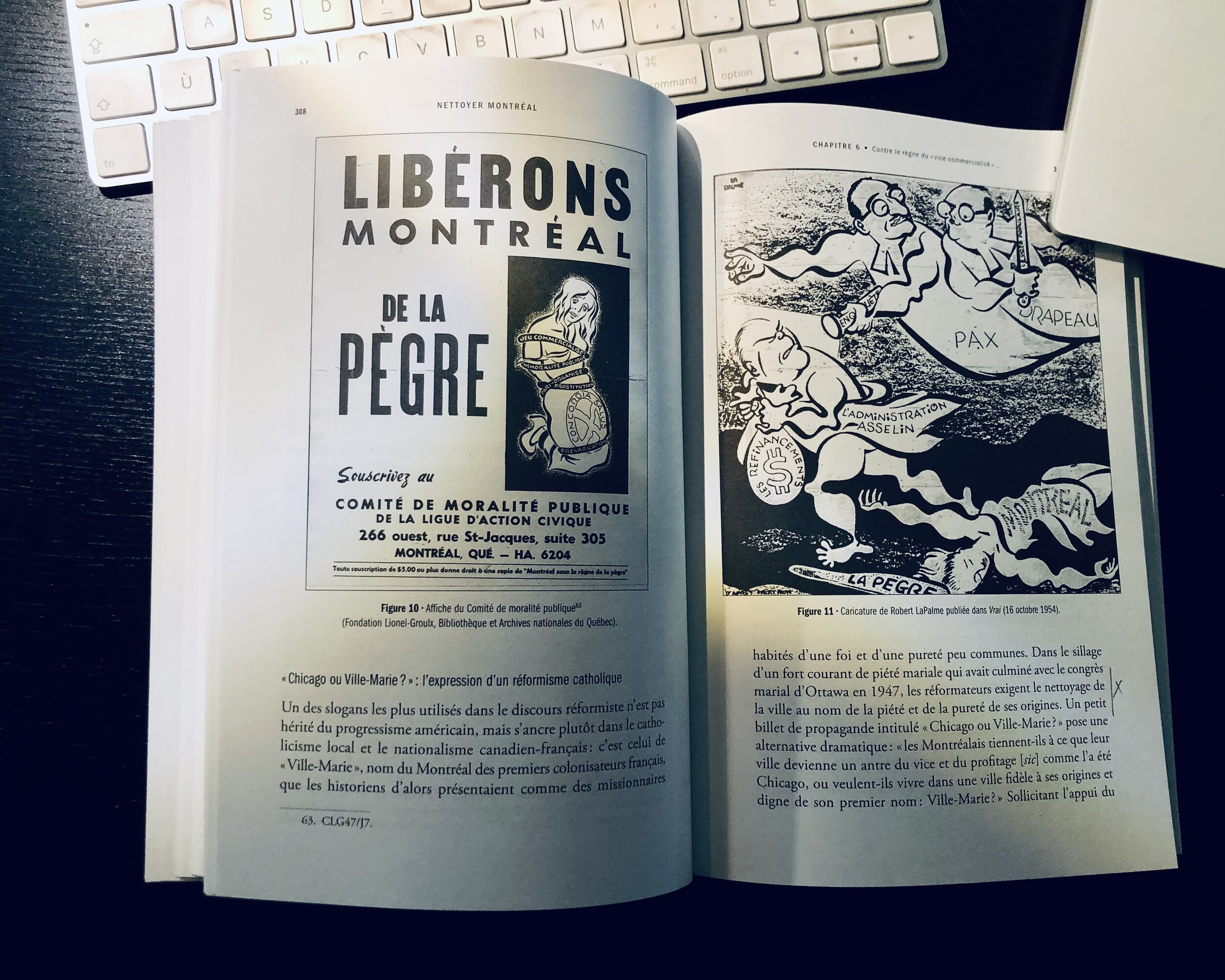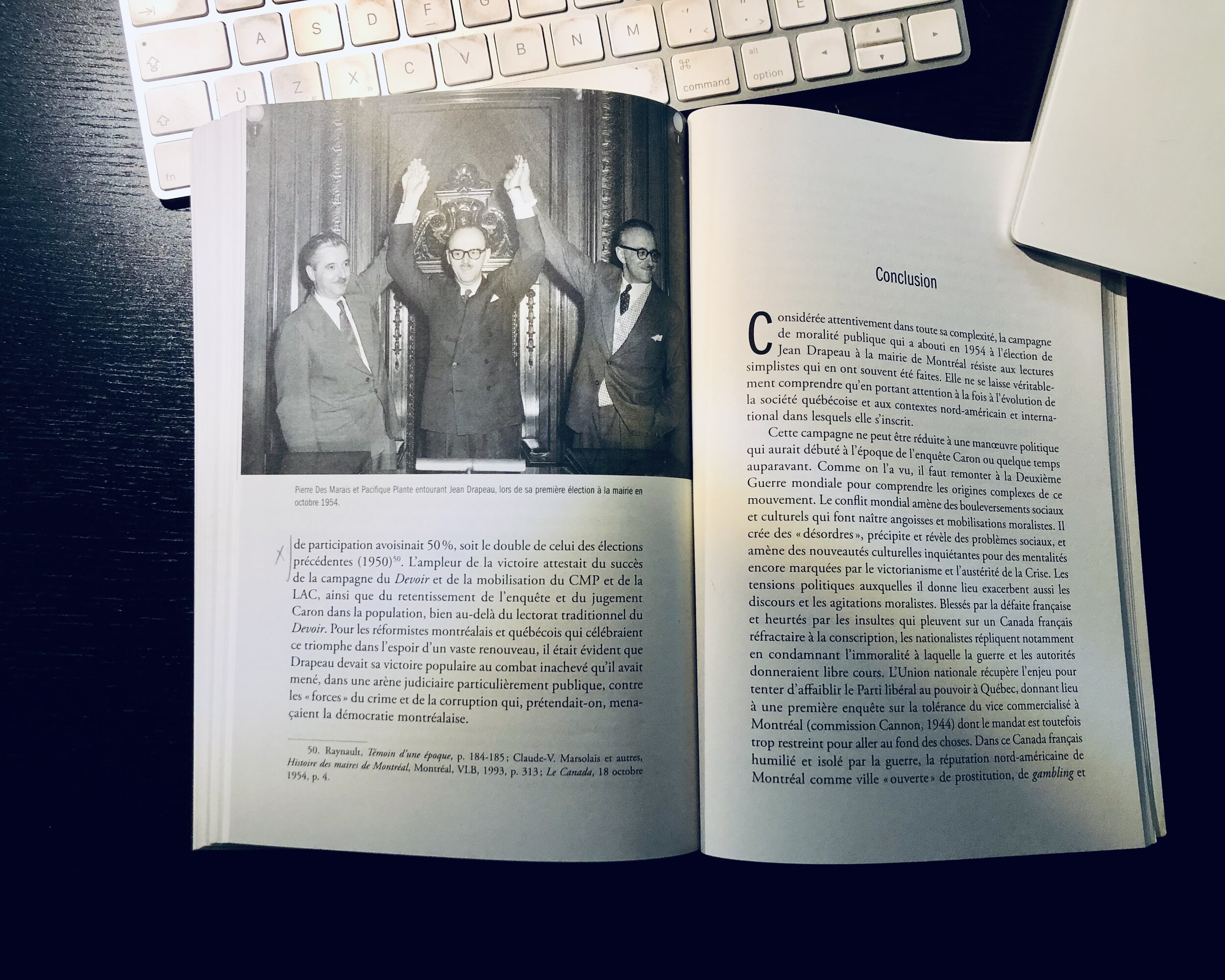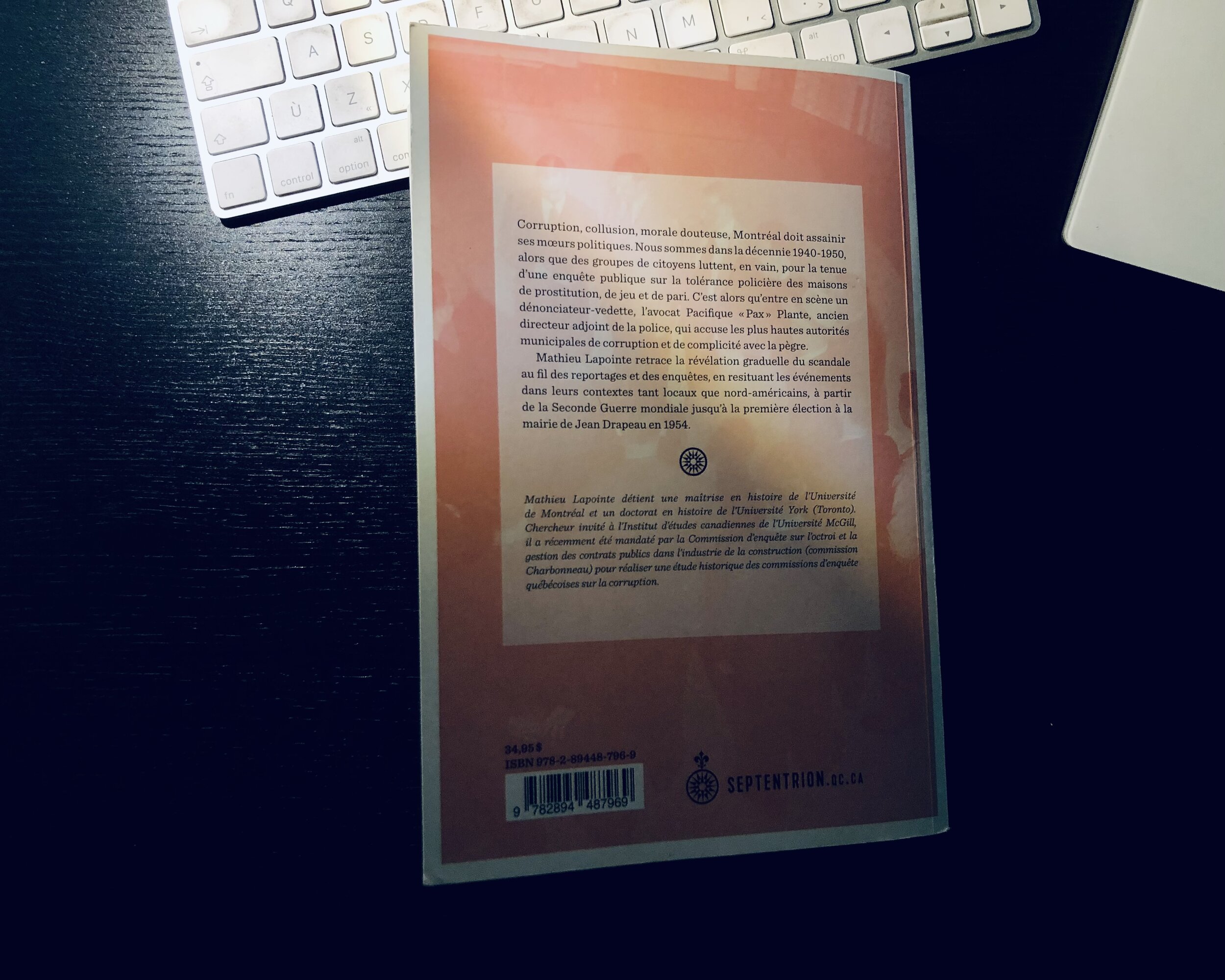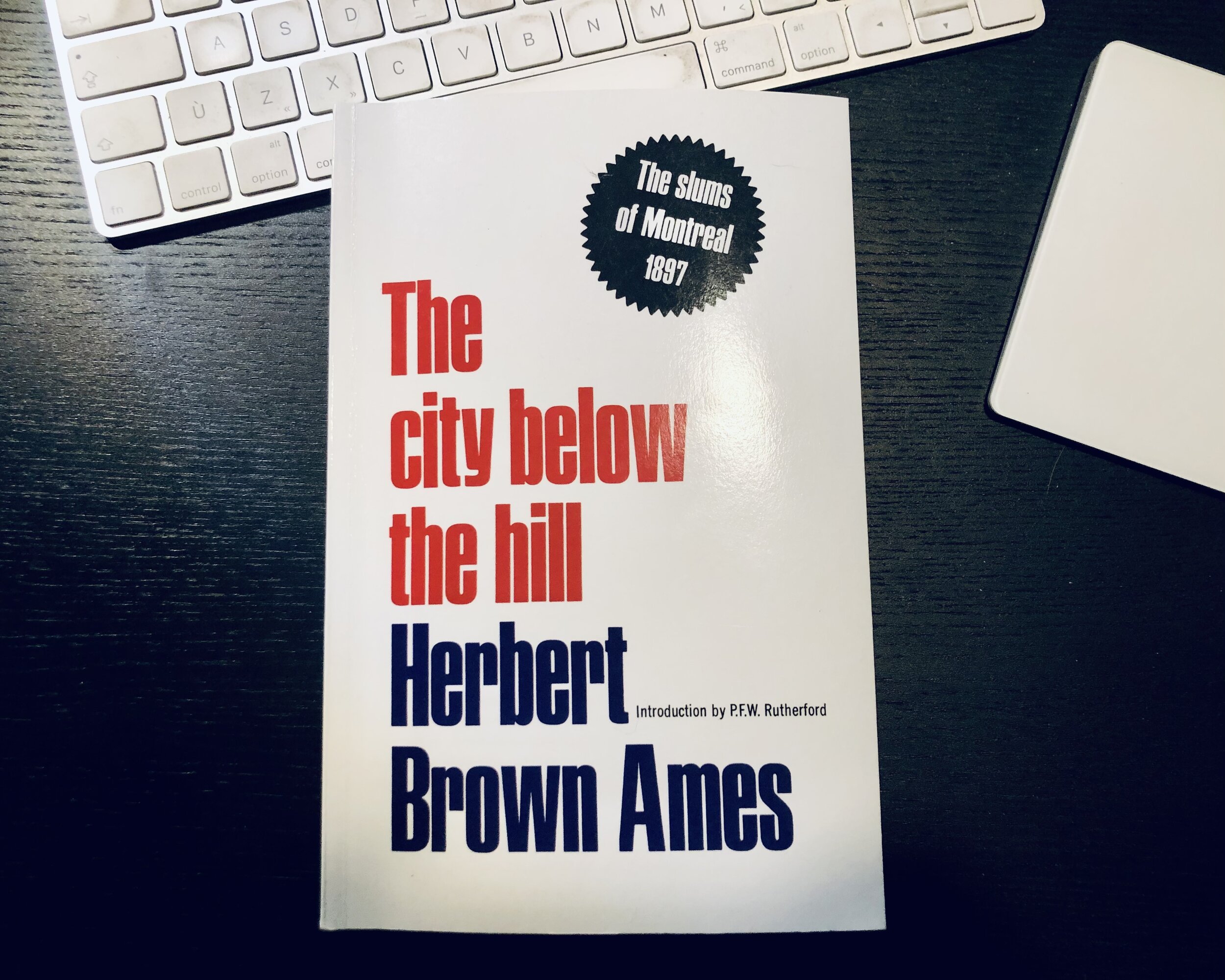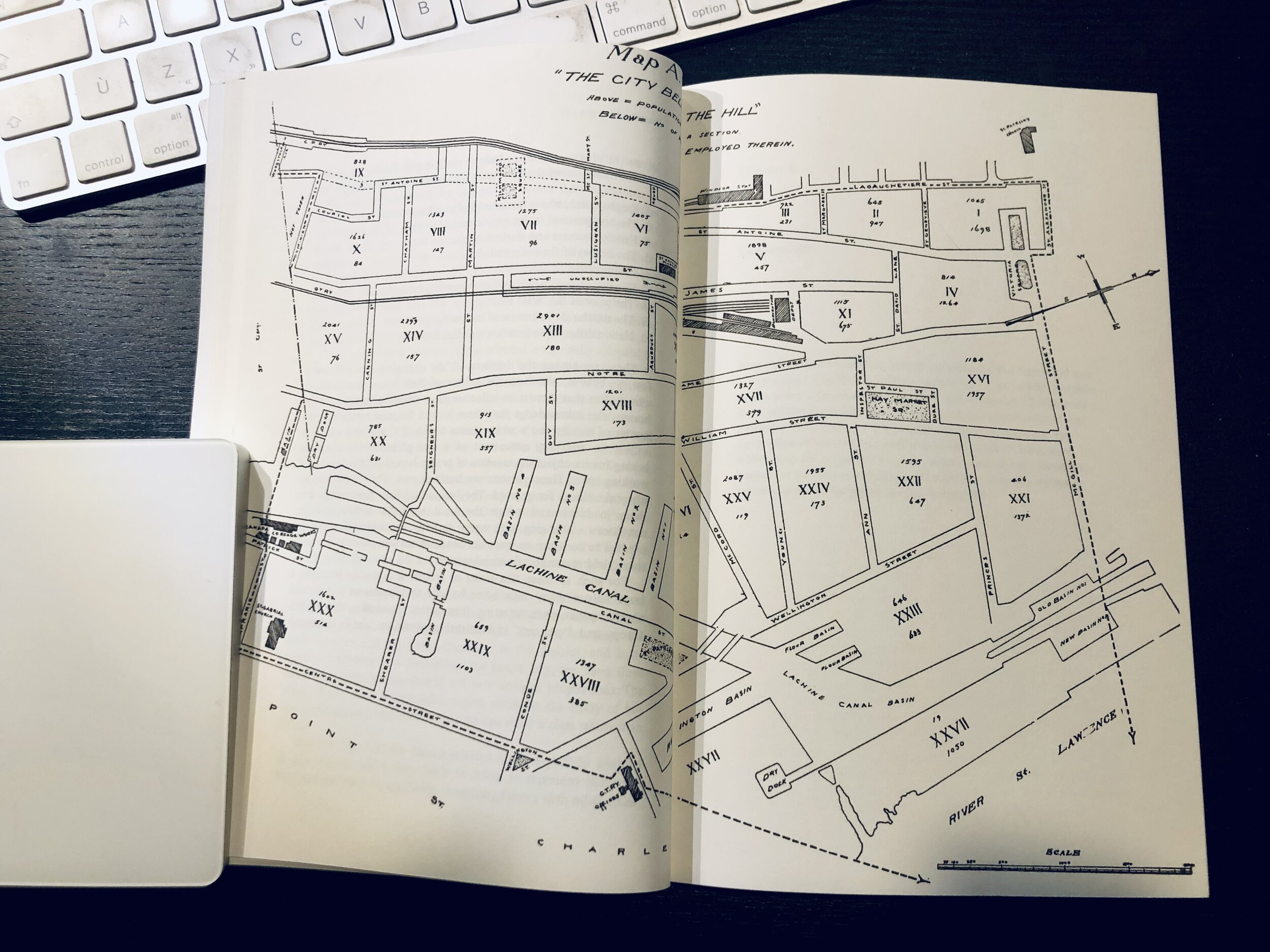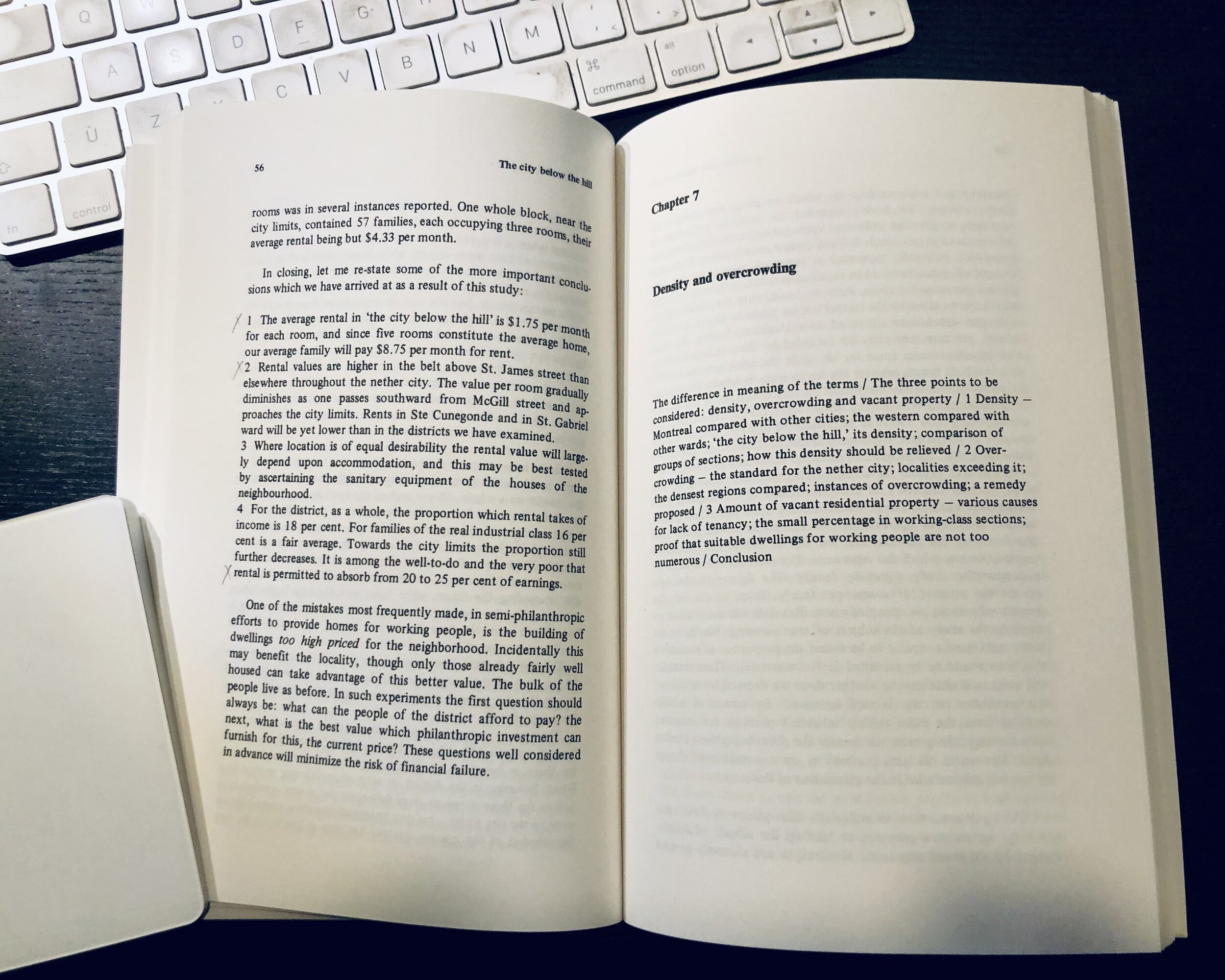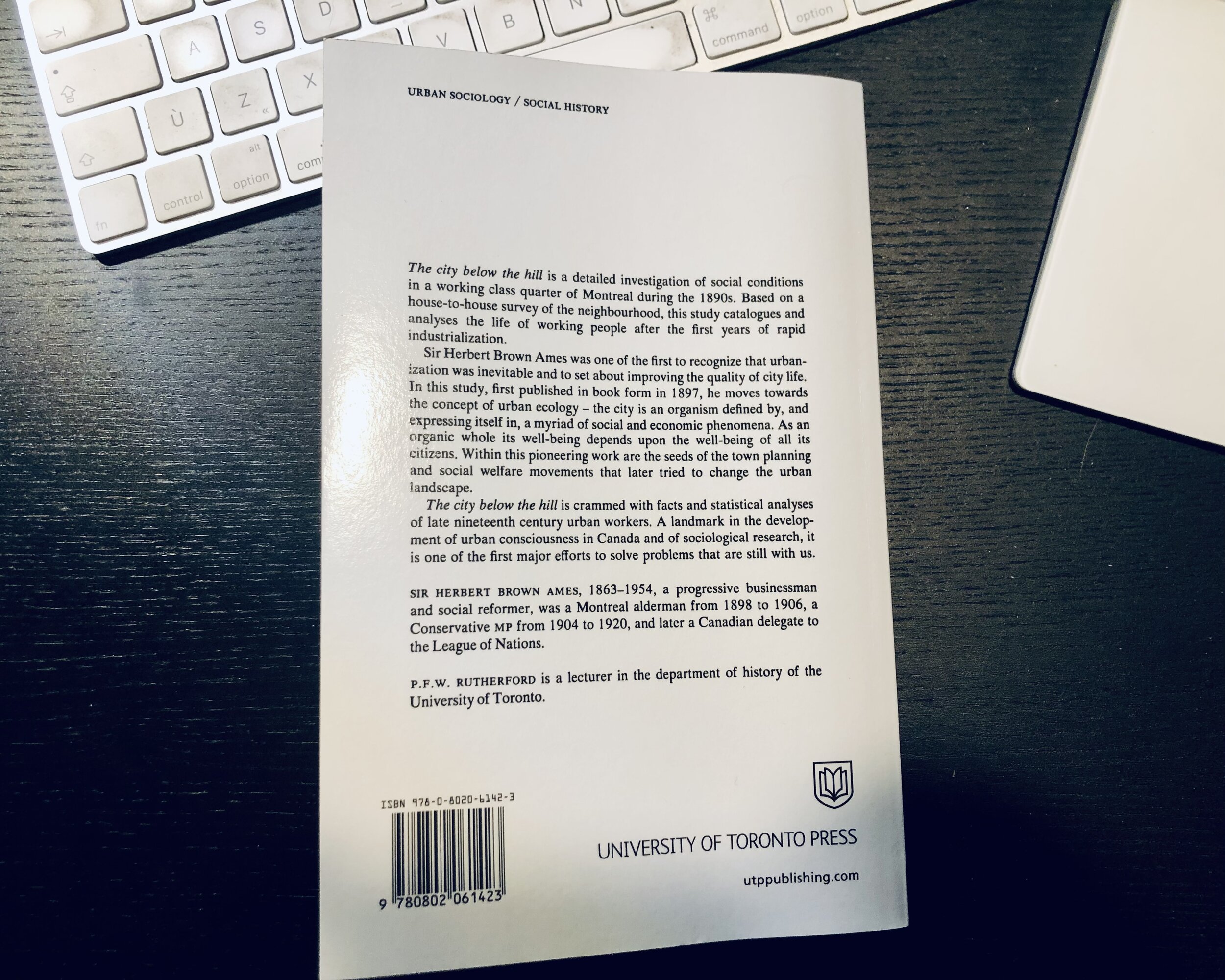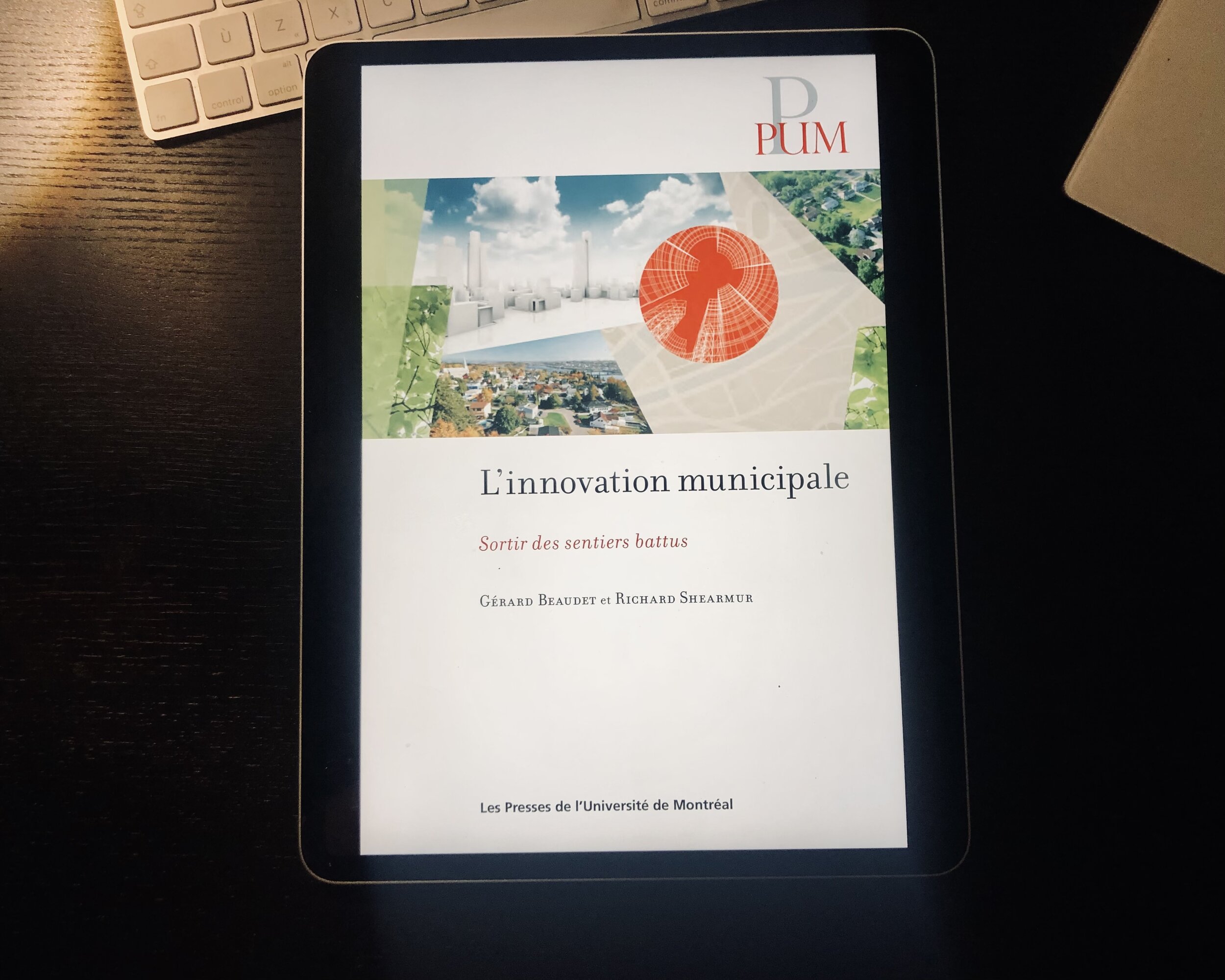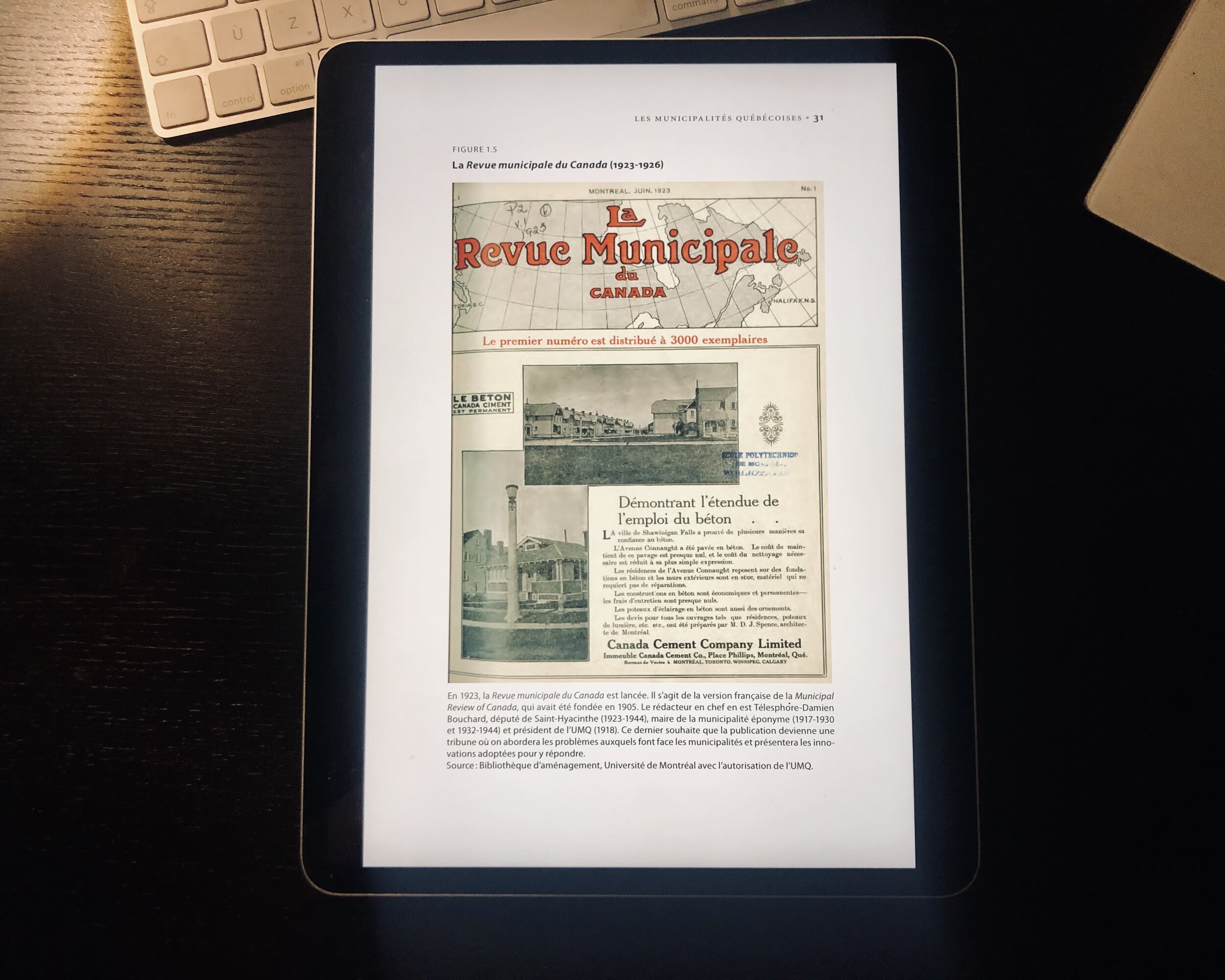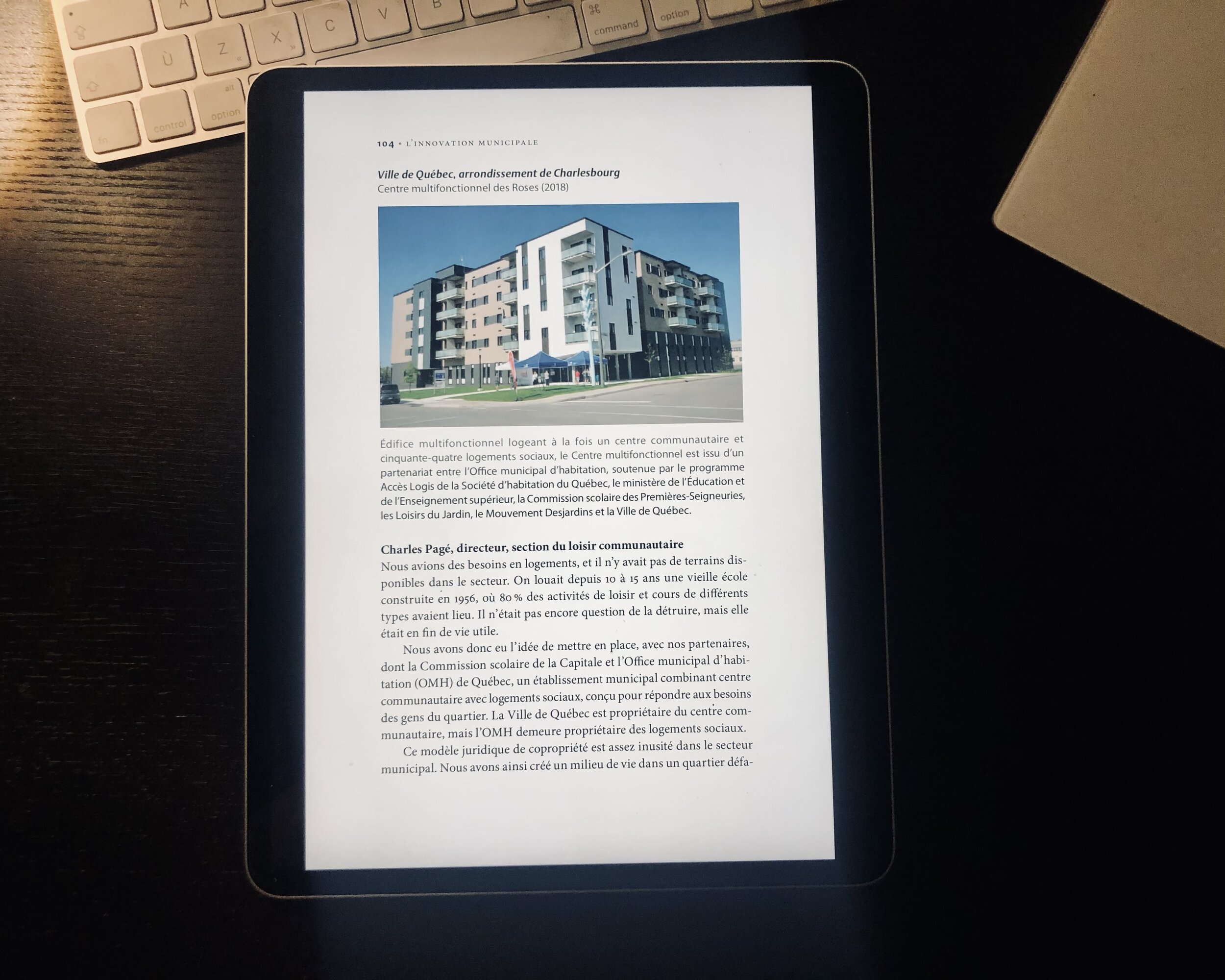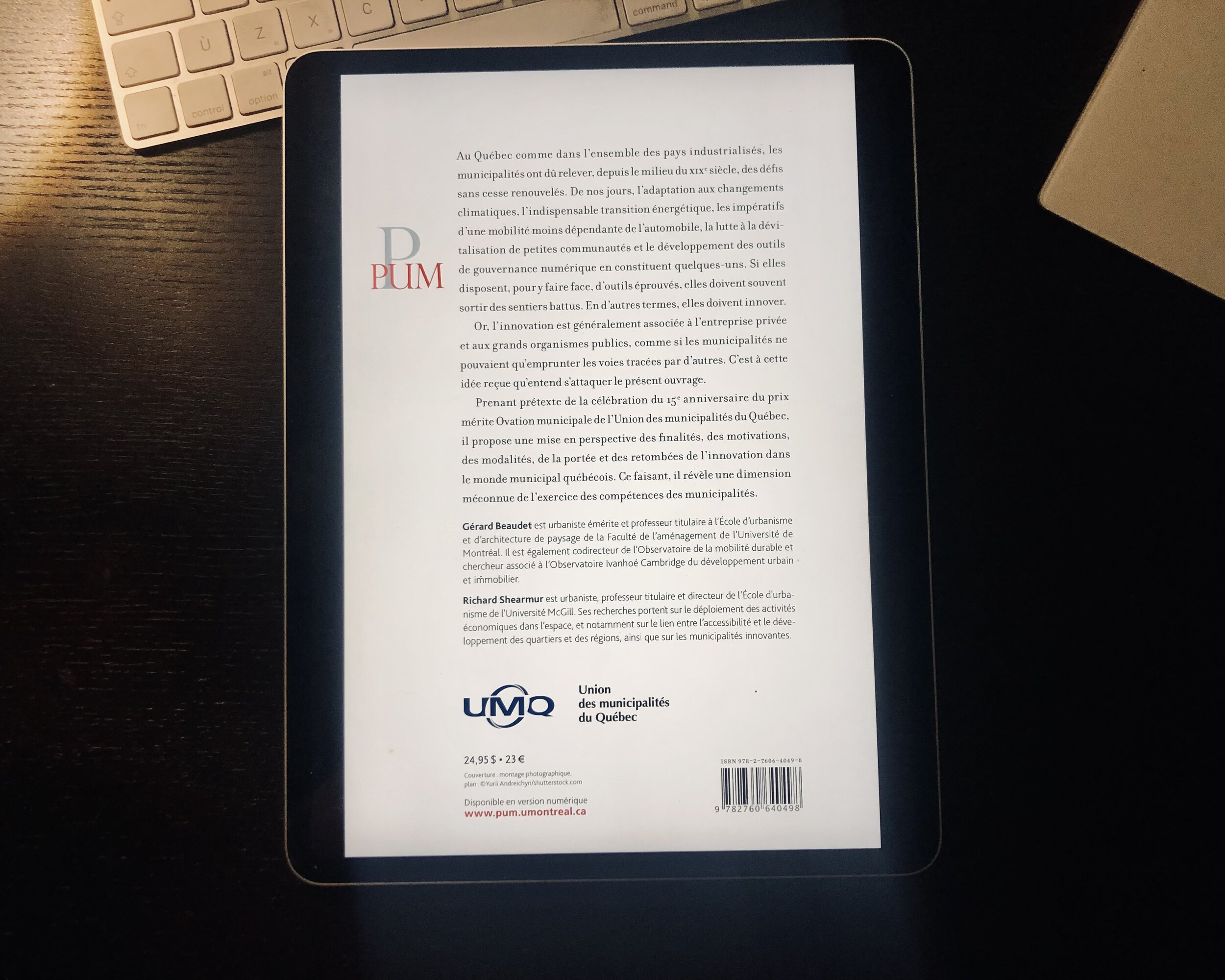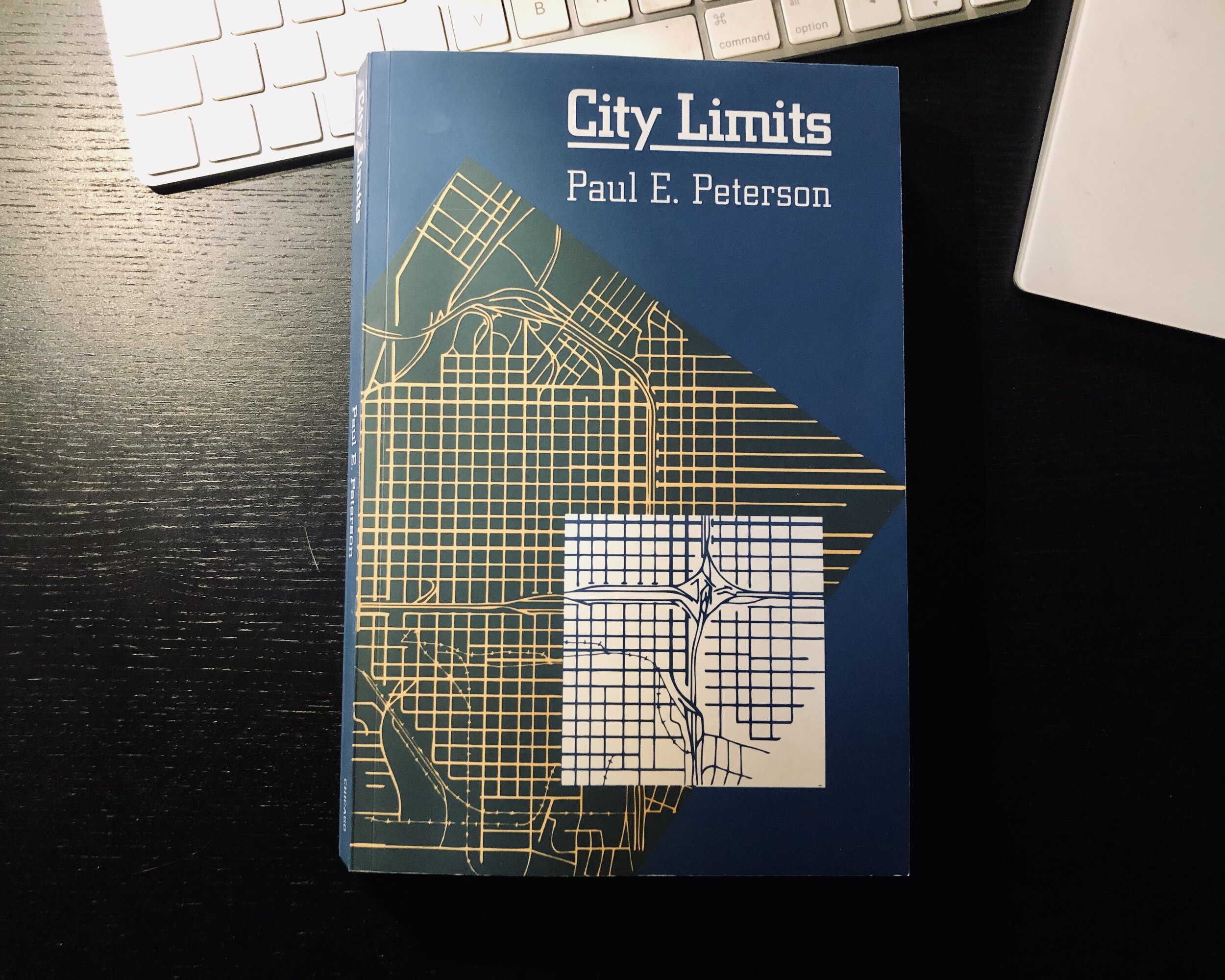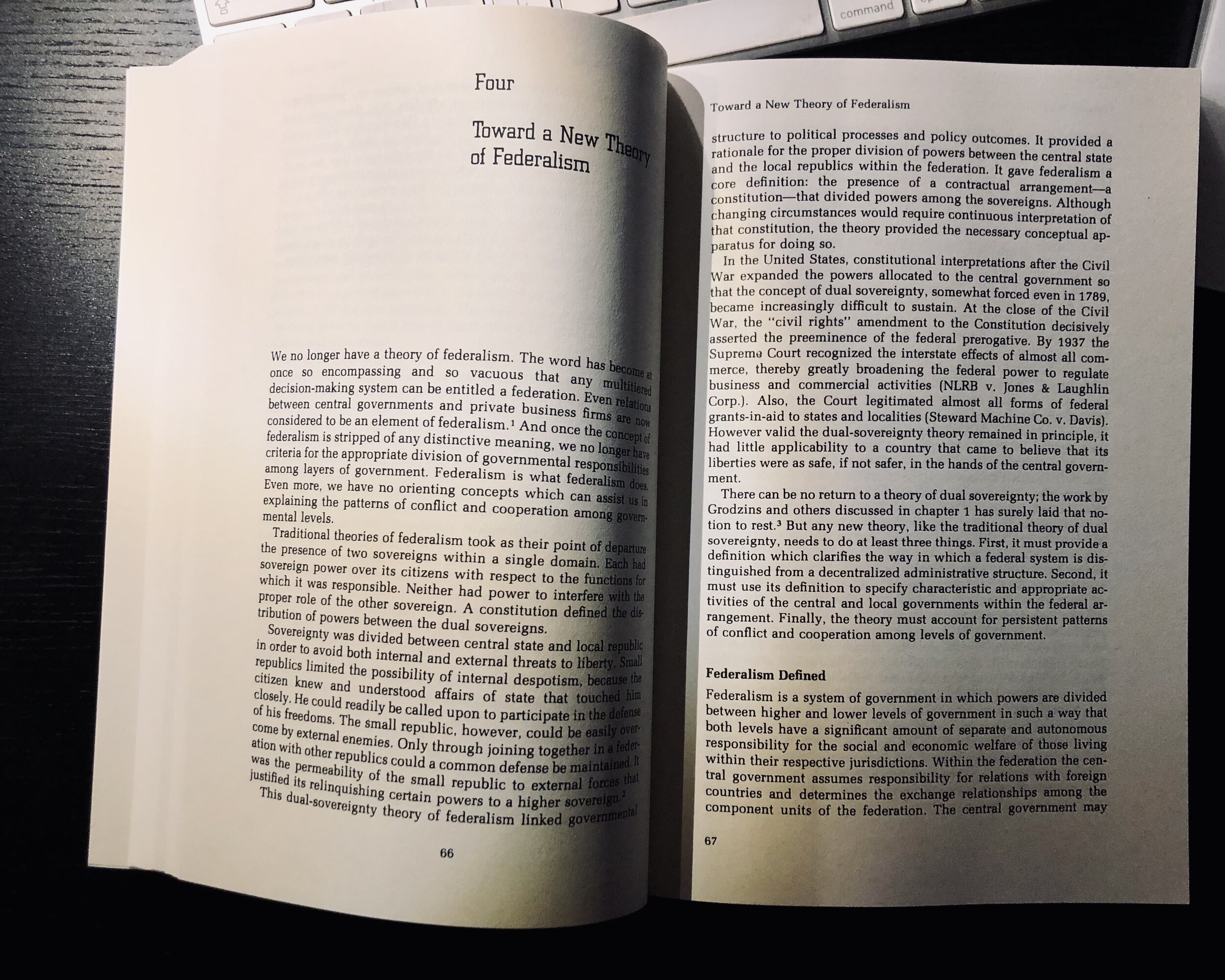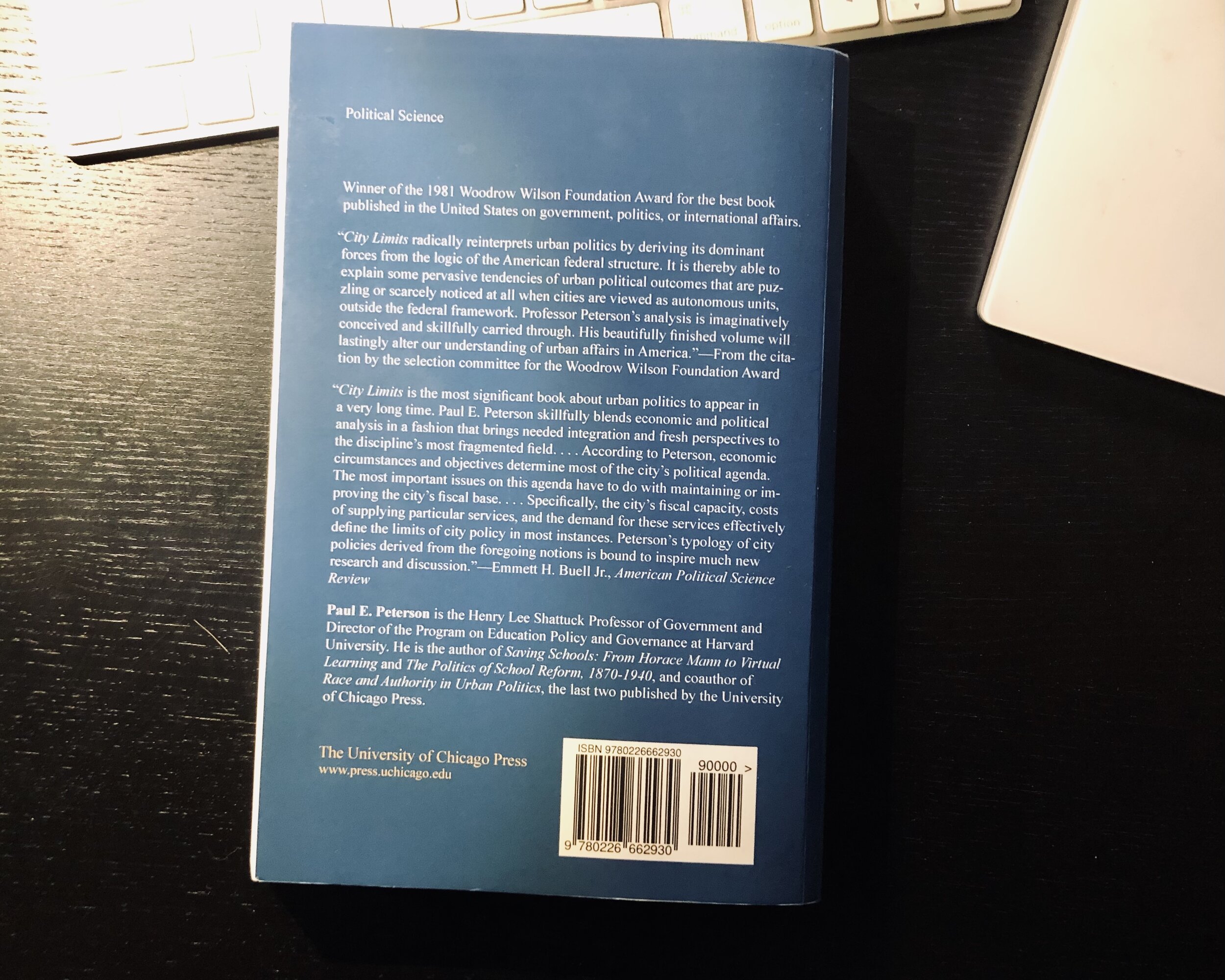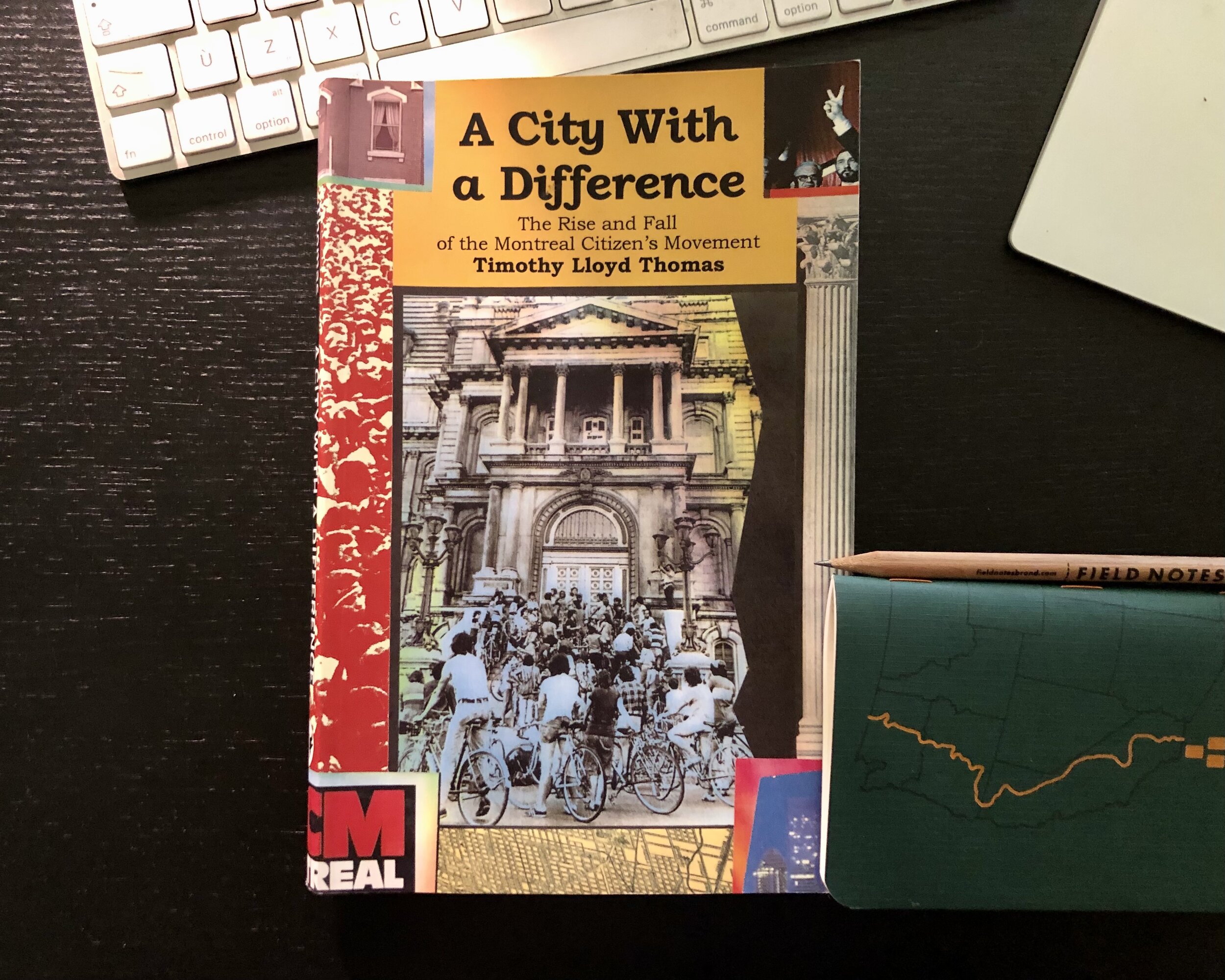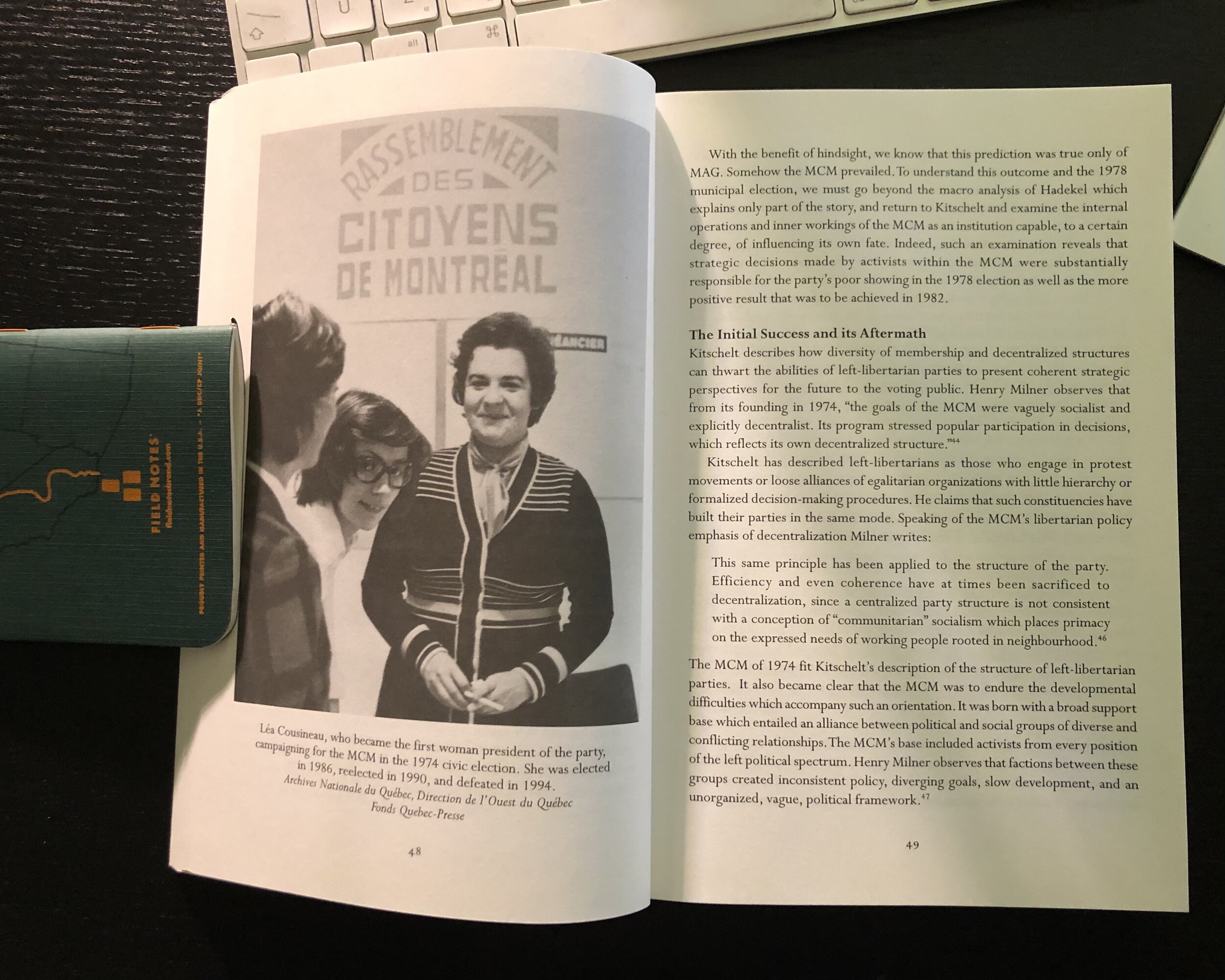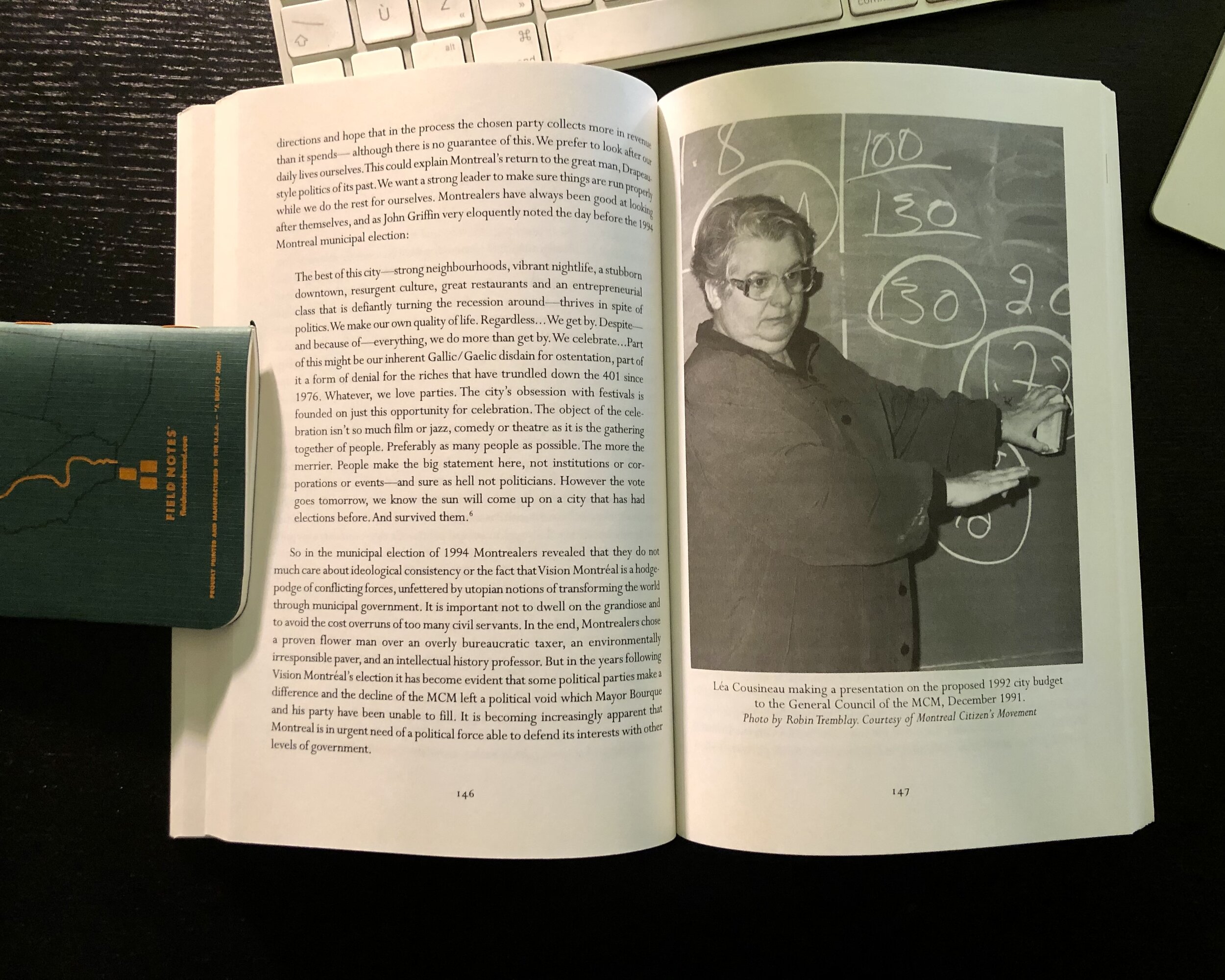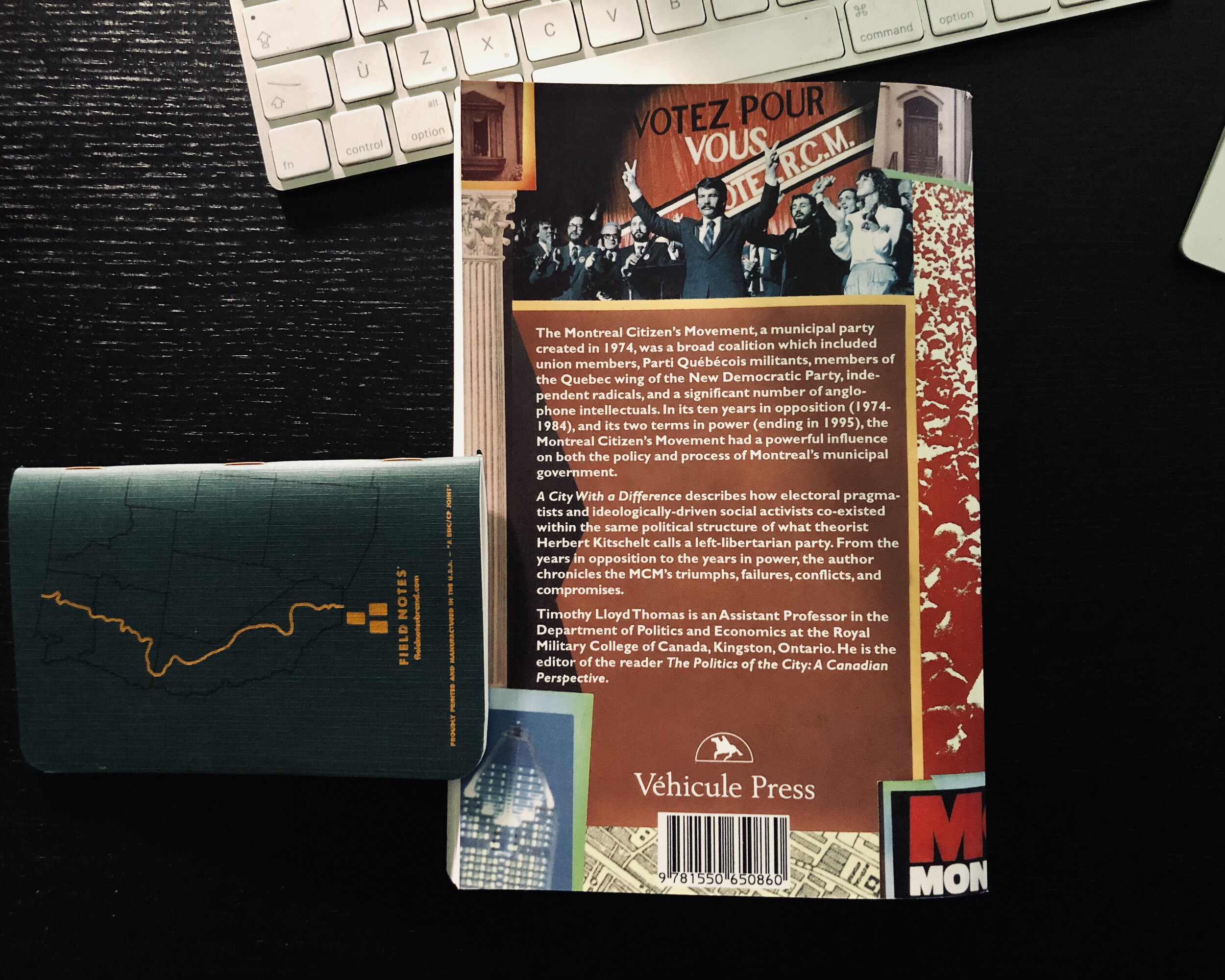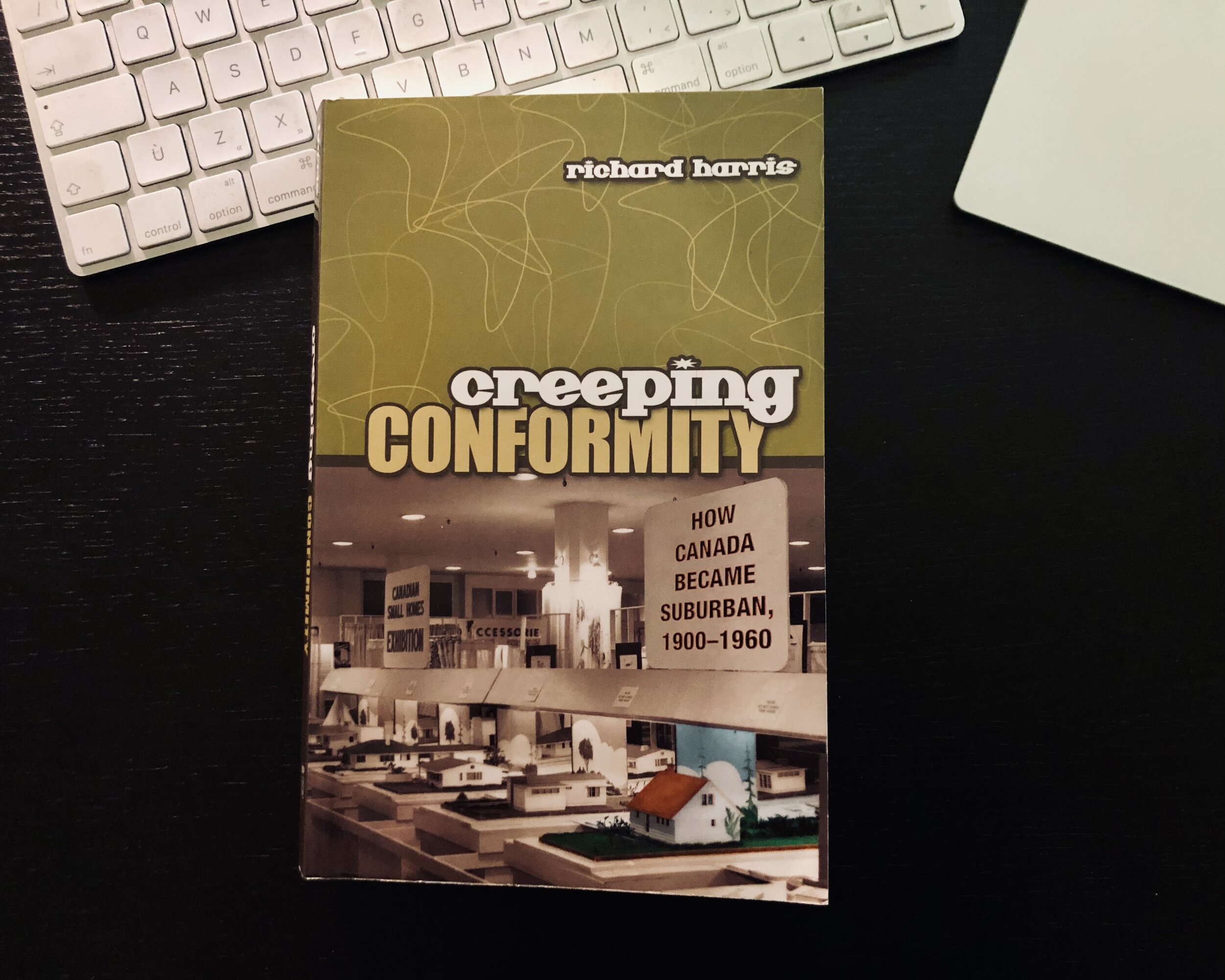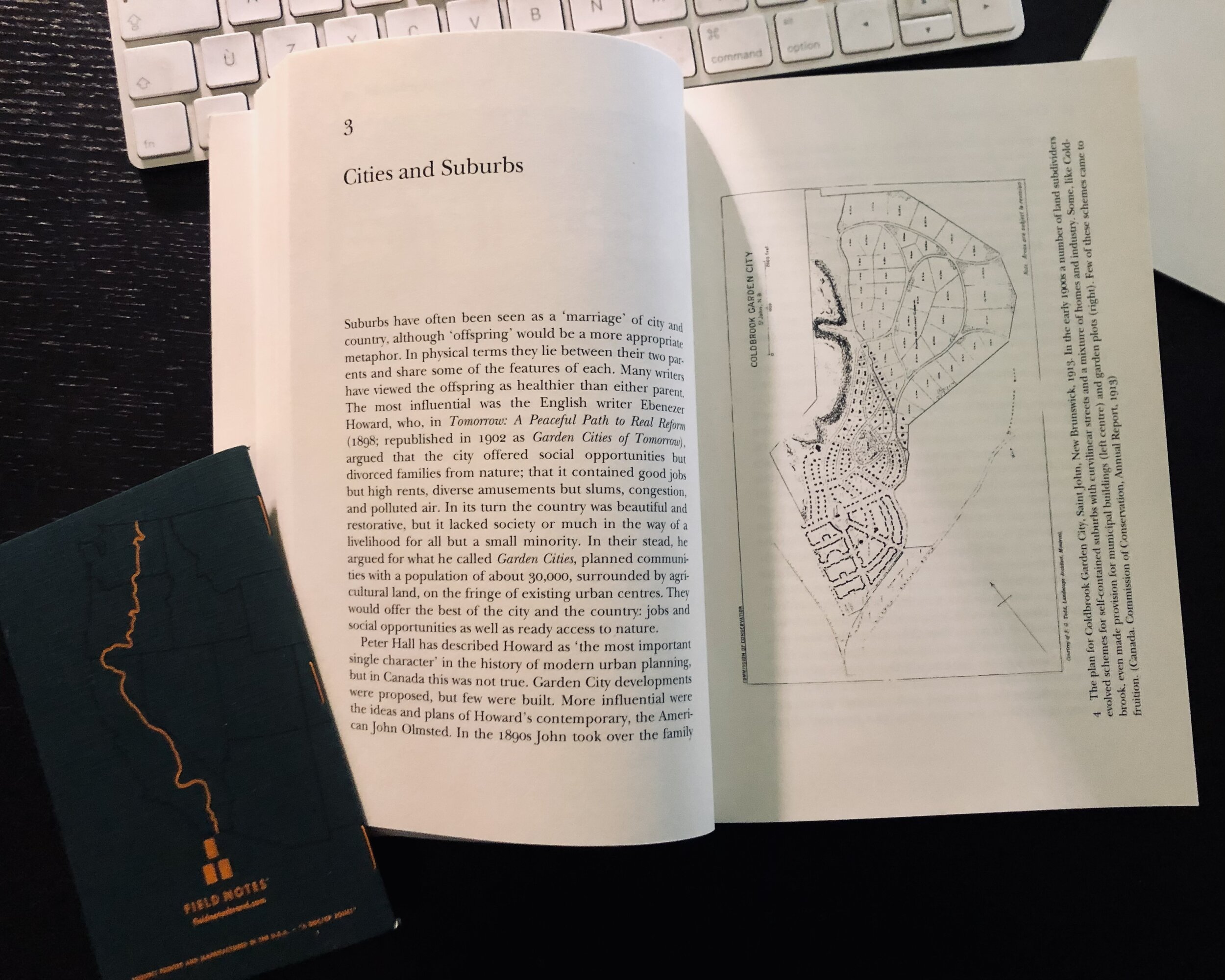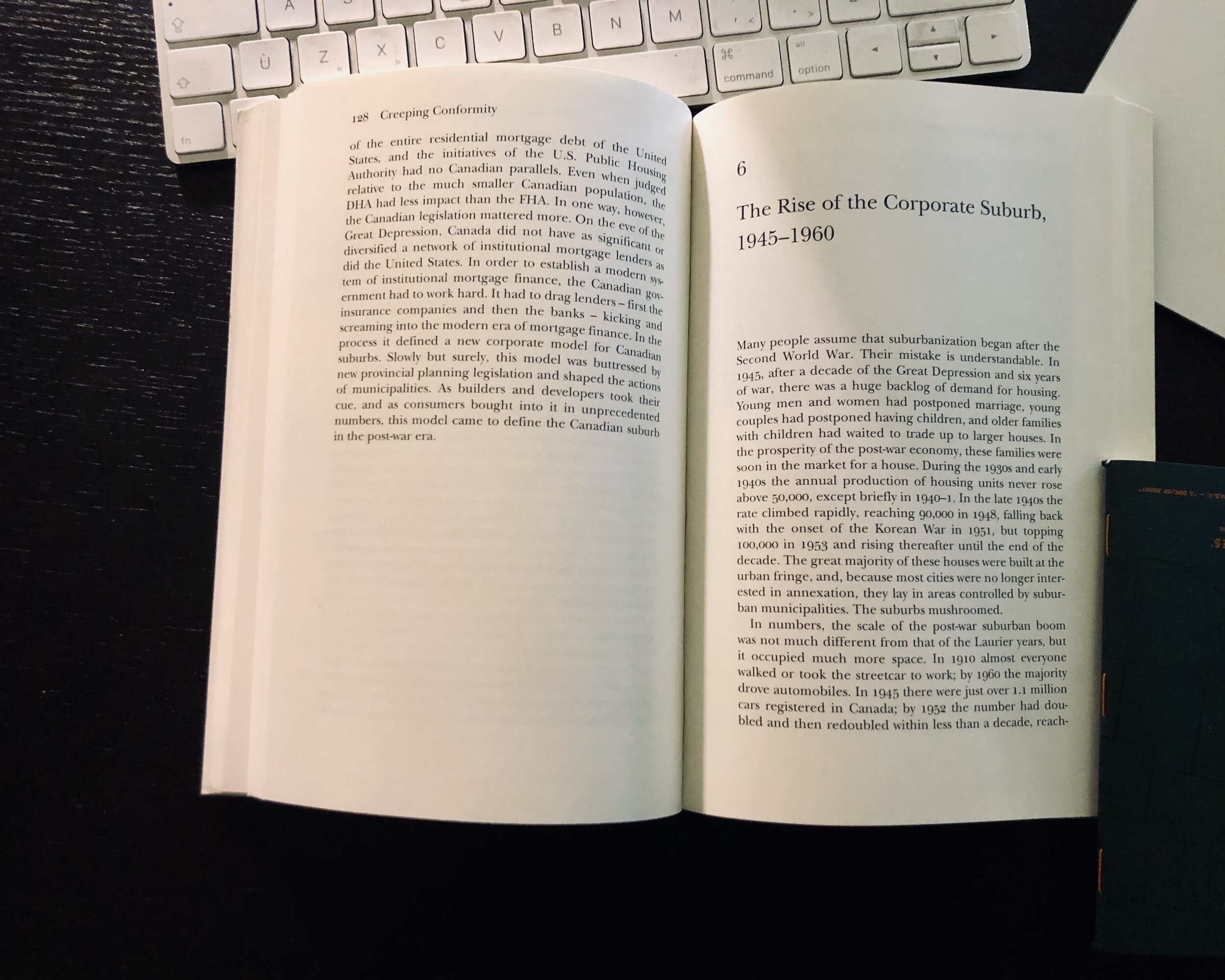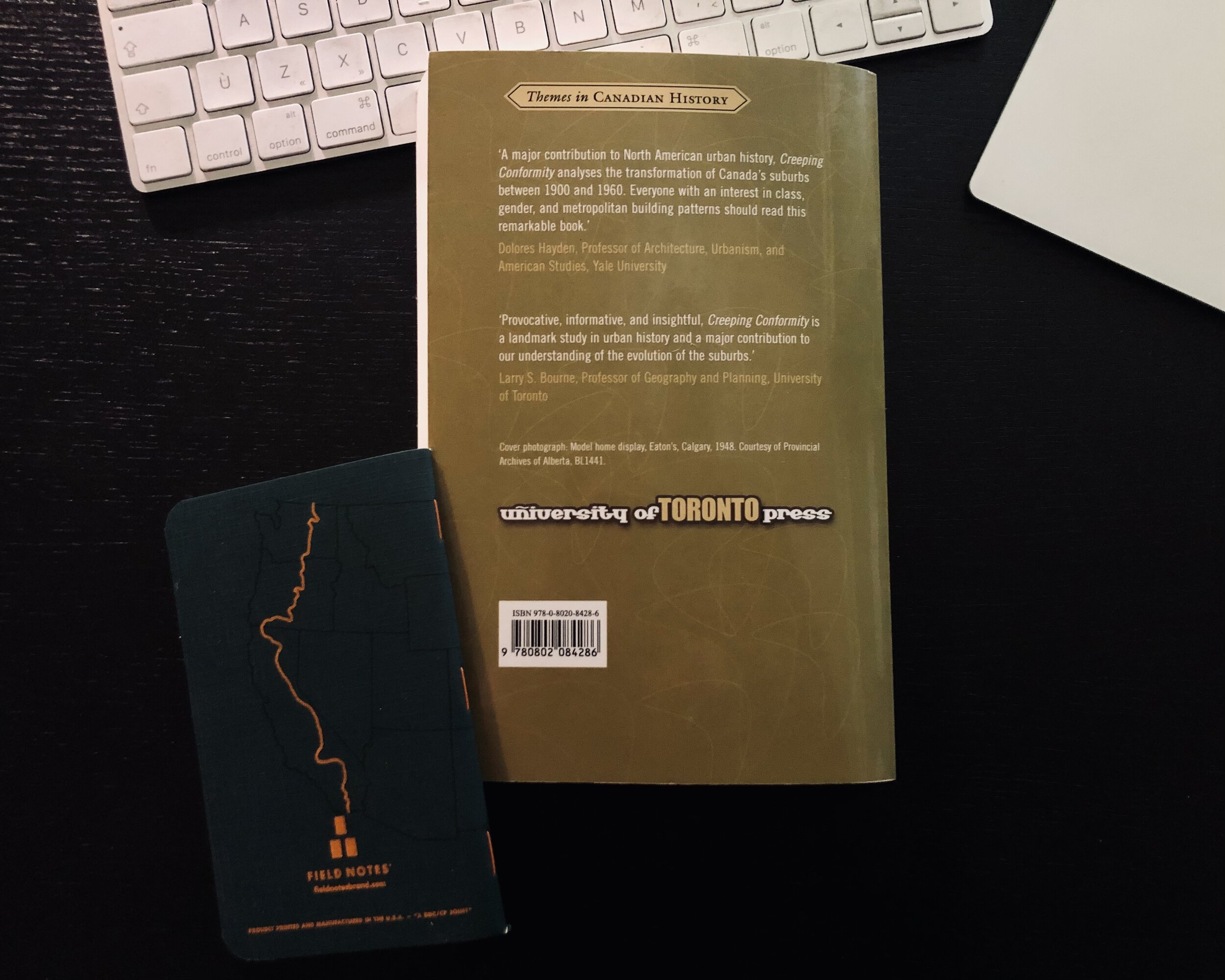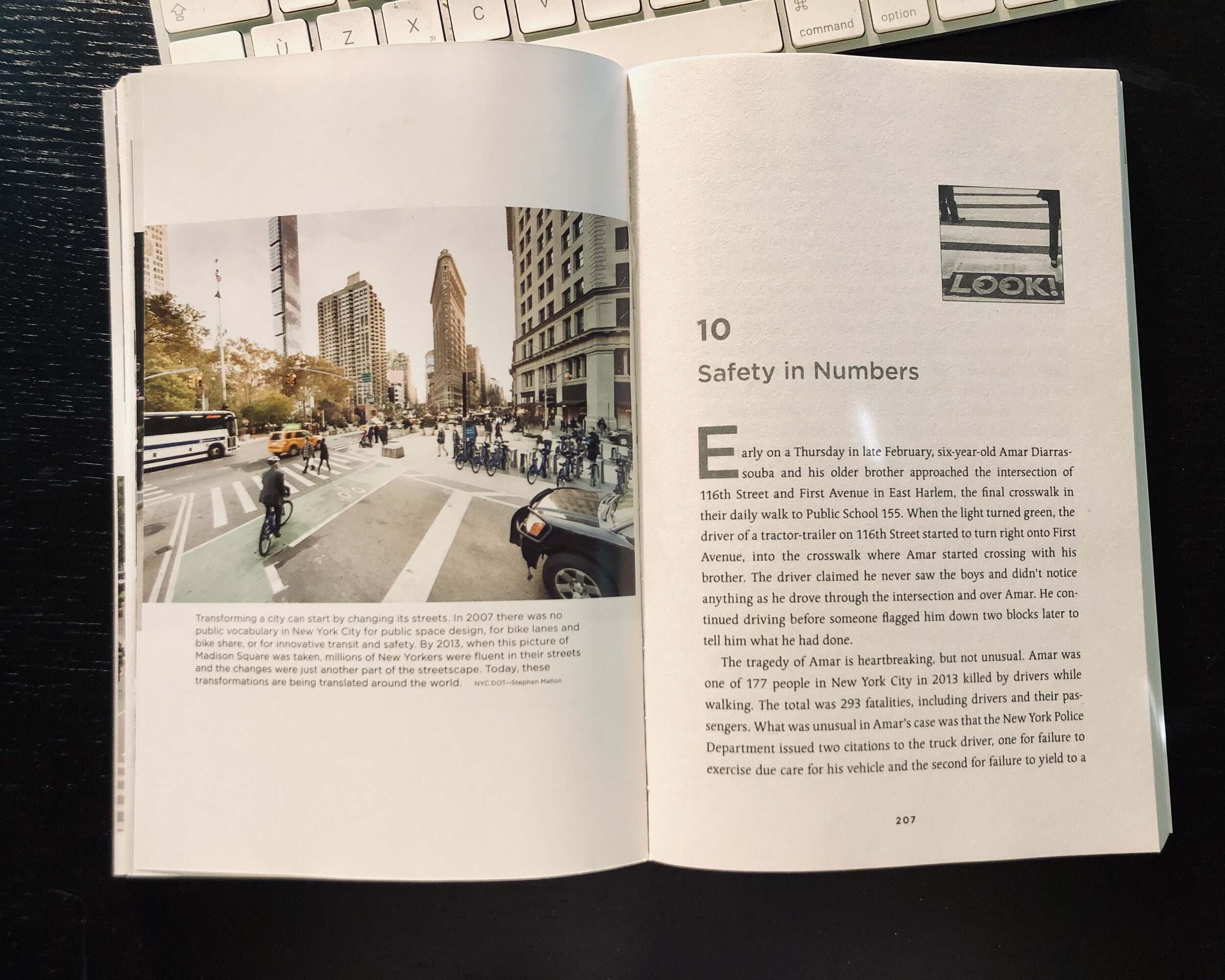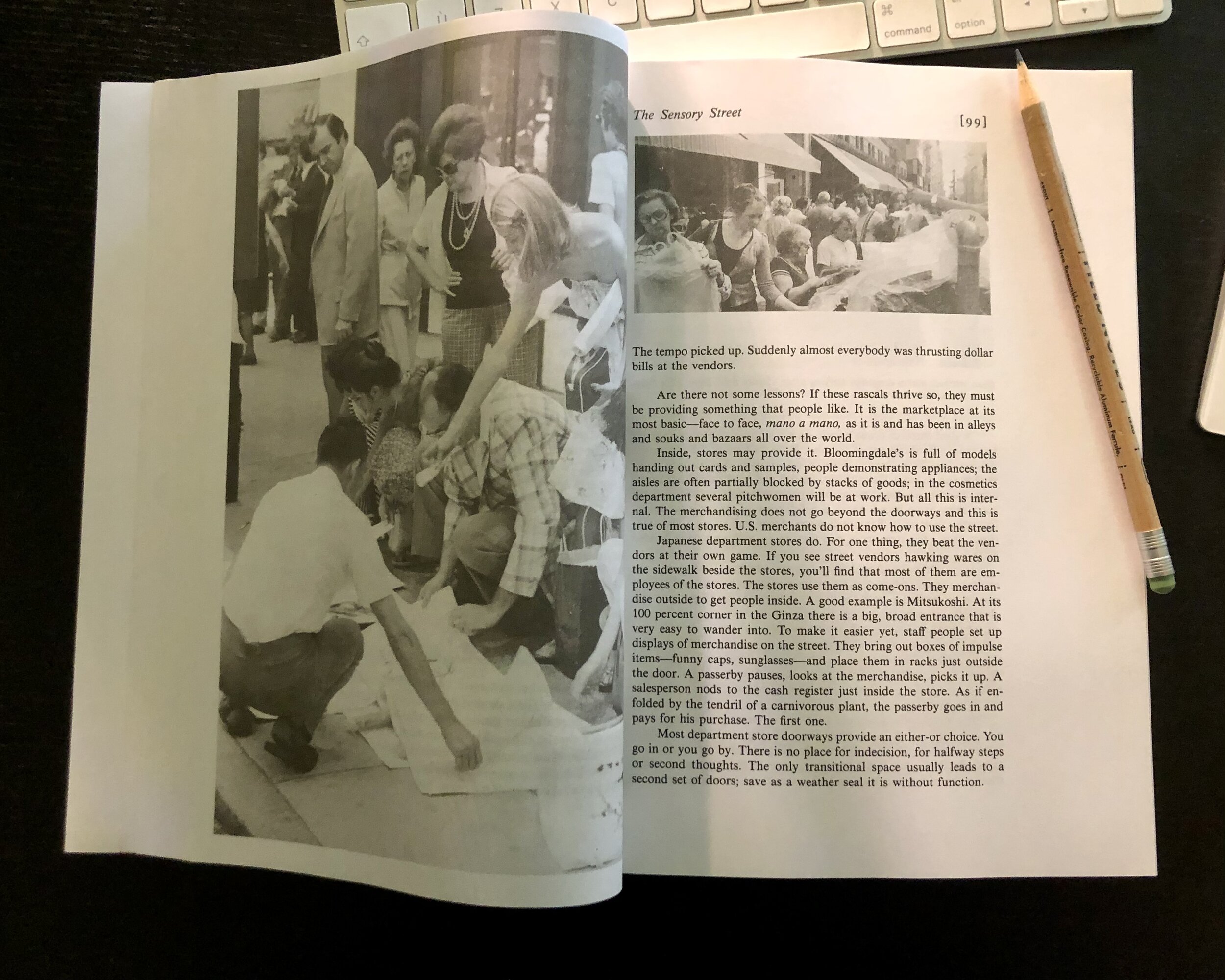11 brefs essais pour des villes résiliantes et durables. Réflexions de la relève municipale. Préface de Jonathan Durand folio et postface de Catherine Fournier, Éditions Somme toute, 2021, 189 pages.
L’idée de monter un ouvrage composé de onze essais écrits par des élu.es et de faire coïncider sa sortie avec les élections municipales à venir (les 6-7 novembre prochain !) ne manque pas d’intérêt. Du moins, cela coïncide pleinement avec notre désir d’utiliser ce prétexte pour aborder les thèmes d’actualité qui s’y rattachent. Dans cet essai, on serait même convié, s’il faut en croire la couverture, à lire des « réflexions » qui nous proviennent non pas d’élu.es de la traditionnelle « machine politique municipale » rendue célèbre lors de la Commission Charbonneau, mais plutôt de la « relève municipale », une nouvelle génération d’élu.es qui aimeraient vraiment nous convaincre que les petites municipalités « [les villes] peuvent sauver le monde ».
Il est vrai qu’à défaut de toujours pouvoir faire les choses autrement, ce sont certainement des élu.es qui ont été, à l’échelle municipale, confrontée à une série de défis « nouvellement génération », au cœur des moyens mis en œuvre afin d’y faire face. Ces défis, comme l’urgence climatique et les outils de plus en plus contraignants déployés pour s’en accommoder, les bouleversements de la nouvelle économie, les suites de la crise sanitaire, sont universels. Ce n’est pas un hasard si les élu.es choisis pour écrire ces essais sont presque tout de municipalités hors des grands centres ; leurs émergences, même si universelles, ont un côté très spécifique et méconnu, mais non moins réel. C’est aussi la première génération d’élu.es à gouverner sous l’égide de la nouvelle loi réconfortant les municipalités dans leurs rôles de « gouvernement de proximité » ; toujours plus de pouvoirs et toujours aussi peu de moyens. On ne sera donc pas surpris de lire qu’aucun des élu.es de la « relève municipale » ne semble s’être senti appuyé par les nouveaux outils réglementaires rendus disponibles par la nouvelle loi.
Dans la préface, les textes sont identifiés comme adoptant « une posture […] “d’idéalisme pragmatique” », ce qui n’est pas faux. Mais il est douloureux de constater, dans ce Québec du 21e siècle, que les municipalités doivent faire toujours plus avec des outils limités et avec l’impôt foncier comme seule ressource financière autonome ; un moyen dépassé et régressif, aux effets pervers qui n’iront qu’en s’aggravant.