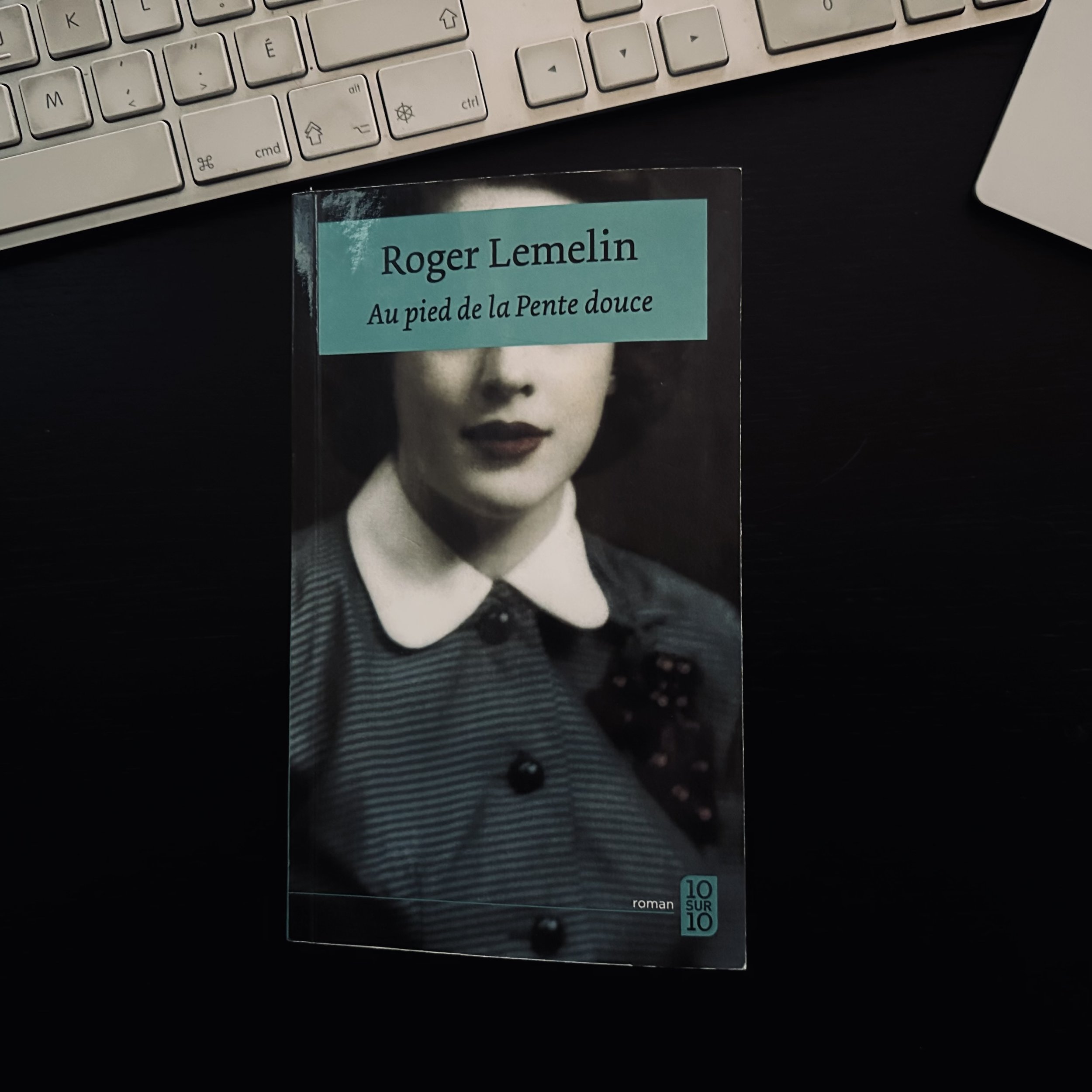The Highway and the City. Lewis Mumford, Harcourt, Brace & World, 1963, 260 pages. Lu sur Internet Archive.
Cela faisait plusieurs années que je voulais lire The Highway and the City. L’argument principal de Mumford est bien connu dans le milieu. Il consiste à dire que laisser l’autoroute (ou toute forme de réseau routier supérieur à un boulevard) « entrer en ville » revient à donner un droit de destruction à ce réseau. Évidemment, le fait que les véhicules soient à essence ou électrique ne change rien (juste pour rappeler que cela est une non-question). Dès les premières pages, Mumford souligne d’ailleurs que « if cars are few, he who possesses one is king ». C’est pour cette raison que toutes les publicités d’automobile se font au singulier, une voiture à la fois. Être derrière cette voiture singulière, uniquement « personnalisé » pour soi chez le concessionnaire, est comme être un roitelet sur la route. C’est lorsque nous sommes tous parechoc à parechoc sur trois, quatre ou six voies d’une autoroute que les choses se corsent et que l’absurdité de notre confinement se révèle. À l’image de l’empereur nu, on découvre que nos habits royaux n’étaient qu’une illusion; loin de nous libérer, on se retrouve asservie par les autoroutes. On se découvre ayant moins de choix et plus pauvres qu’à d’autres époques, pas si lointaines. L’autoroute urbaine laisse toujours sur son passage la destruction de l’existant. Même dans les rares cas où on peut appliquer une forme de « cicatrisation », on évite rarement la déstructuration de l’environnement urbain limitrophe, même une fois ce tissu stabilisé dans sa nouvelle forme. Cette dernière est souvent moins riche et porteuse de nouvelles possibilités; cette différence est rarement comblée.
Dans cet essai, Mumford trouve même le moyen de parler de Benton MacKaye, (of Appalachian Trail fame), qui aurait aussi participé au développement d’un concept de réseau routier supérieur. Ce dernier se résumait en la notion « Townless Highways—Highwayless Town ». Malheureusement, c’est la partie « Highwayless Town » qui fut oubliée, et avec elle, toute possibilité d’un réseau au service des villes et non destructeur de celles-ci. Mumford fait également un parallèle intéressant avec les grandes compagnies de chemin de fer, qui pendant longtemps avait eu le pouvoir de pénétrer et réaménagé, à leurs guises, toute zone urbaine. Juste au moment où ce pouvoir devenait caduc, voilà qu’on oubliait ces leçons pour faciliter le passage des autoroutes jusqu’aux portes et à travers la ville, que ce soit de plain-pied, en tranchée ou sur pilotis.
Ce texte de Mumford, paru une première fois en 1958 dans la revue Architectural Record, a l’avantage d’être à la fois prophétique (toutes les pires résultantes d’un réseau fondé sur l’automobile correspondent à notre réalité contemporaine) et d’être ancré dans son temps. Ainsi, il offre ce paradoxe intéressant : d’un côté, les autoroutes nous permettront d’aller d’une ville à l’autre en quelques heures et, de l’autre, le système postal, qui permettait auparavant de transmettre une lettre en deux heures dans une même ville, exige maintenant, pour ce même parcours local, un minimum de deux (2) jours. Il y a une leçon à tirer dans ça.
Je crois que c’est sous cet angle, celui de l’efficacité urbaine locale, qu’il faut regarder des propositions comme celle du troisième lien. Les villes de Québec et de Lévis, en tant que villes au service d’une population urbaine croissante, ne gagnent rien en facilitant ce nouveau lien automobile dans leurs systèmes . Je laisse à Mumford la dernière ligne : « a city exists not for constant passage of motorcars but for the care and culture of men ».