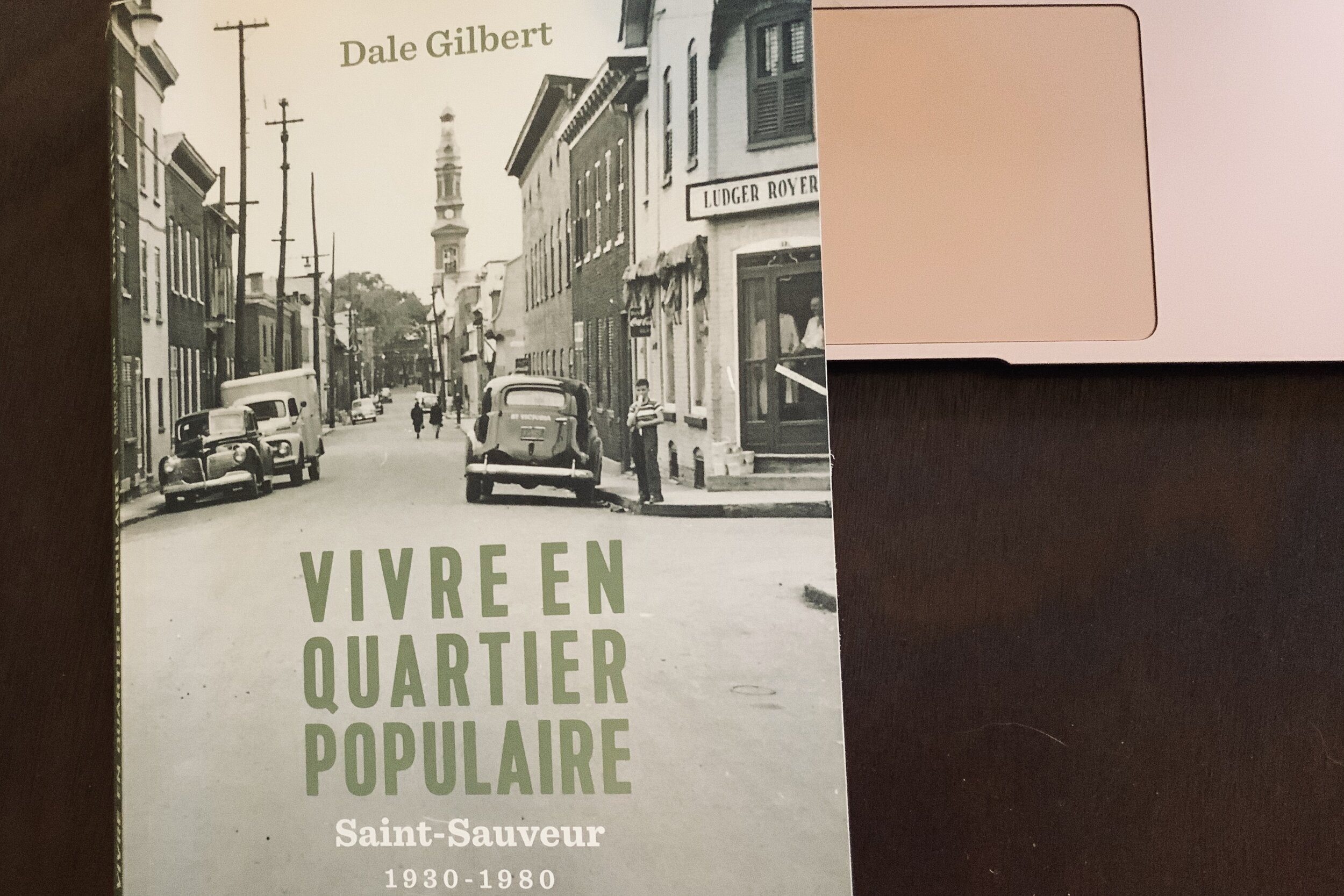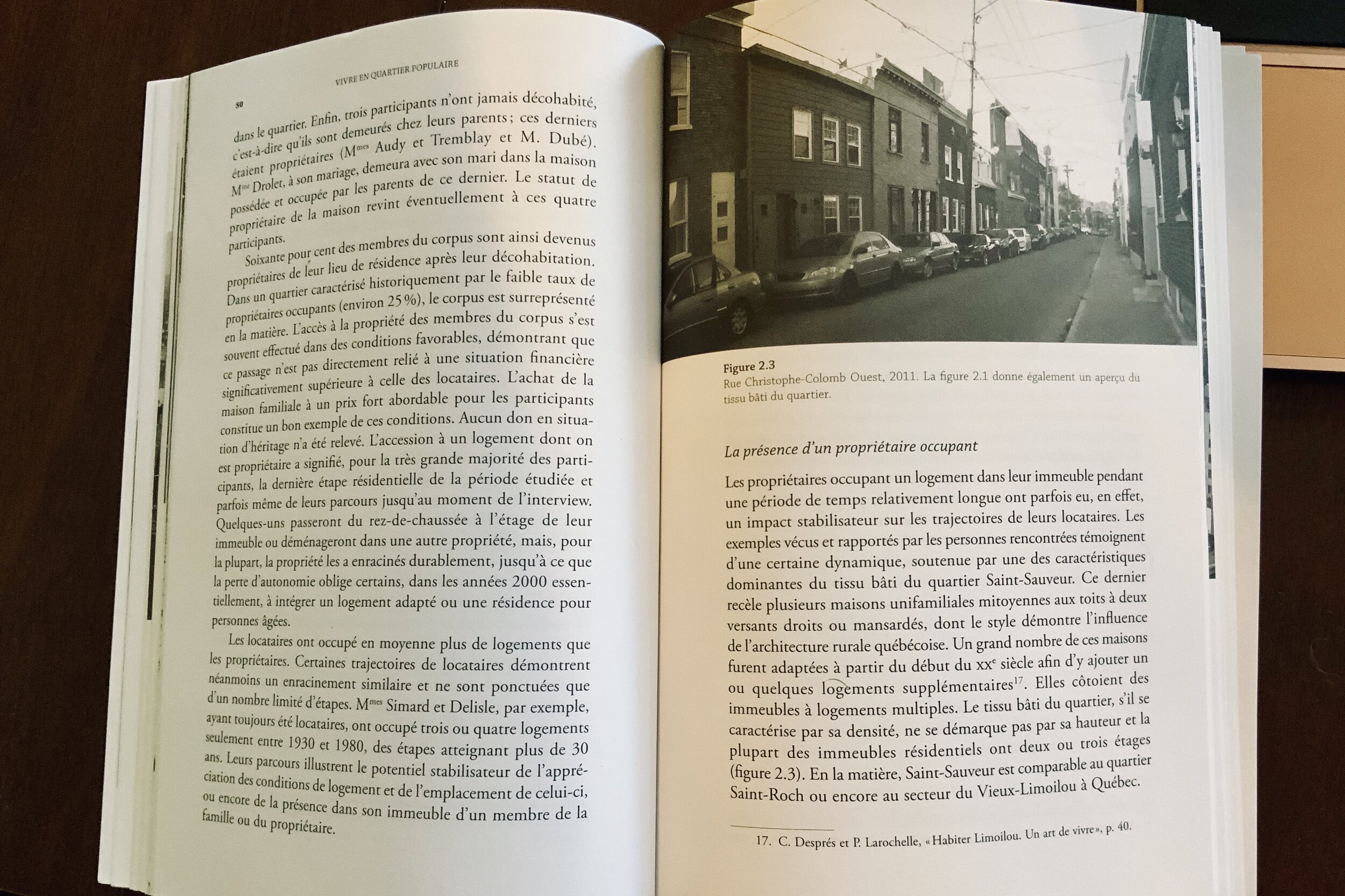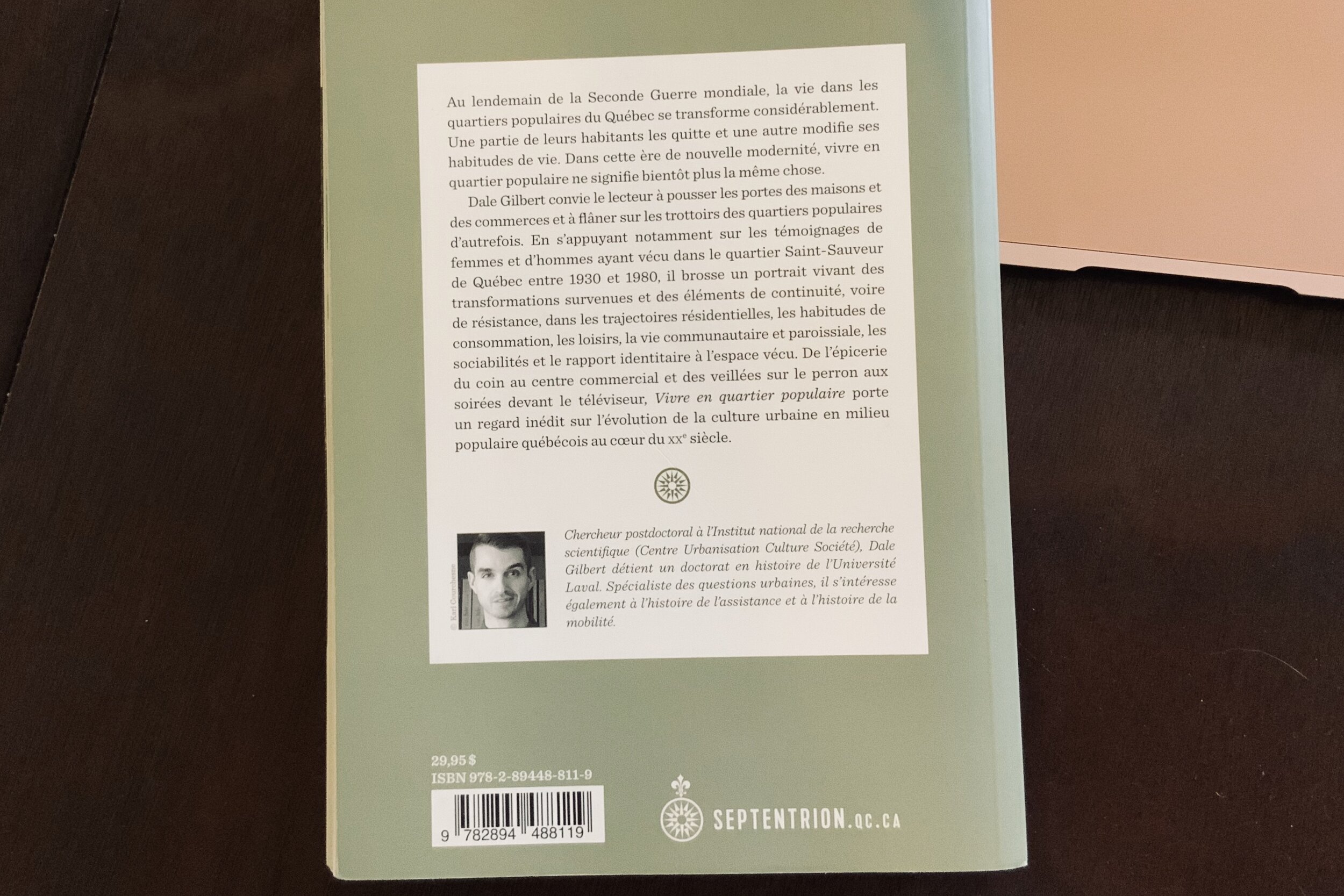Les Plouffe [1]. Roger Lemelin, Édition Stanké, 2008 [1948], 448 pages.
« Il était une fois des gens heureux… » est la chanson-titre de la bande originale du film (BOF), chantée par Nicole Croisille. Paroles et musique de Stéphane Venne. Mais c’est l’interprétation de Nicole Martin qui demeure canonique.
On ne pourra faire autrement, surtout si la lecture de ce roman se fait après le premier de Roger Lemelin, Au pied de la Pente douce, qui se déroule dans le même quartier de Québec et le même univers familial et temporel, que de comparer entre les deux. Et certainement, cette comparaison emmènera un soupir de soulagement, même si la lecture ne se fait pas sans ressentir de nombreuses crispations devant plusieurs scènes et échanges entre les personnages. Le patriarche des Plouffe, Théophile, ainsi que le curé de la paroisse, Folbèche, sont dépeints dans toutes leurs rigidités aveugle et avilissante. Il y a par contre des scènes du roman qui ont atteint un statut quasi mythique, comme celle au Château Frontenac, entre Ovide Plouffe (interprété dans les films par Gabriel Arcand, au meilleur de sa force réservée d’acteur) et Rita Toulouse (interprétée dans les films par Anne Létourneau, incarnation sans pareil du charme d’une autre époque). Ou encore celle de la procession contre la conscription, qui s’étend et serpente entre les quartiers de la basse-ville et les hauteurs de la basilique-cathédrale et qui signalera le point d’orgue de ce mouvement. Mais, bien entendu, si nous avons l’impression de reconnaitre ces scènes emblématiques avant même de les lire, c’est parce que nous avons souvenir, pour plusieurs, d’avoir littéralement vu ces scènes dans le film [1] réalisé par Gilles Carle, qui l’avait d’ailleurs scénarisé en proche collaboration avec l’auteur.
L’une des particularités de l’œuvre Les Plouffe, et même ce qui fut marquant à son époque, était sa capacité à s’intégrer et à prendre la forme du média ayant le plus d’impact lors de la translation. Ces personnages, à saveur prononcée de « quartier populaire urbain », avec leurs caractéristiques si distinctement « ouvrières », apportent une fraîcheur dans l’univers renfermé et frileux de la littérature canadienne-française de 1948, au moment de paraitre. Passant de personnages de roman (un peu rigides) à l’incarnation d’une certaine classe, enfin visible à la faveur de leurs infiltrations dans le monde de la radio et immédiatement après, en inventant presque le genre, en téléroman à la télévision de Radio-Canada (autant les émissions de radio que de télé s’intitulaient La famille Plouffe). Et lorsque tous ces rôles et situations avaient été pressés pour tout ce qu’ils avaient à donner et commençaient même à reculer dans les mémoires, la Révolution tranquille et autres changements temporels et contextuels aidants, Les Plouffe connurent un dernier hourra, grâce au film sorti en 1981. Trois ans plus tard, en 1984, une suite, Le crime d’Ovide Plouffe, basé cette fois sur un scénario original de Roger Lemelin (et non un livre), qu’il calque sur un fait réel survenu en 1949, permet de conclure l’histoire, dans toute sa finalité tragique.
Il n’est plus possible de replonger dans cet univers avec les yeux frais et imprégné de la culture d’un lecteur de l’époque. Malgré tout, Les Plouffe est certainement parmi les œuvres qui se rapprochent le plus de l’expérience d’origine, sans que la barrière temporelle soit infranchissable, au point de rendre la lecture comme celle d’une expérience pénible en pays étranger. En réalité, on y gagne positivement en faisant la connaissance des Plouffe, sous toutes leurs incarnations!
[1] On trouve aussi gratuitement, sur le site de Radio-Canada, cette même édition du roman lu par l’acteur Pierre Curzi, qui à l’époque dans le film interpréta le personnage de Napoléon, un des trois frères (celui du milieu) de la famille Plouffe. C’est une bonne façon de découvrir l’œuvre, autrement et à peu de frais! Bonne écoute!
[2] Pour la petite histoire, plusieurs scènes du film qui, dans l’univers de l’histoire, se déroule dans les rues du quartier Saint-Sauveur, en basse-ville de Québec, ont été filmées dans le quartier Pointe-Saint-Charles (traditionnellement anglophone irlandais) de Montréal. C’est assez évident et ironique lorsqu’on connait les deux quartiers, comme l’illustre ce montage.