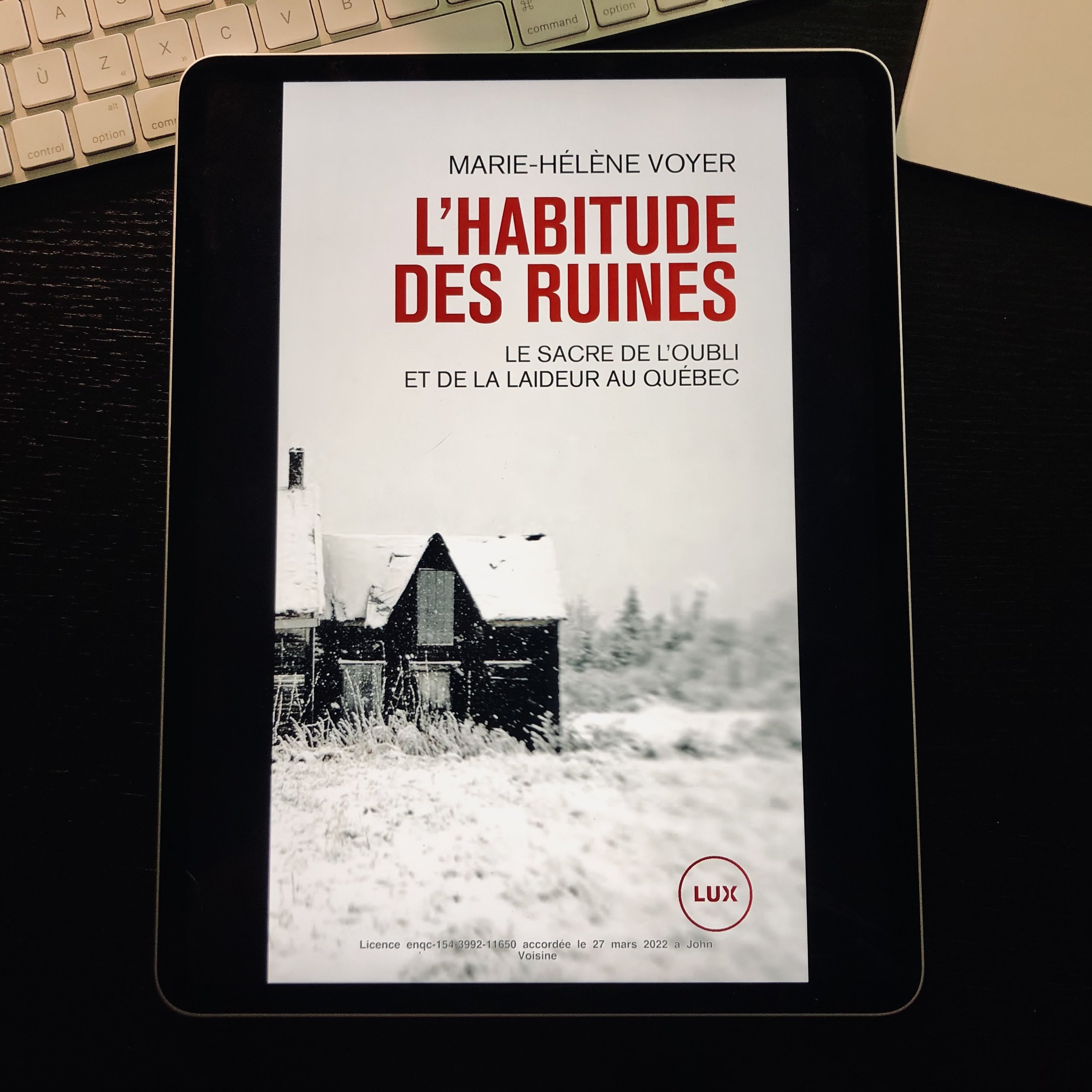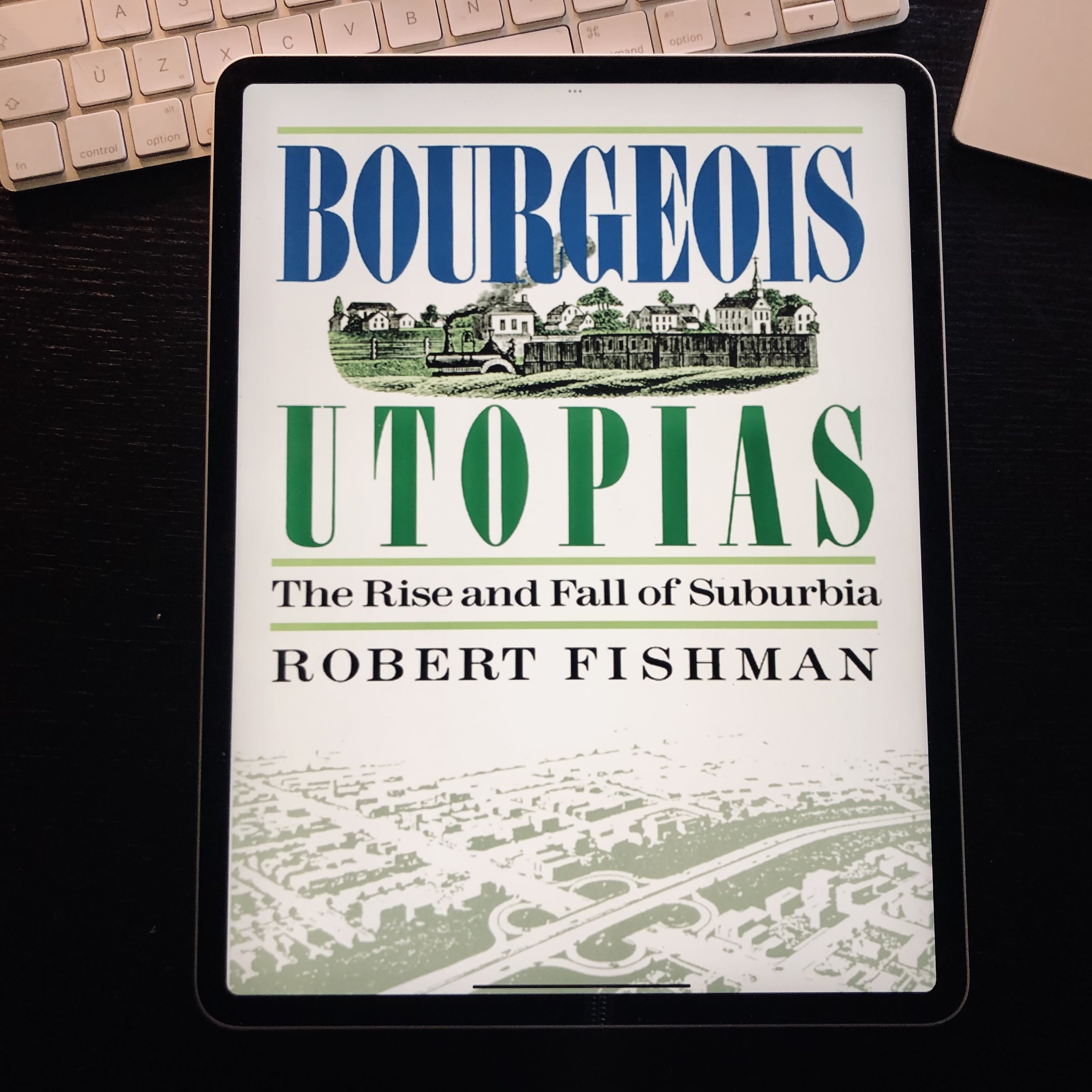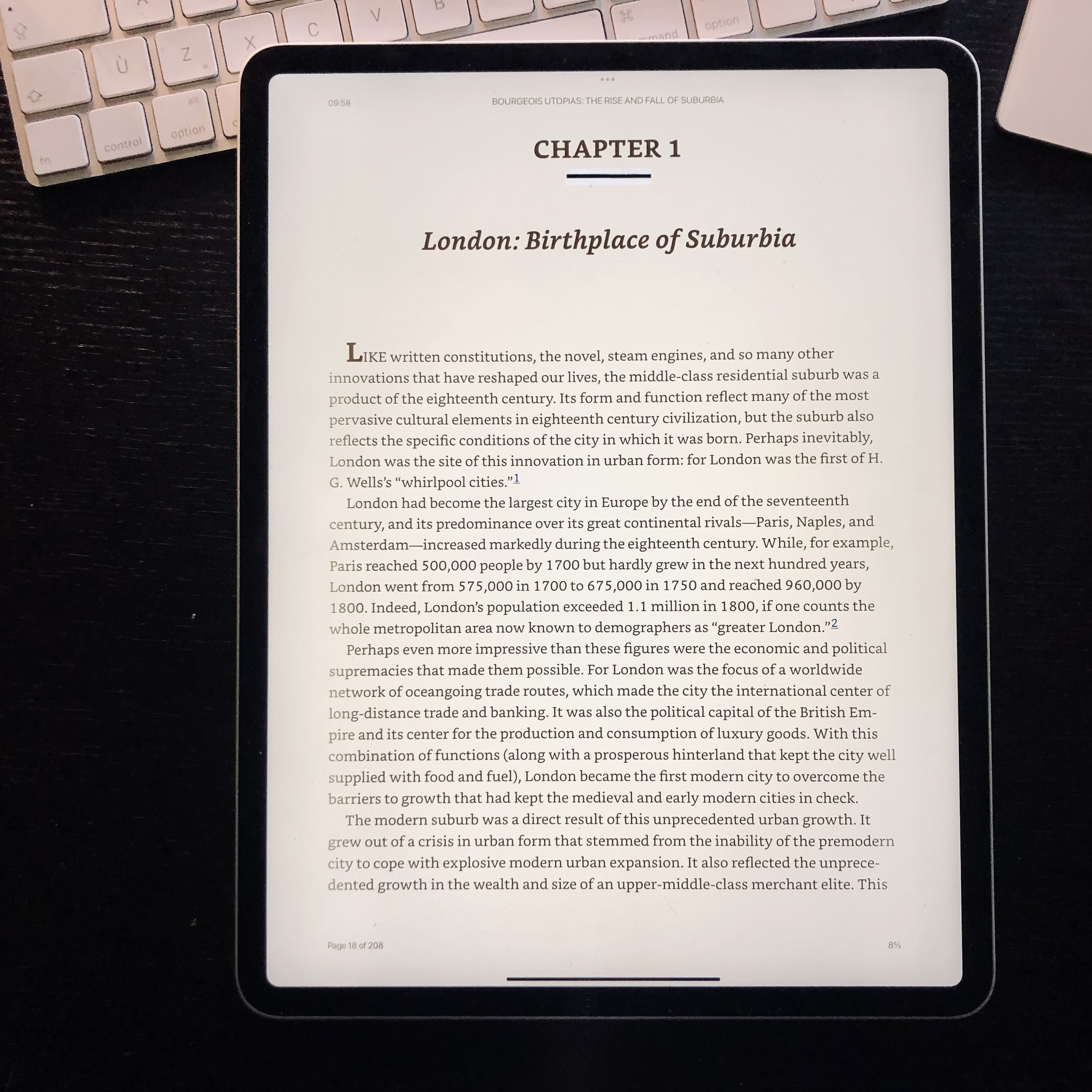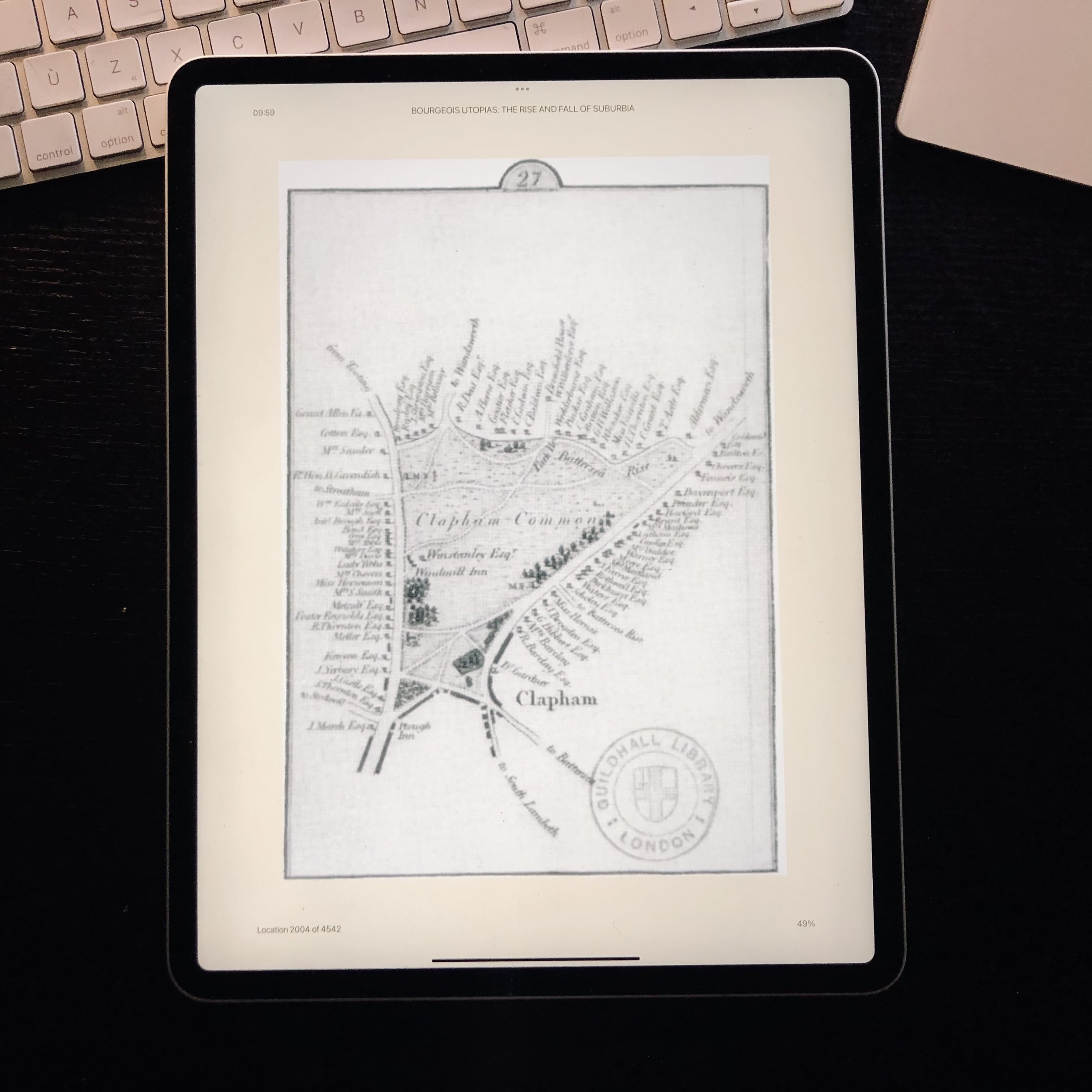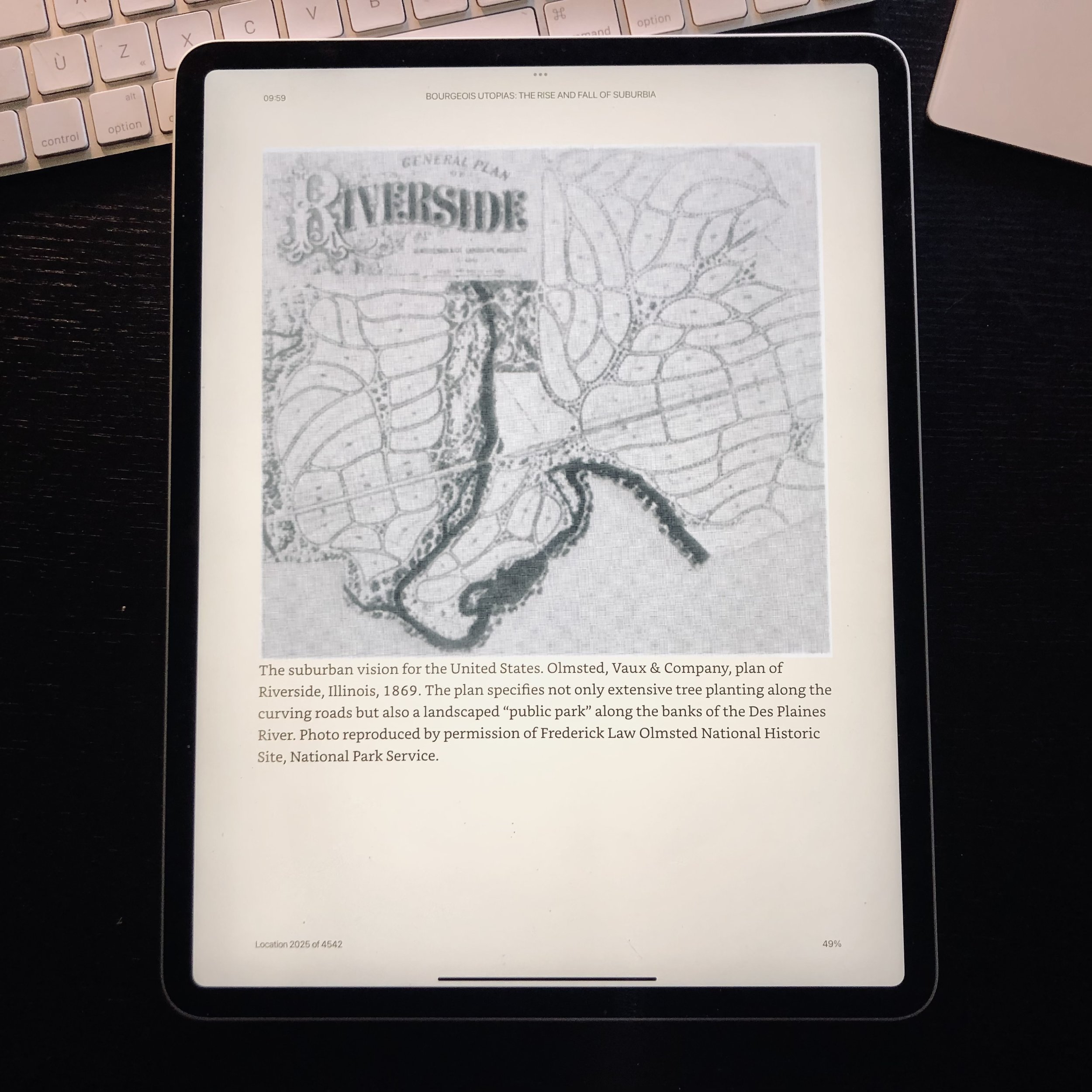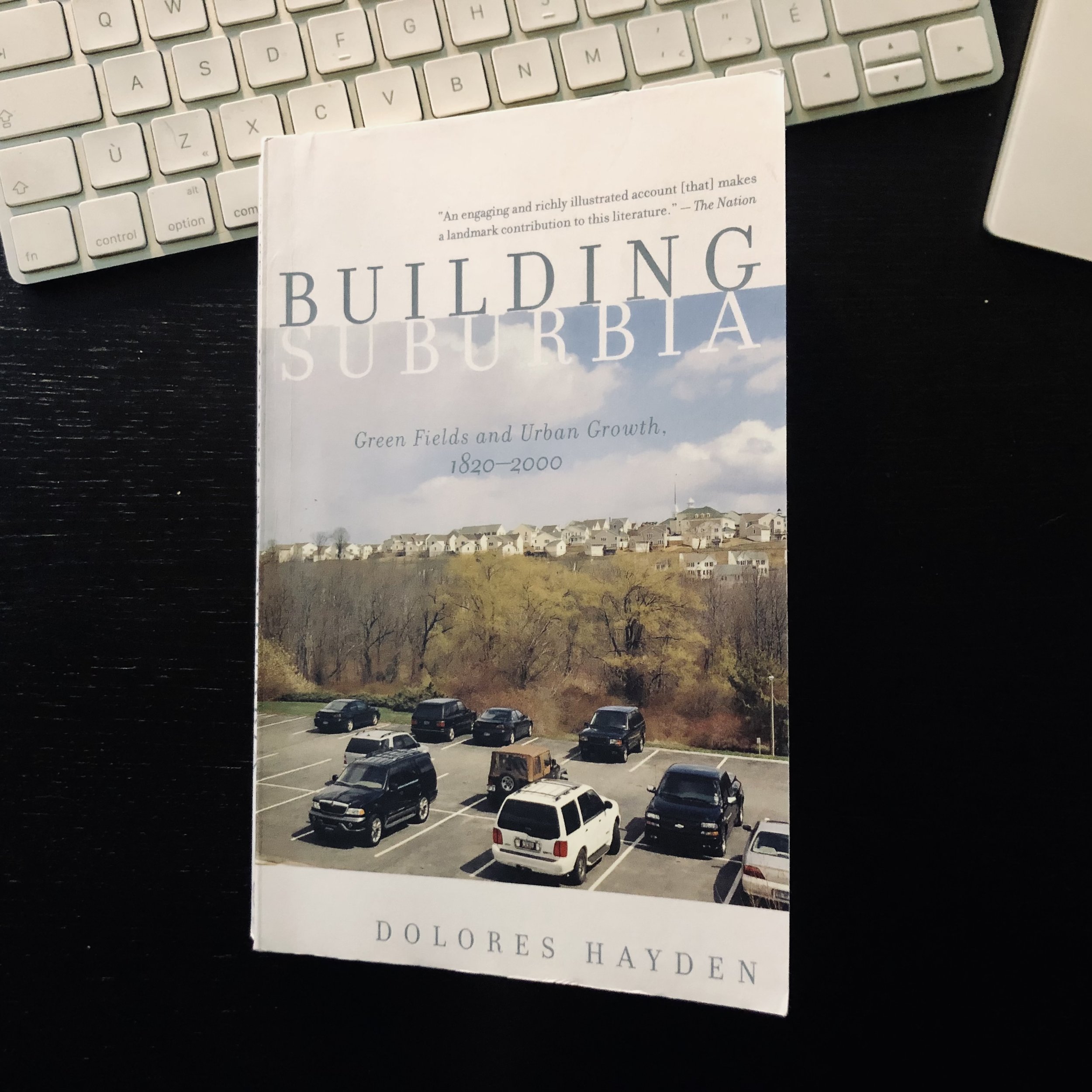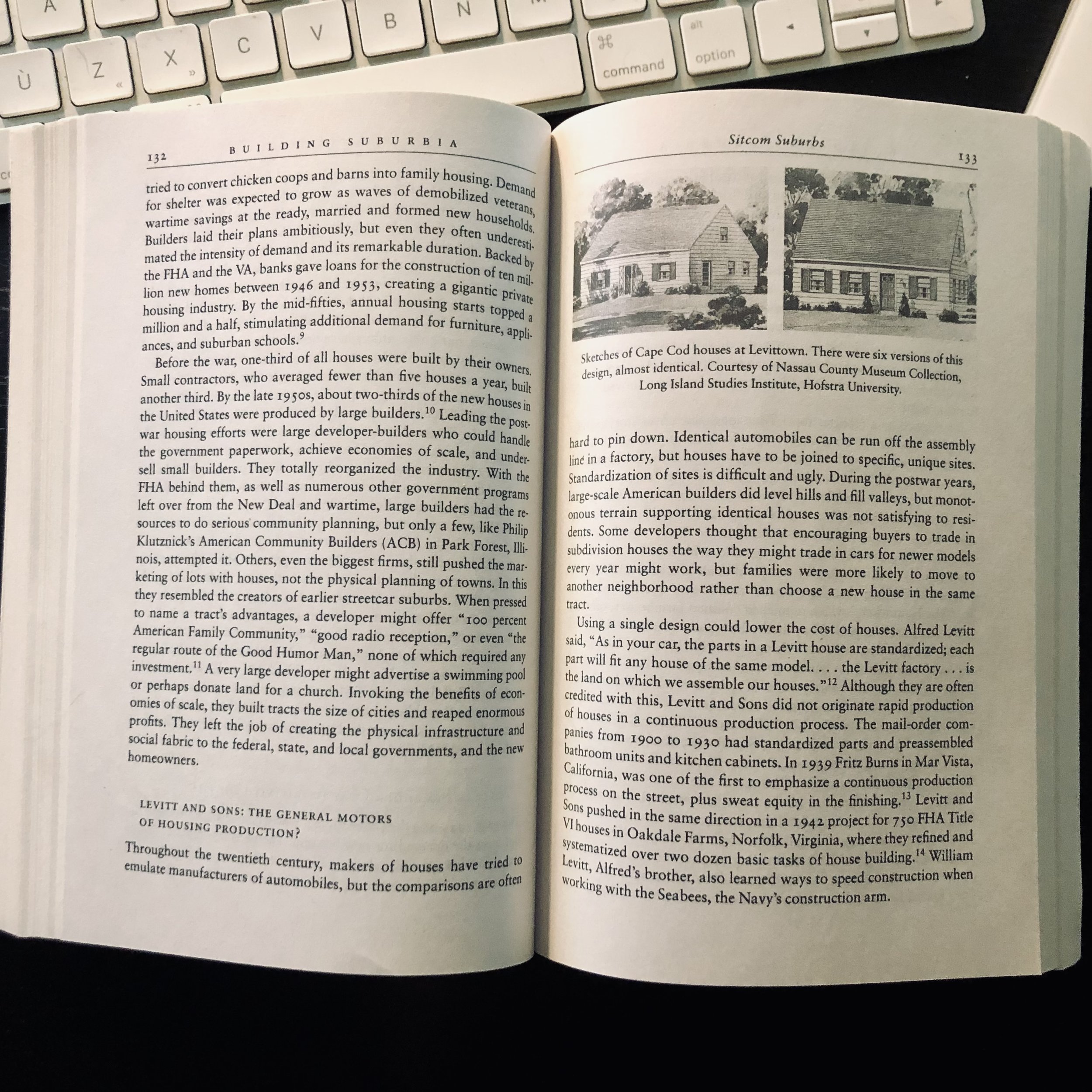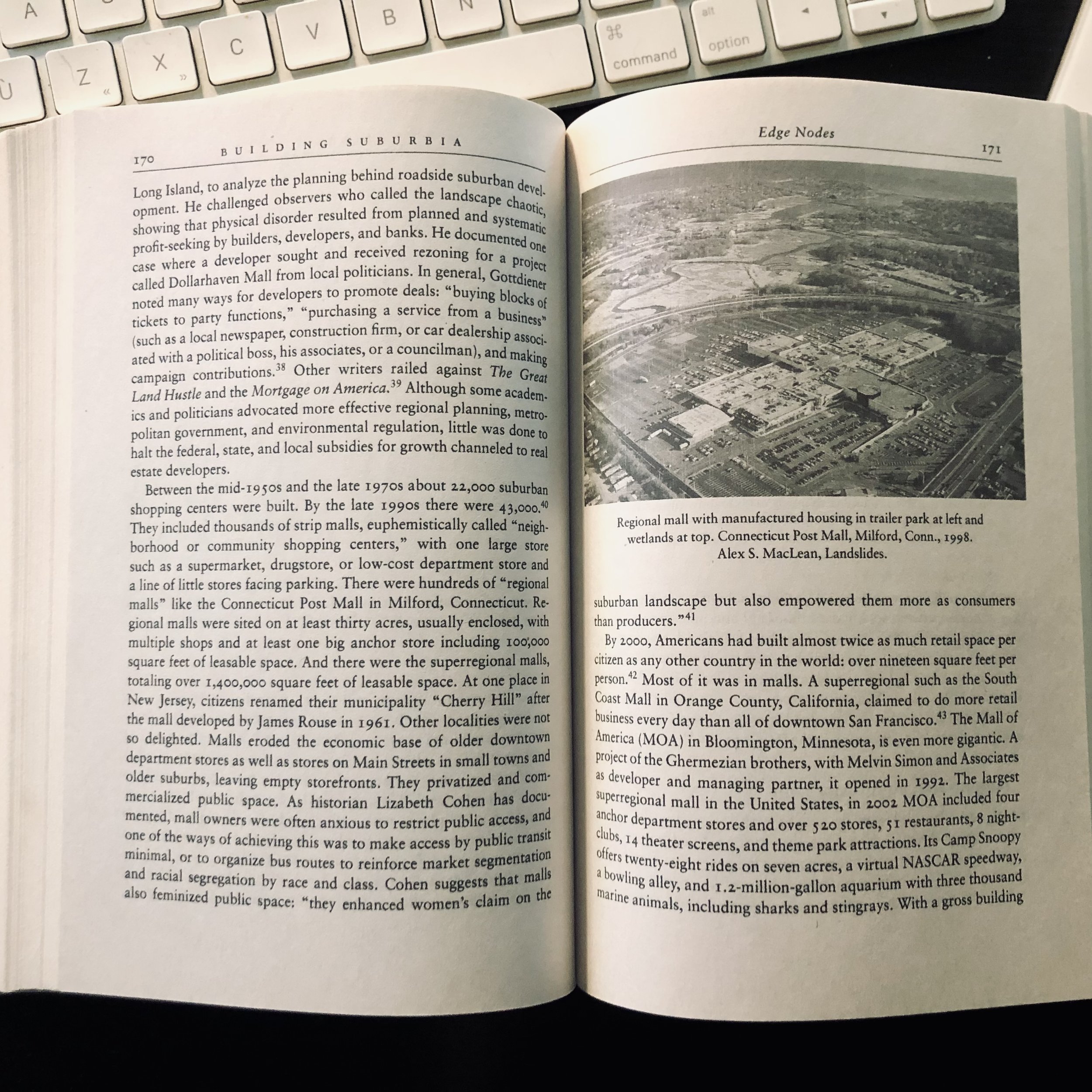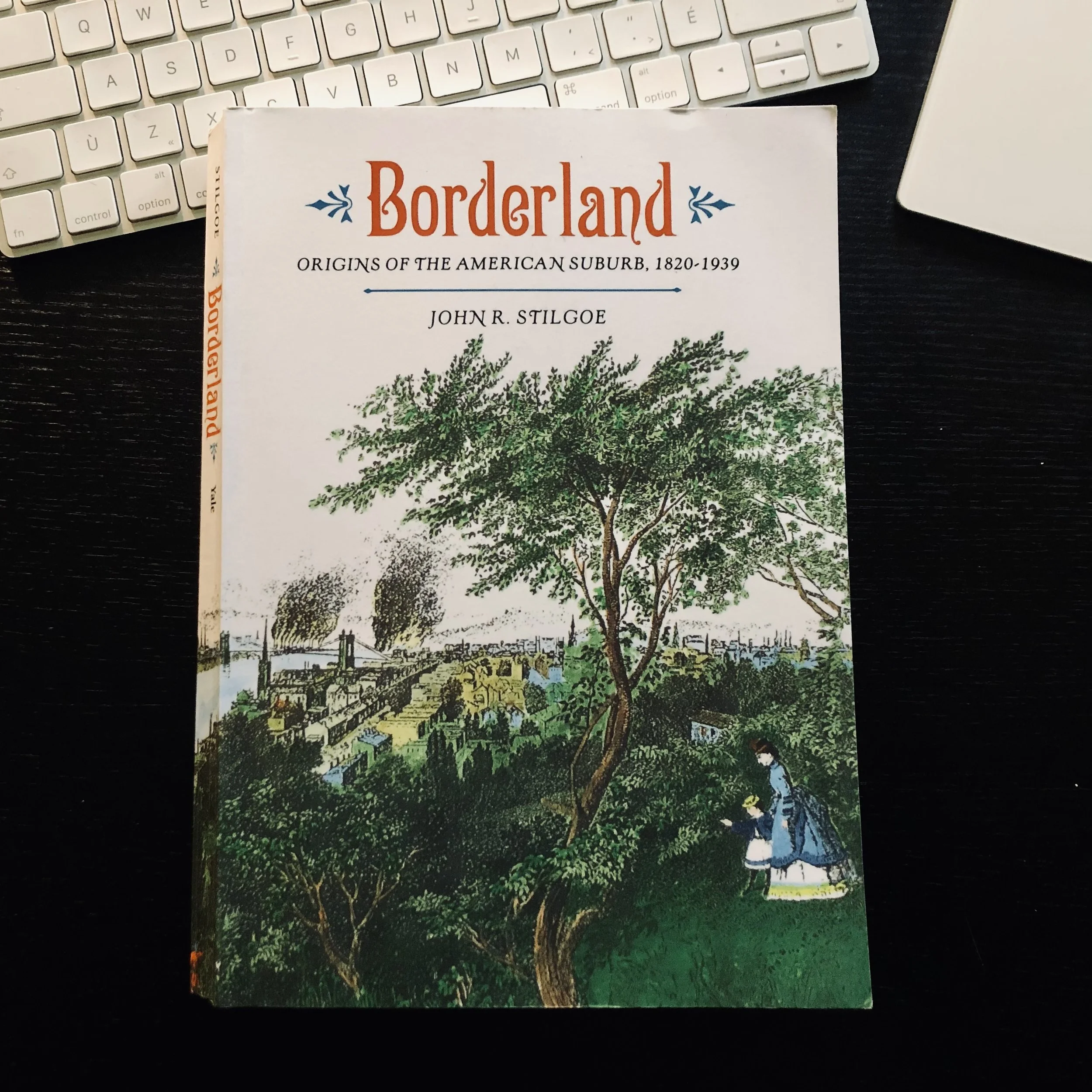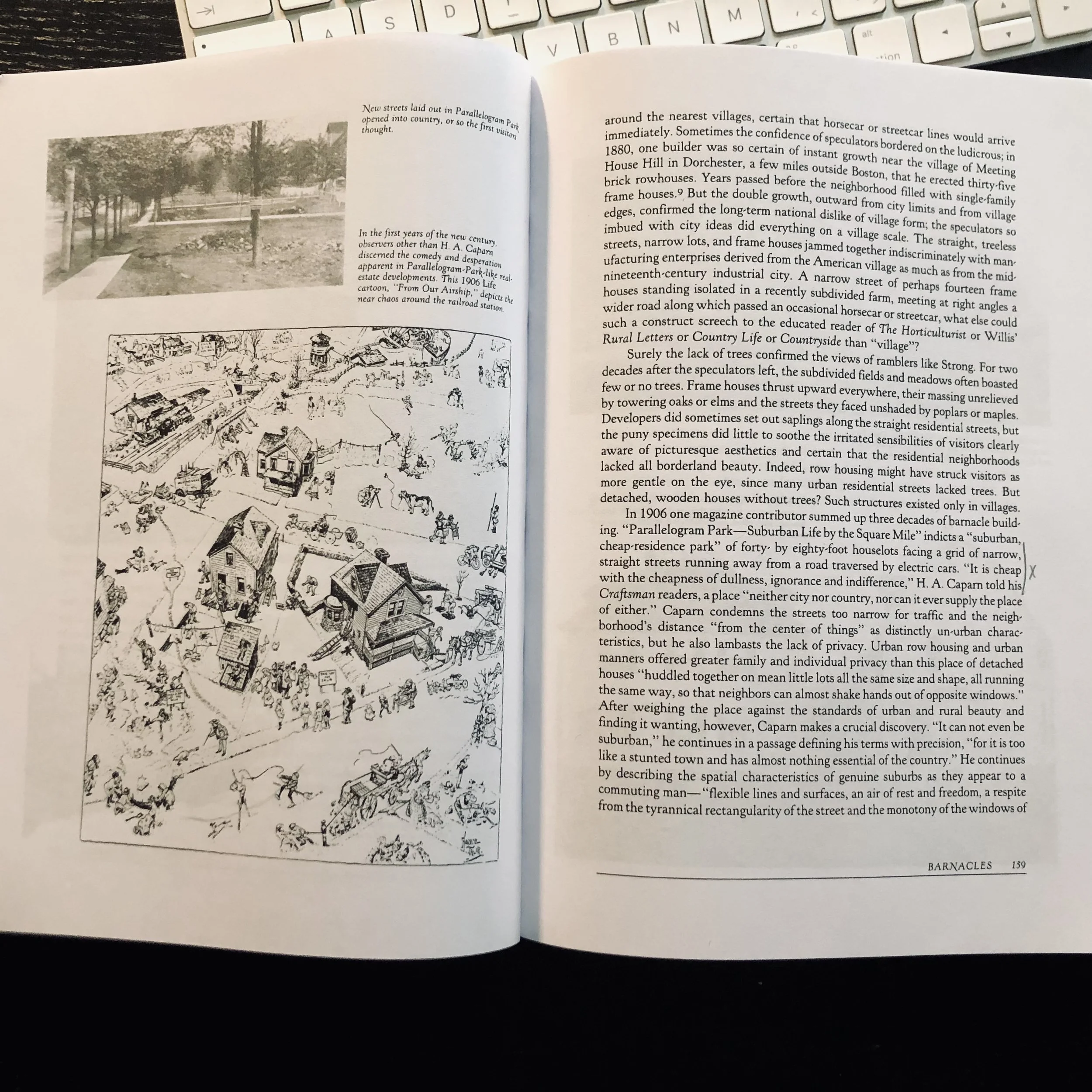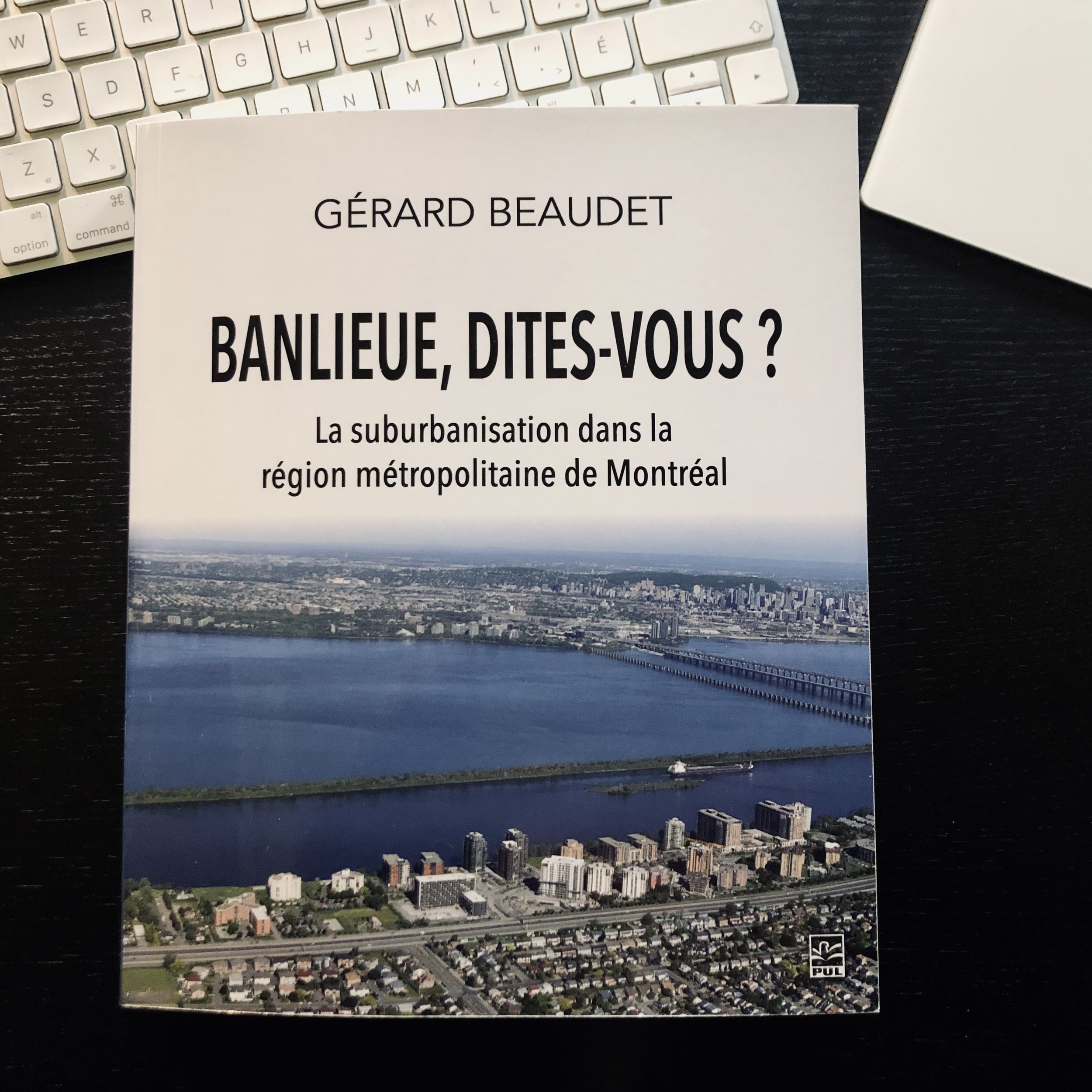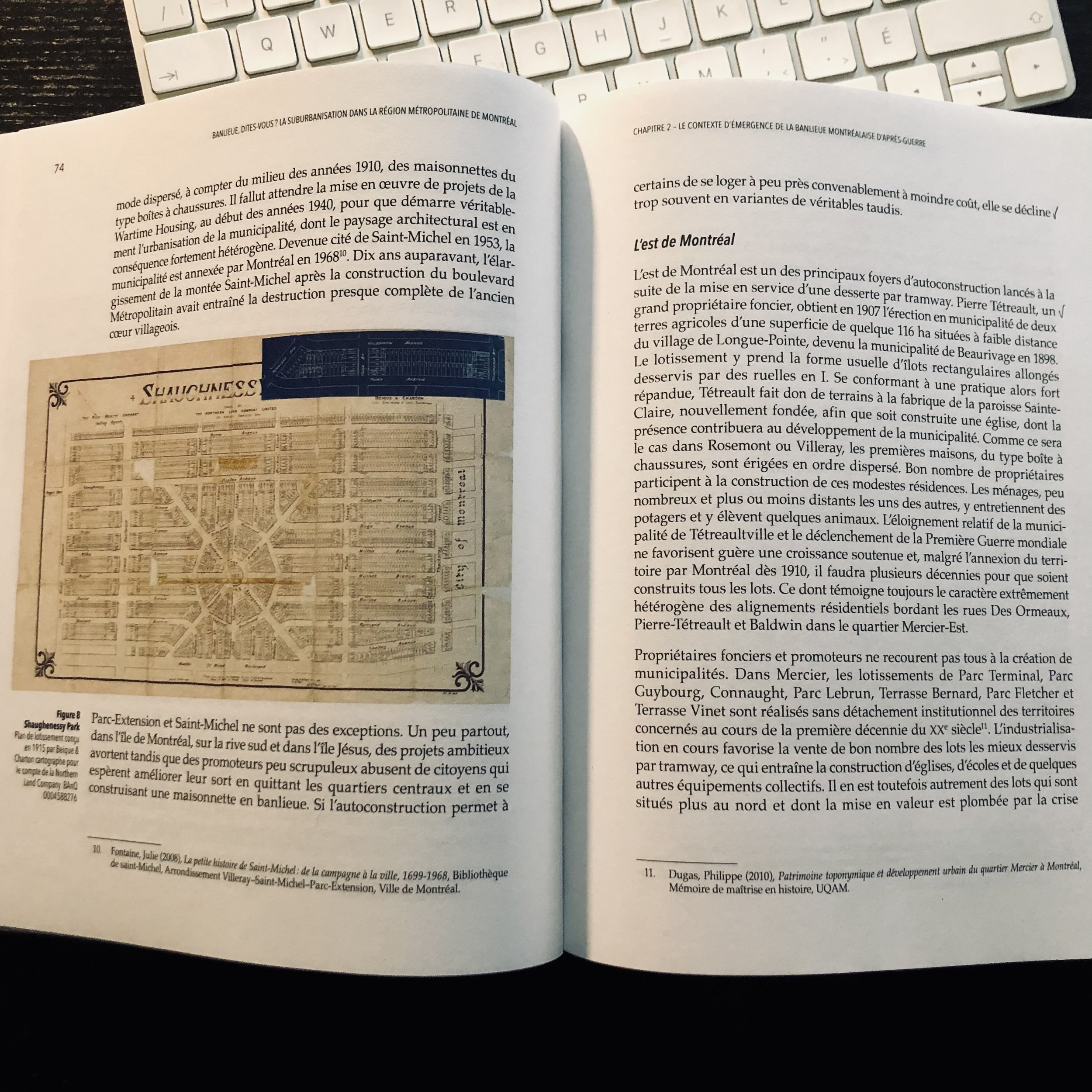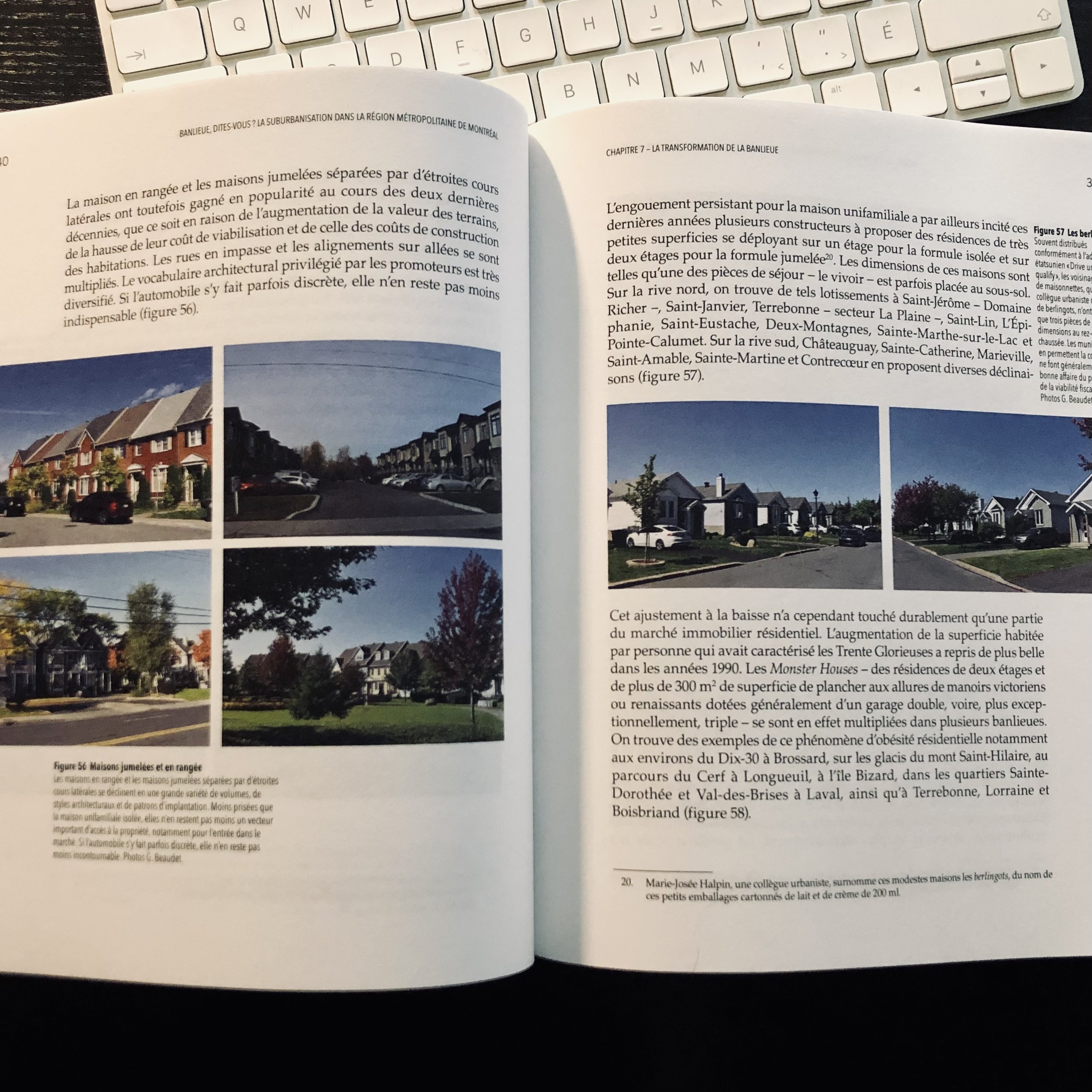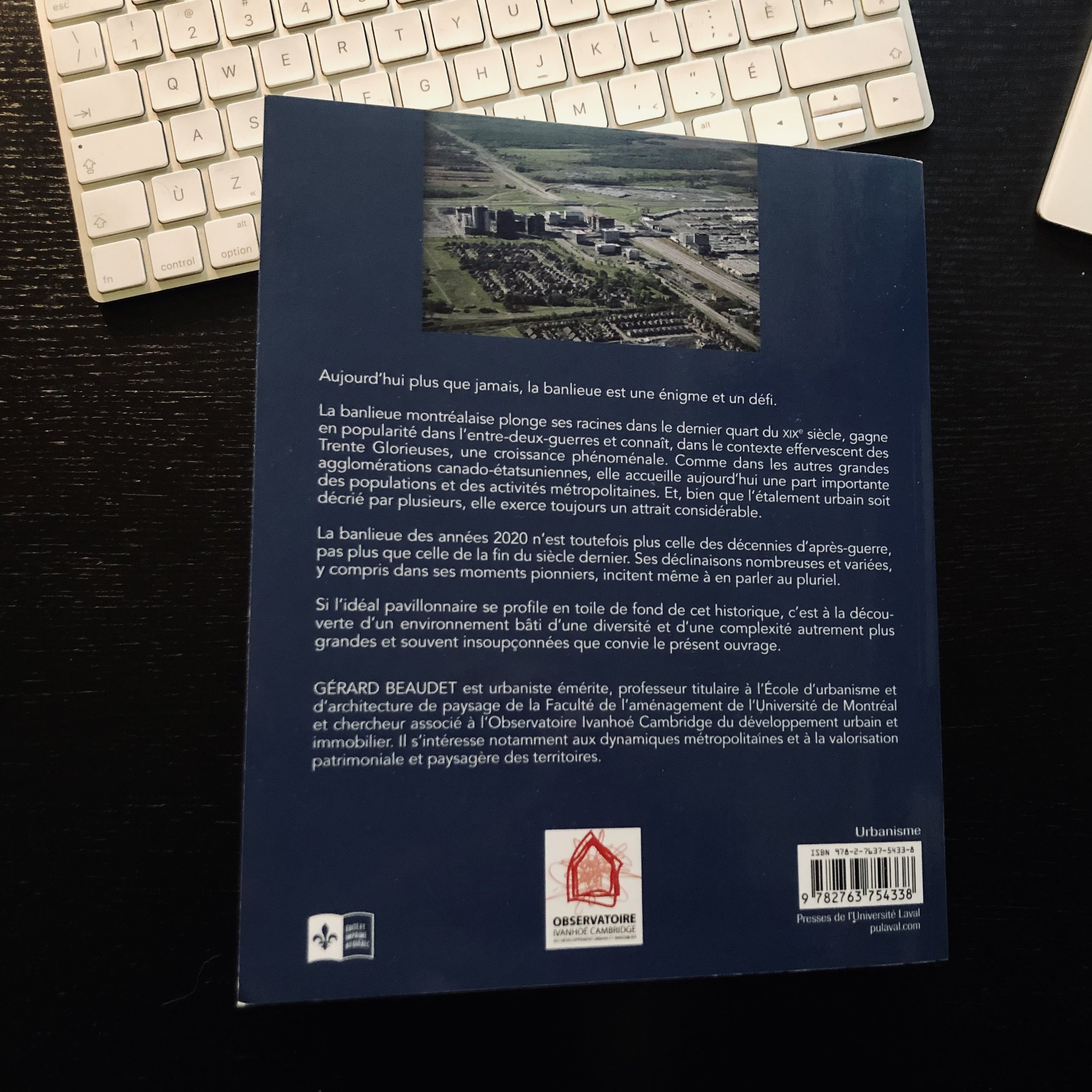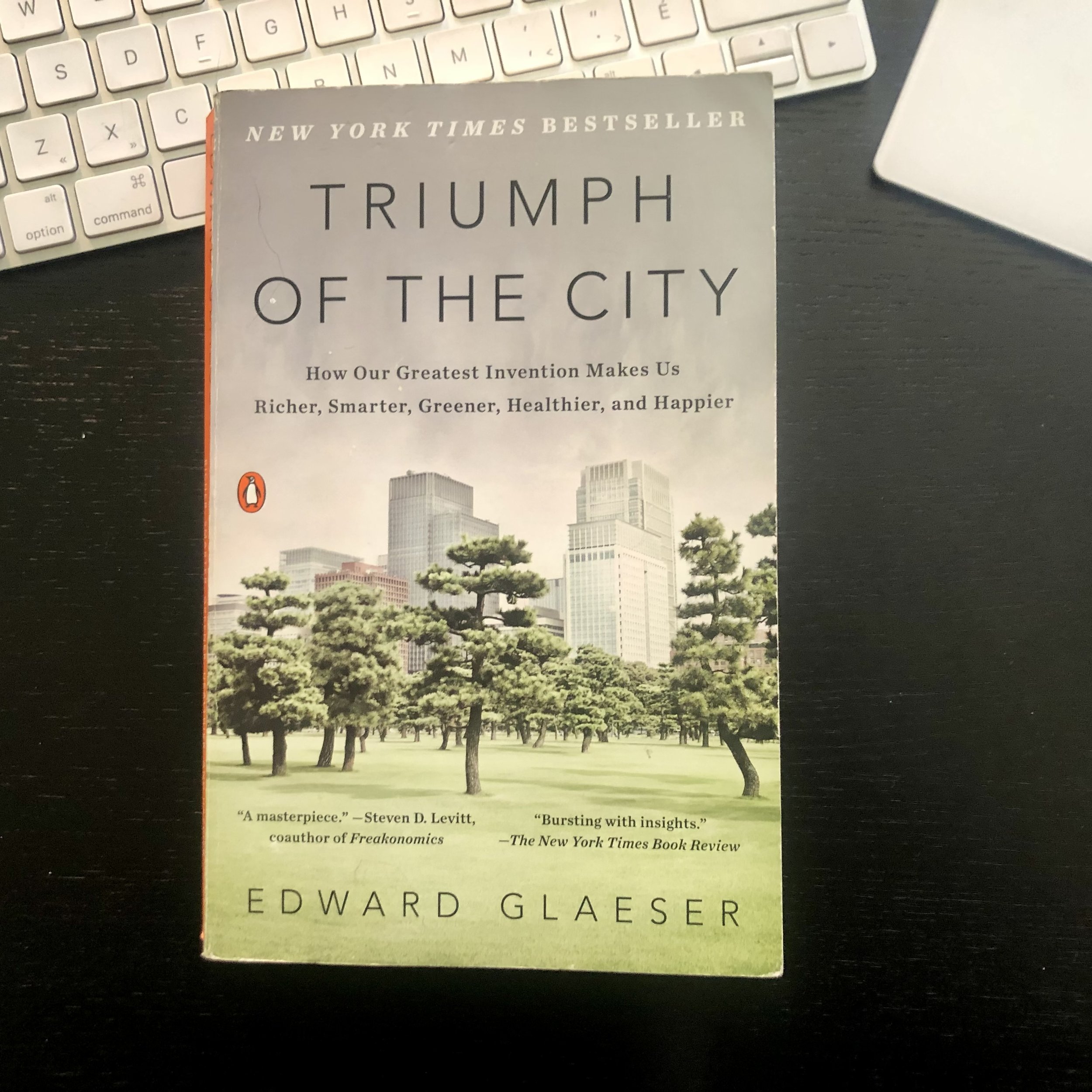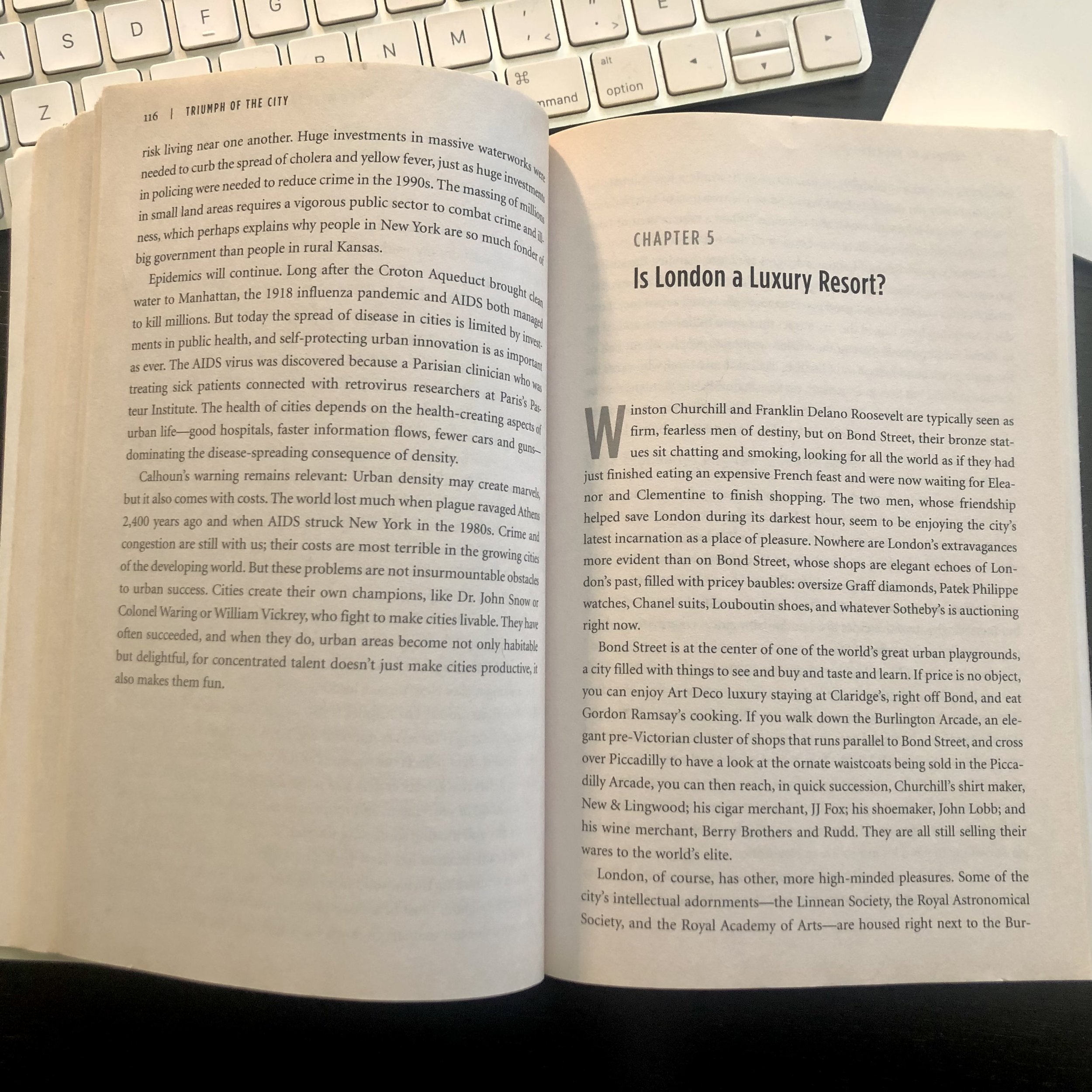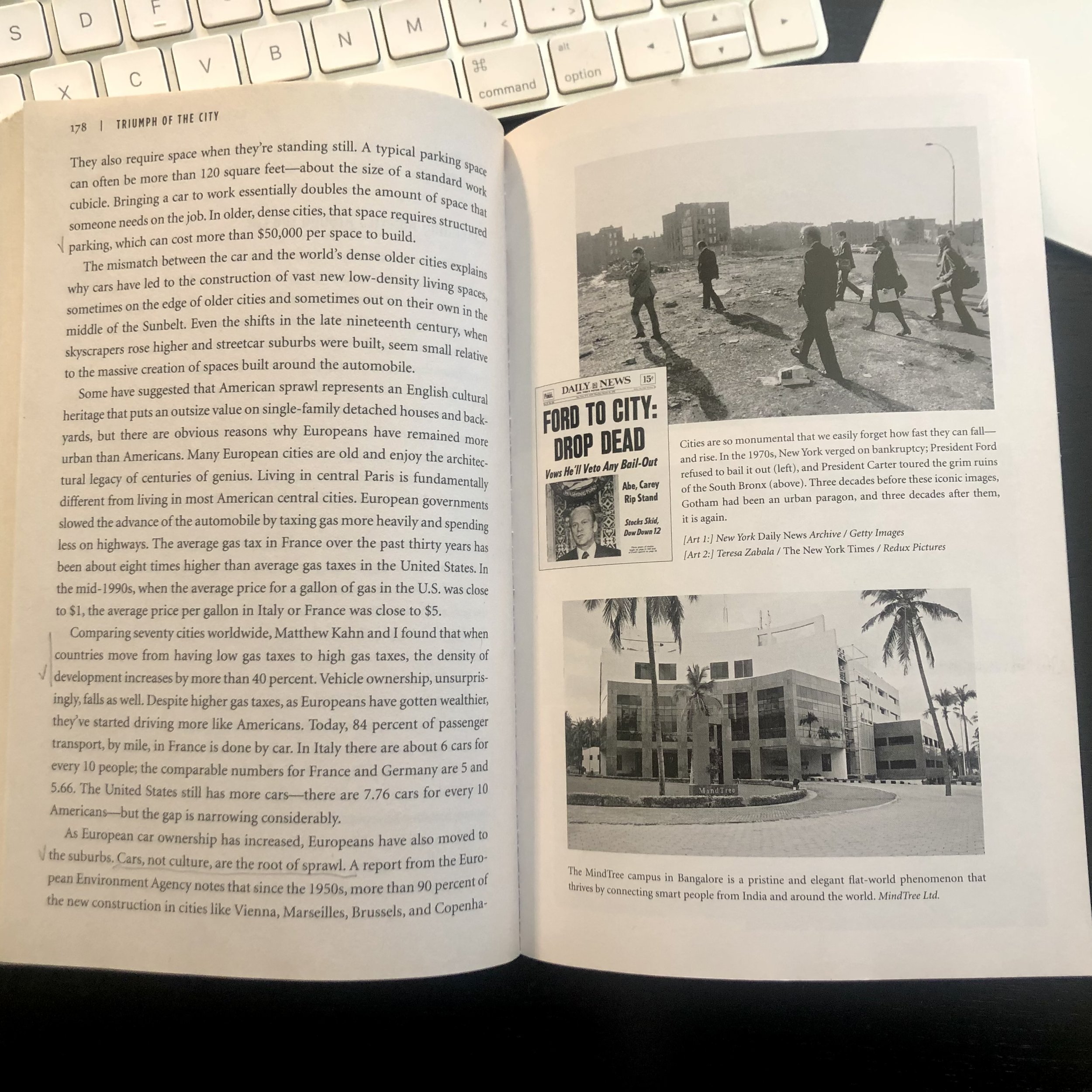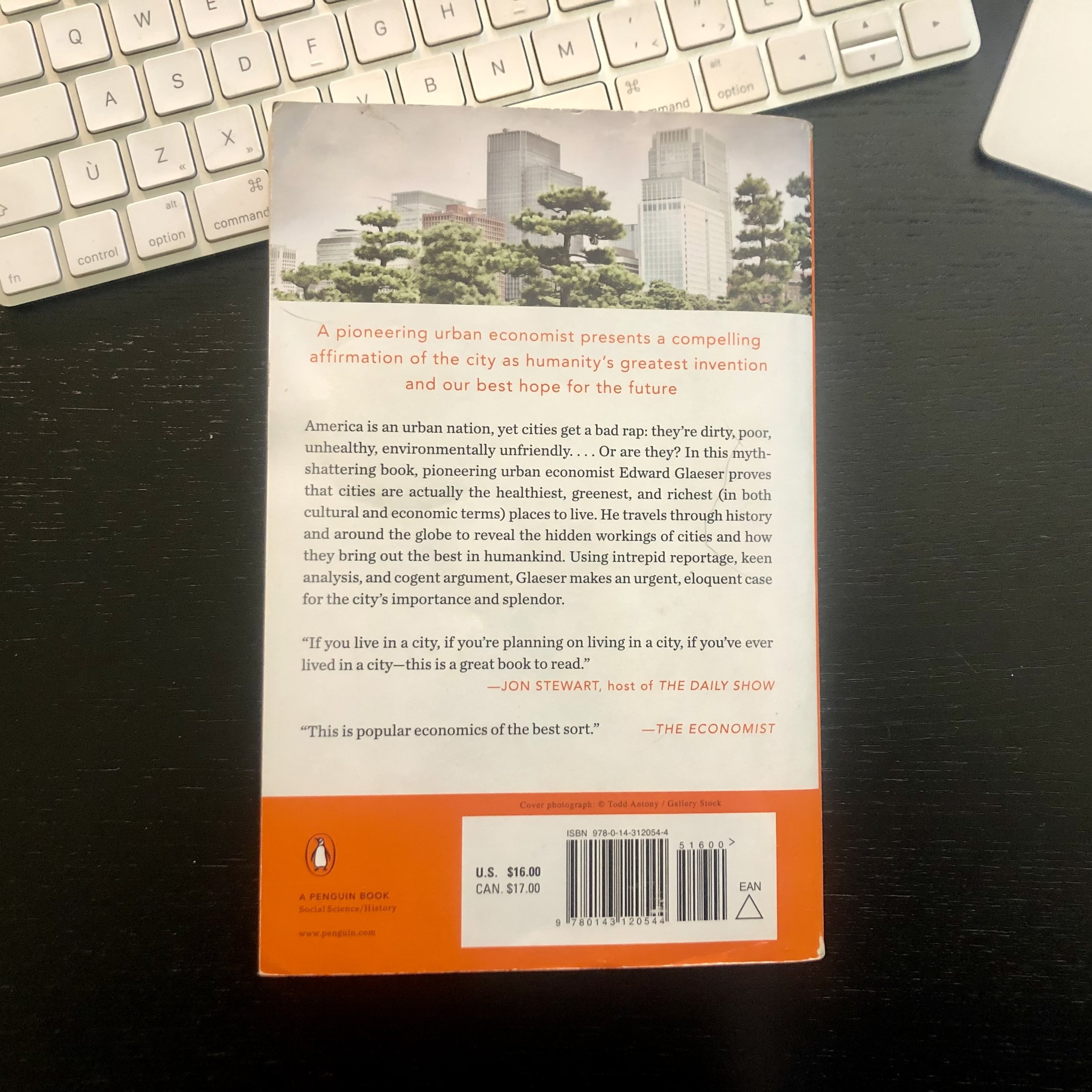Still Renovating—A History of Canadian Social Housing Policy. Greg Suttor, McGill-Queen’s University Press, 2016, 316 pages
Deuxième (2) de la série Habitation et logement
Il est à la fois salutaire et assez incroyable qu’un livre sur l’histoire des politiques, des programmes et des réalisations en logement social au Canada existe. Bien simplement, le Canada est passé proche de manquer le bateau, puisque comme le souligne l’auteur, ce n’est que de manière assez tardive, et un peu sur le tard, que le gouvernement fédéral a finalement mobilisé ses ressources pour le financement et la production significative de logements sociaux. En comparaison de ses pays pairs, le Canada a pour de nombreuses années après la Deuxième Guerre, démontré un retard assez marqué, qui n’a commencé à se combler qu’au milieu des années 1960. Avant ce moment, les rares programmes se concentrent sur les vétérans et pour le reste, vive le marché! (Appuyé par la Central Mortgage and Housing Corporation—CMHC.)
Mais après la description de ce départ moins que canon, l’auteur nous fait l’histoire de ce qui fut les trente glorieuses du logement social au Canada. Comme pour confirmer ce retard qui caractérise le système canadien, on doit préciser qu’on parle de la période qui va de l’adoption des amendements à la National Housing Act, en 1964 par le gouvernement minoritaire Pearson et prend fin avec la décision de décentralisation et de désinvestissement (devolution and retrenchment) du gouvernement Chrétien, en 1995-96. En termes d’implantation et de réalisation, cette période de 30 ans est superbement canadian, avec ses accommodements et ses incarnations multiples, qui se collaient si étroitement aux mouvances particulières à chaque province. L’Ontario domine (par le volume et une gestion provinciale, avec l’OHC) et le Québec ne veut pas être en reste (création de la SHQ), sans toutefois mobiliser des ressources équivalentes.
Dans cet ouvrage, le lecteur n’a pas à se contenter d’une reddition de recherche basée sur un épluchage d’archives, mais bénéficie plutôt de l’organisation originale et de la présentation claire d’une histoire nécessairement complexe, par un auteur qui a manifestement une connaissance profonde, matérielle et pratique du domaine. Cette histoire est ainsi présentée de façon à s’intégrer dans la trame des mouvements politiques propre au Canada, qui a façonné de manière si particulière la production du logement social au pays.
Sur les trace de Still Renovating
Les dix premières années des trente glorieuses du logement social au Canada est caractérisé par une production de type «grands ensembles» avec une assez forte concentration de gens dans le besoin sur un même site. Mais très vite, dès le début des années 1970, la politique fédérale fait un virage qui privilégie les organismes à but non lucratif et les groupes coopératifs de tout genre (autour d’une cause sociale, d’un groupe d’intérêt ou ethnique, d’une organisation syndicale, etc.) L’enthousiasme pour cette sorte de structure dans la fourniture du logement social, qui devient alors, dans le meilleur des cas, un logement de type mixte, entraîne toutefois une diminution notable dans la clientèle défavorisée en mesure de bénéficier de cette aide. On s’éloigne d’une politique de logement comme d’un droit; c’est plutôt un logement pour qui a les bons contacts au bon moment auprès des organismes fournisseurs. Si l’on exclut de ce calcul la clientèle avec besoins spéciaux (aînés, autochtones, anciens combattants, etc.), l’on se retrouve avec une capacité de production encore plus insignifiante par rapport aux besoins et à la demande. Les crises récurrentes du logement qui caractérisent ce premier quart de 21e siècle en sont la preuve.
Si nous sommes pour reprendre en main cette situation, actualiser une production et une rénovation de logements dignes de la pluralité des besoins, correspondant aux normes contemporaines de développements durables, certaines pistes sont à favoriser. Il faut reprendre la production sans recréer les ghettos de pauvretés qui sont devenues synonymes des logements sociaux passés. Pour s’assurer d’obtenir une mixité des clientèles (âge, revenu, avec/sans emploi) et des besoins desservis (catégories de ménages, statut légal, handicap physique ou mental), il est primordial de rendre ce logement social à la fois indiscernable et hautement désirable, même recherché comme mode d’habitation urbain. Surtout, cela évitera à long terme la spirale identitaire qui vient dévaluer et stigmatiser ce type de logement comme indésirable et accessoire, lorsqu’il est dans les faits essentiel pour un marché efficace.
Il est temps qu’une entité publique, à l’échelle métropolitaine, se dote de cette mission et commence sérieusement la production de logements sociaux mixtes.
Lundi prochain (6 juin), on poursuit la série Habitation et logement avec 6000 Years of Housing
(2022-06-09) Léger contretemps dans la poursuite de la série qui devrait se résorber la semaine prochaine !