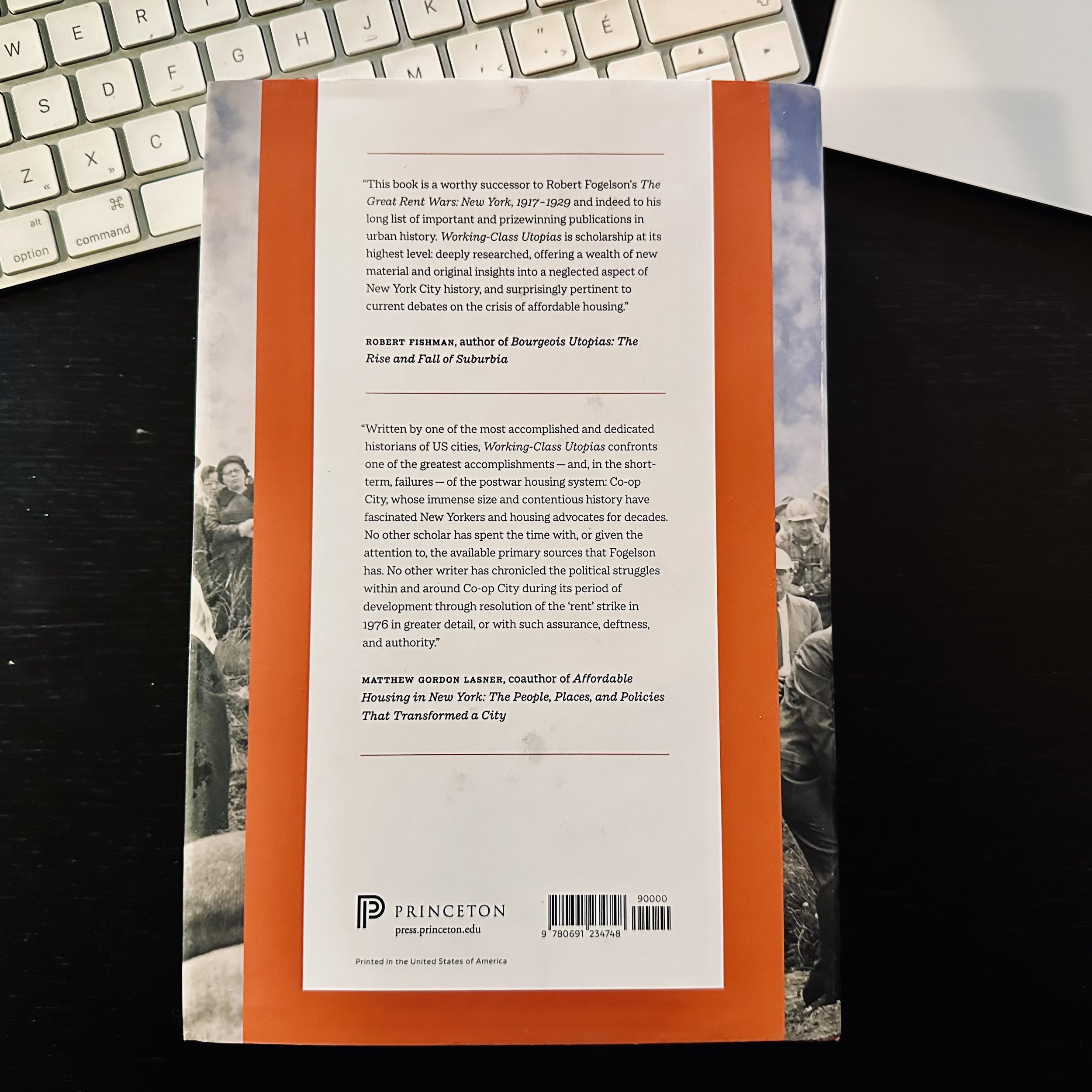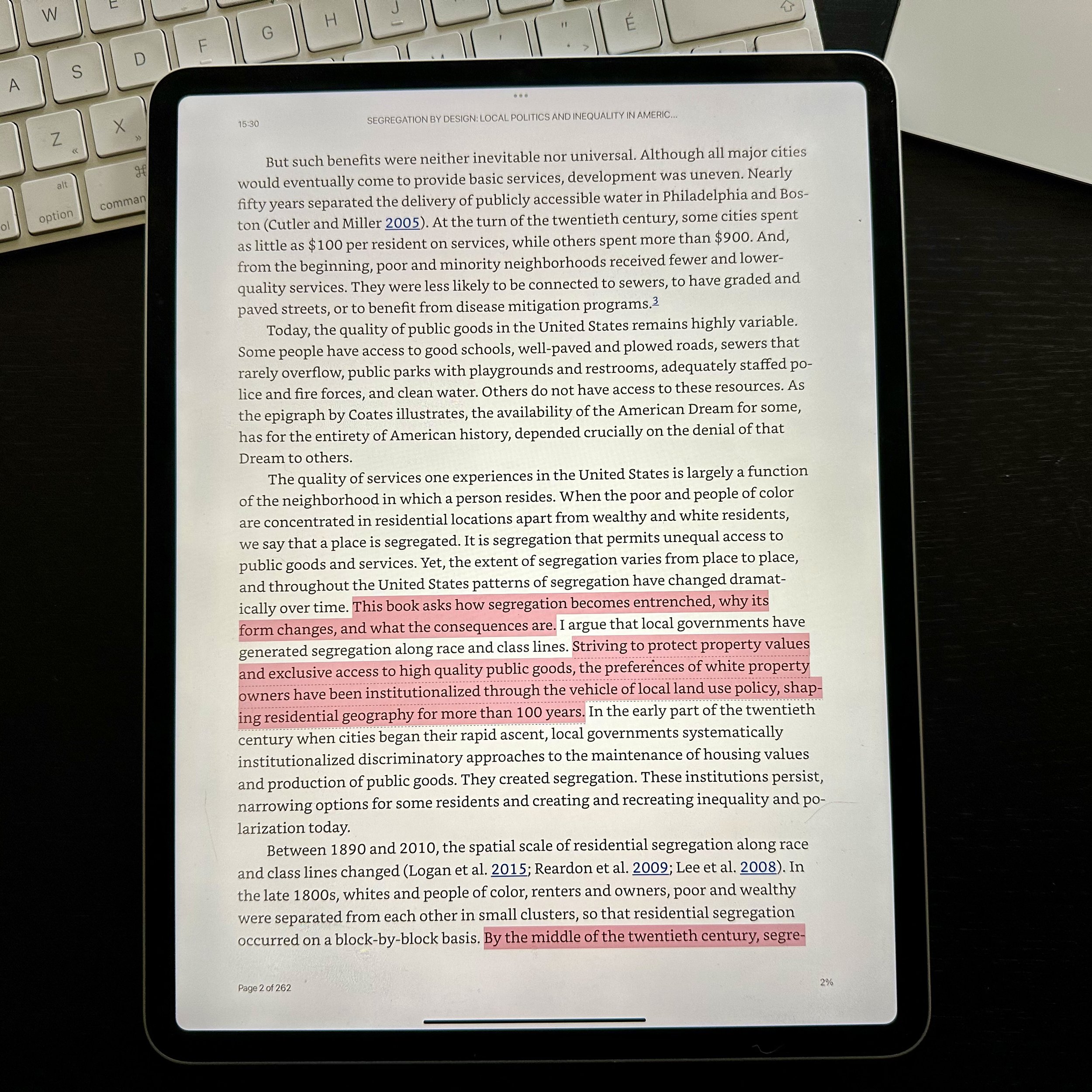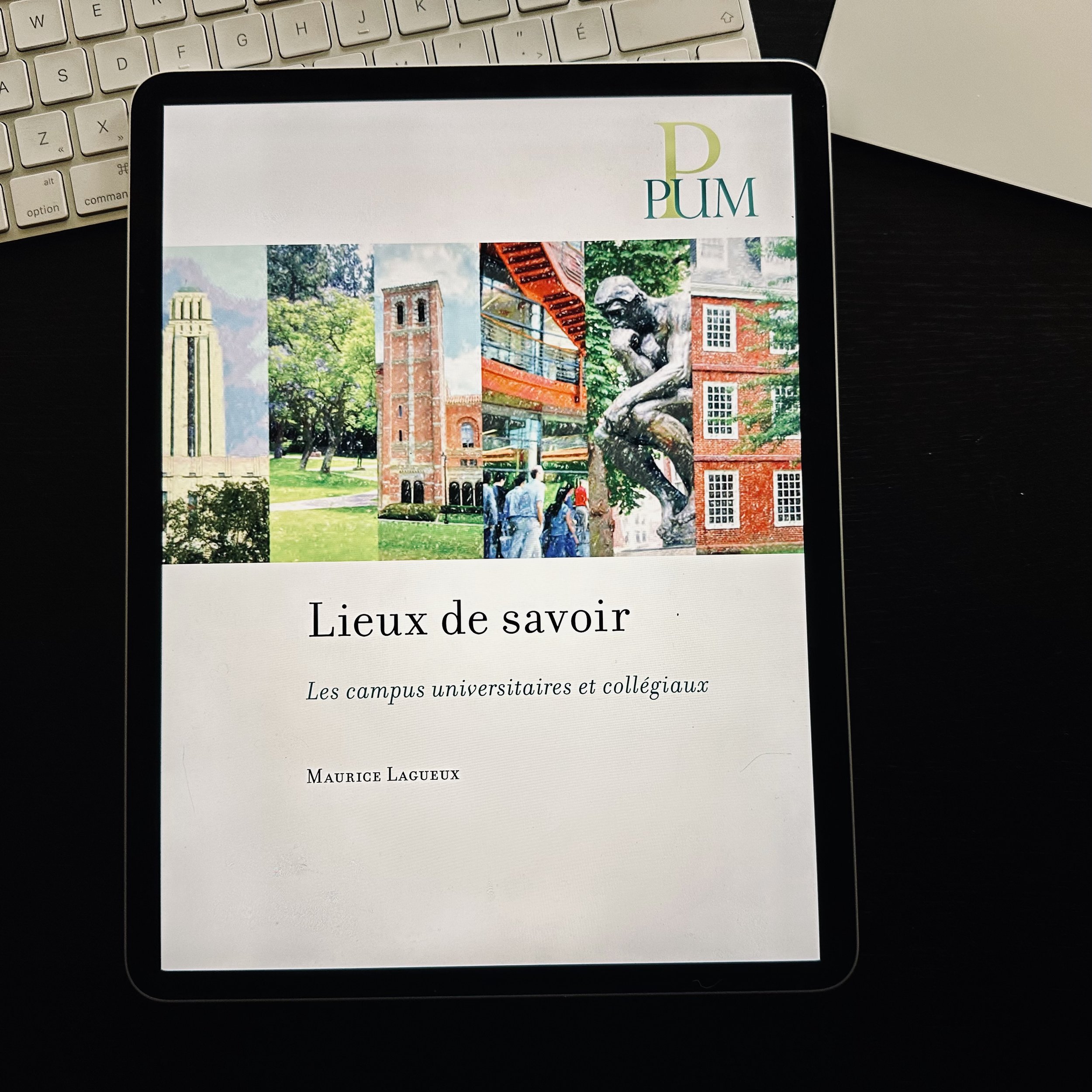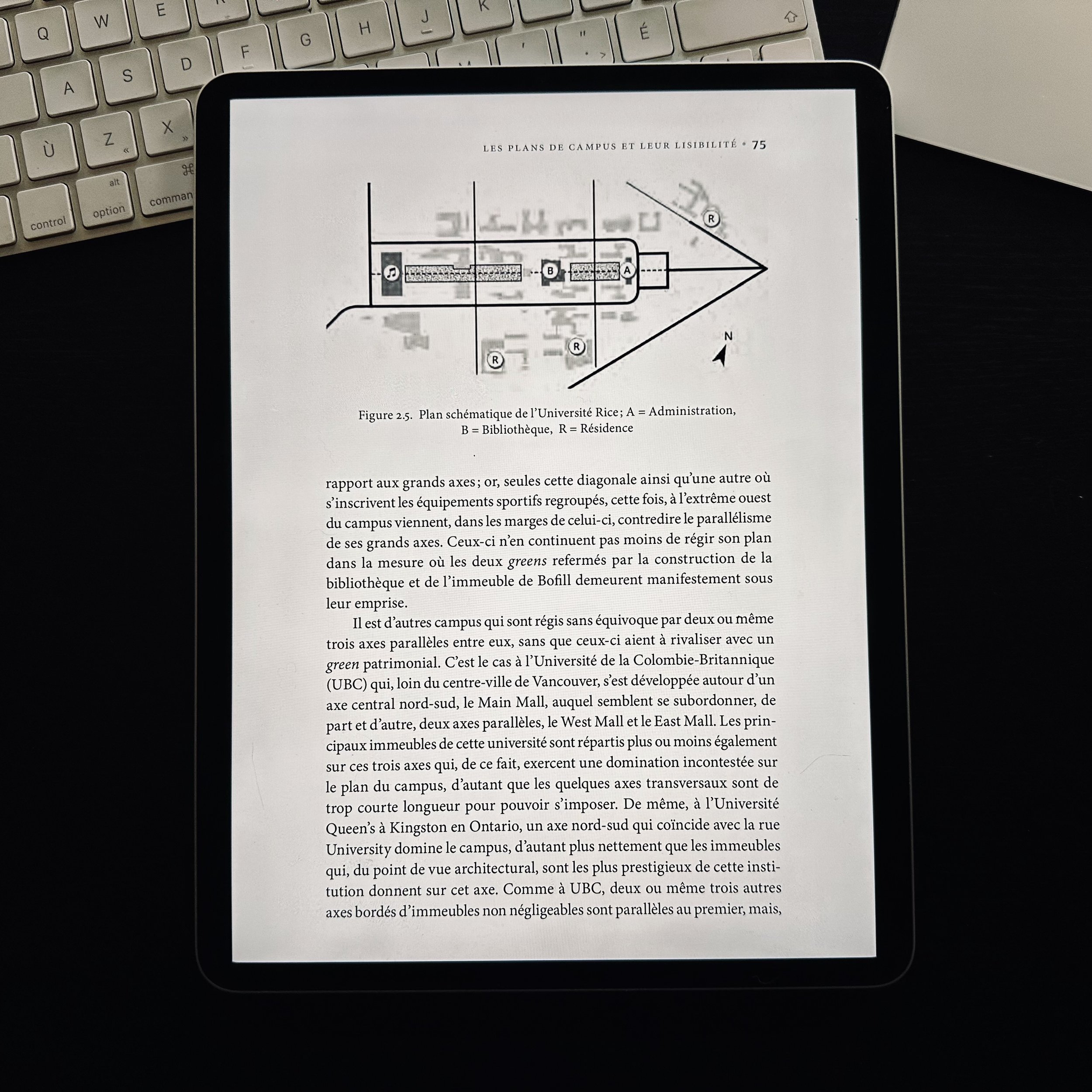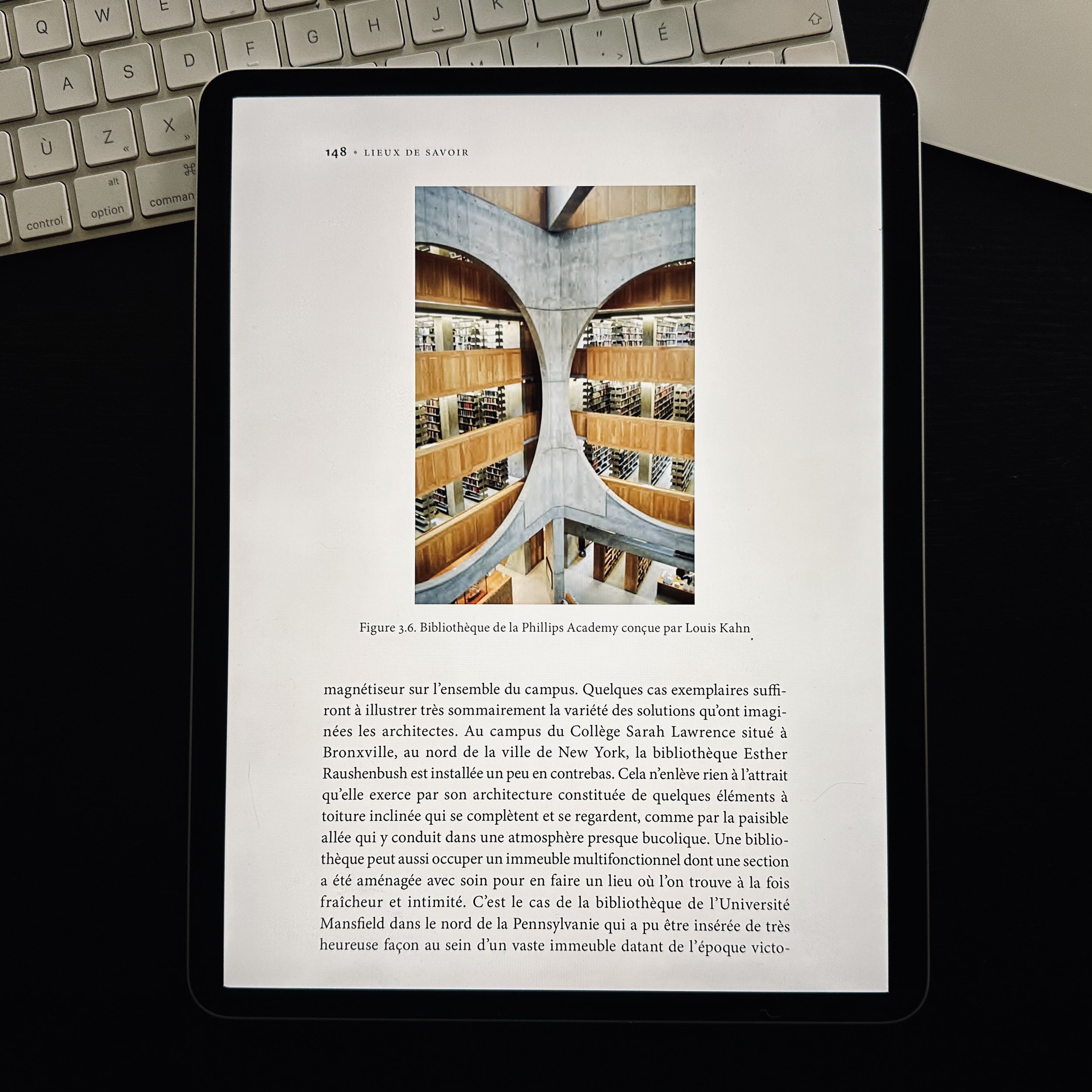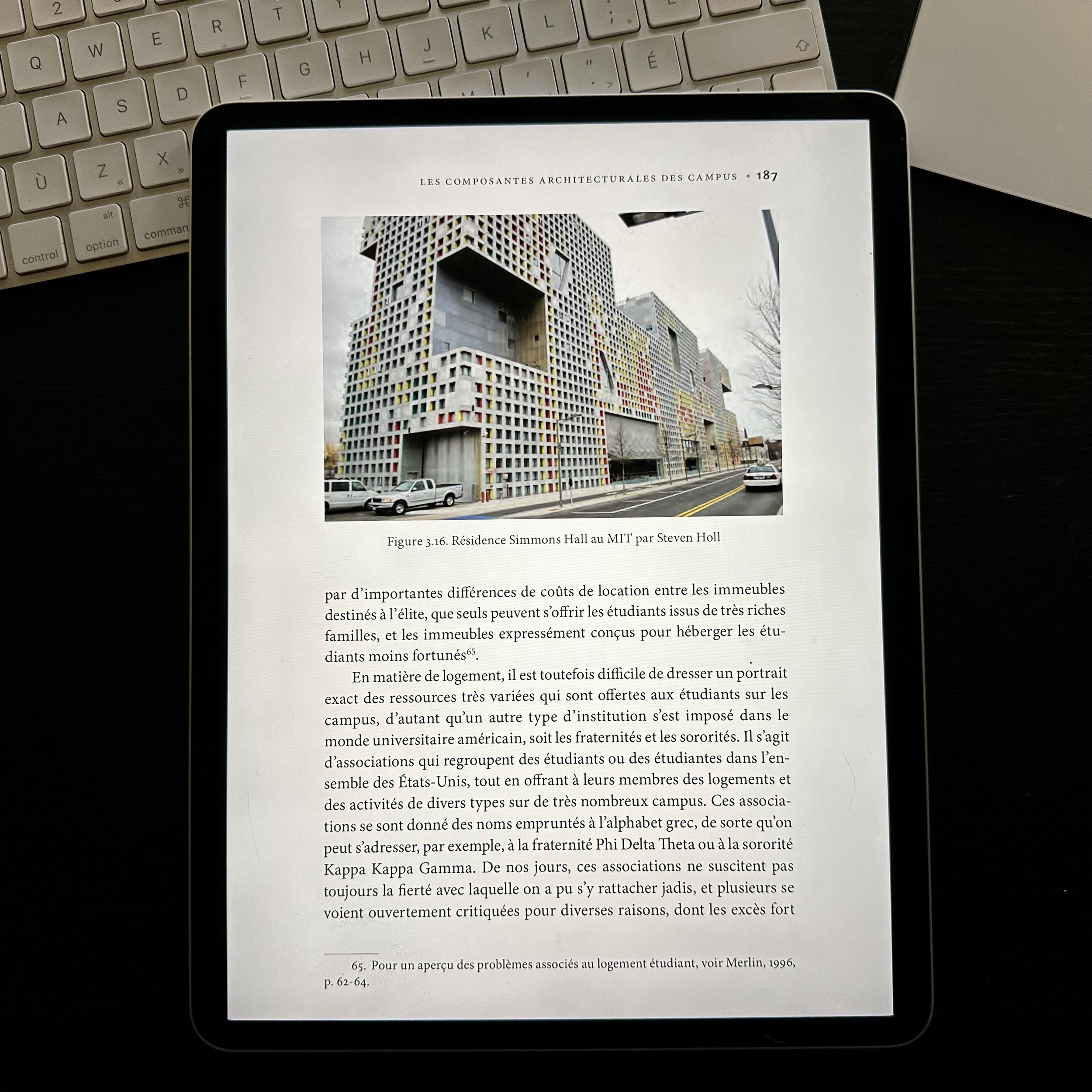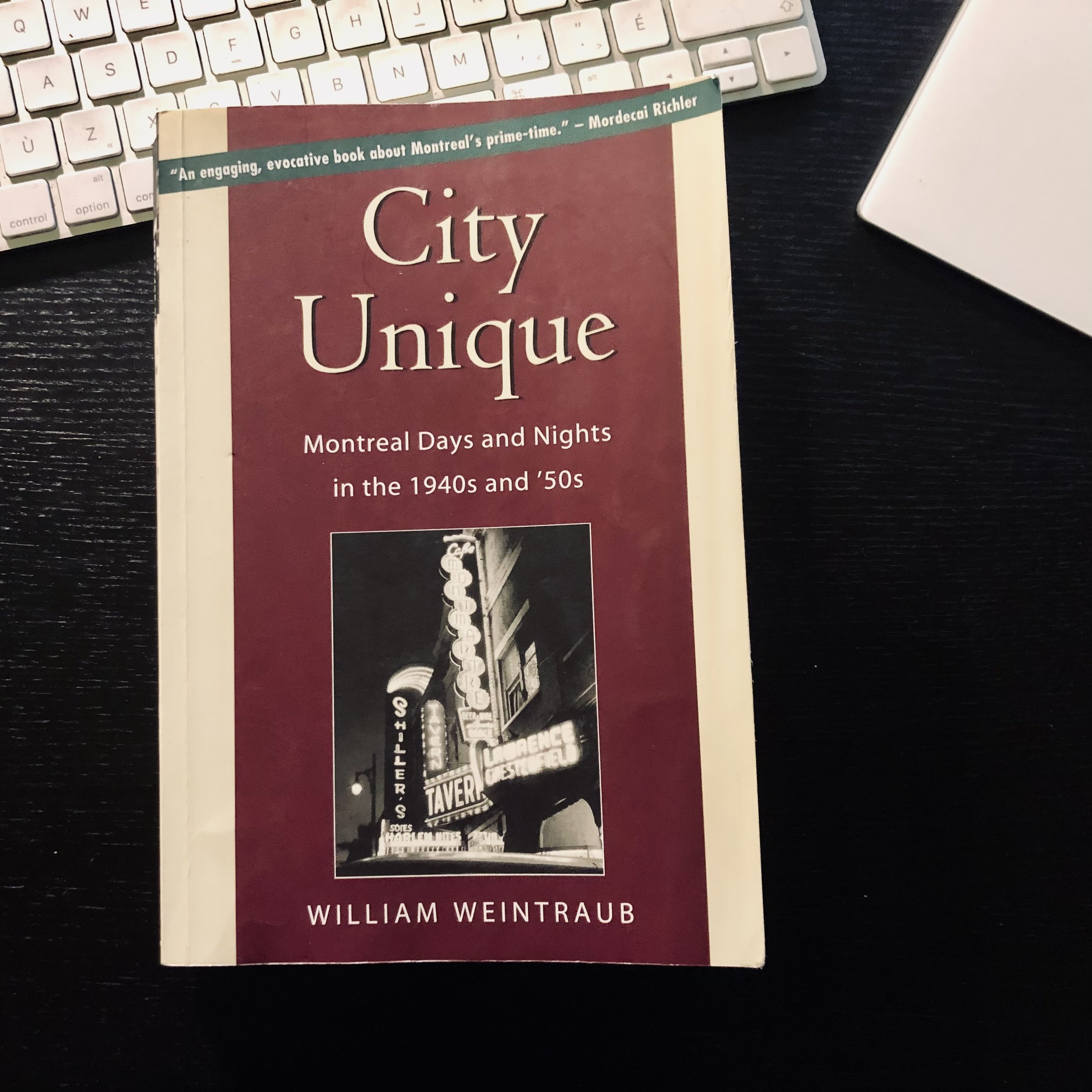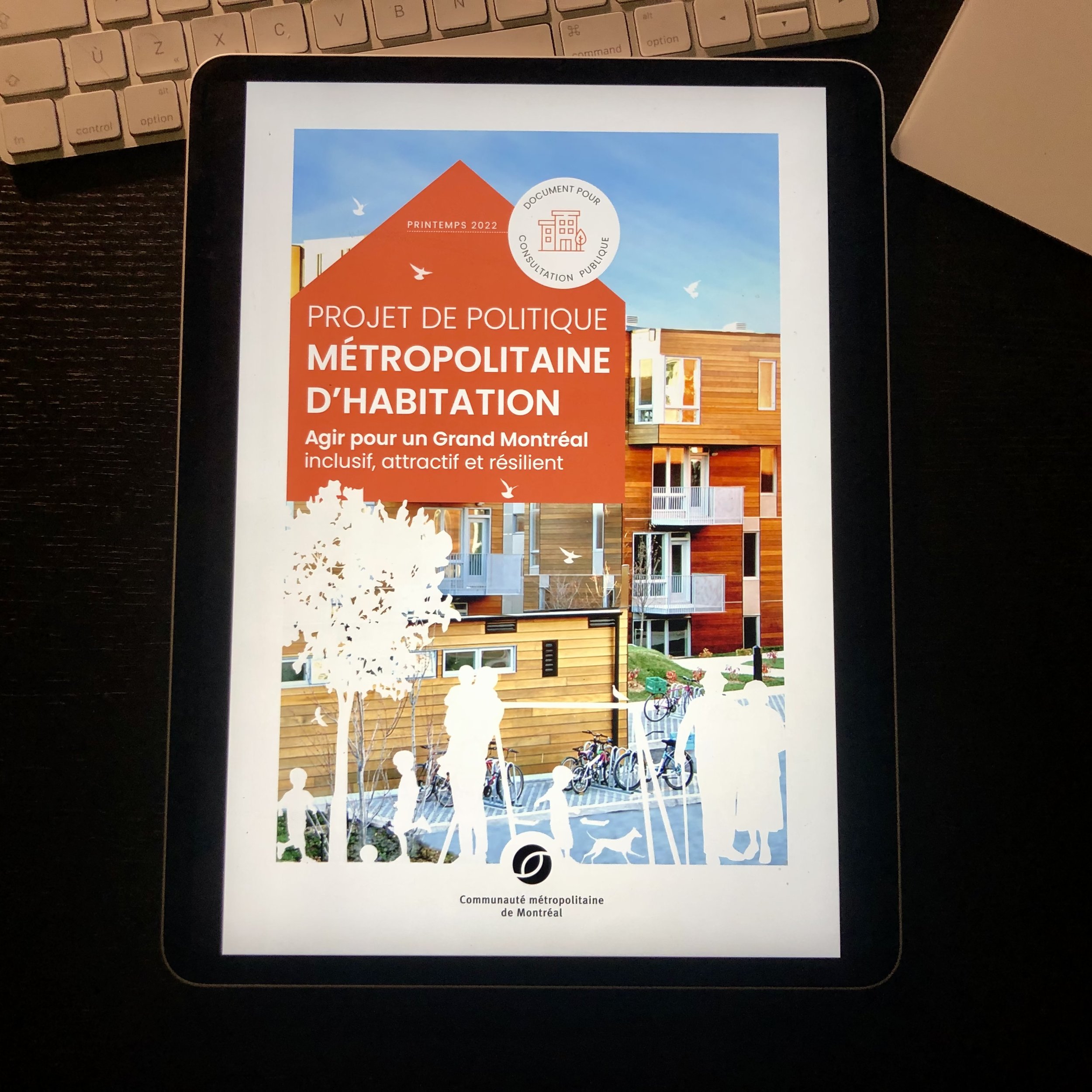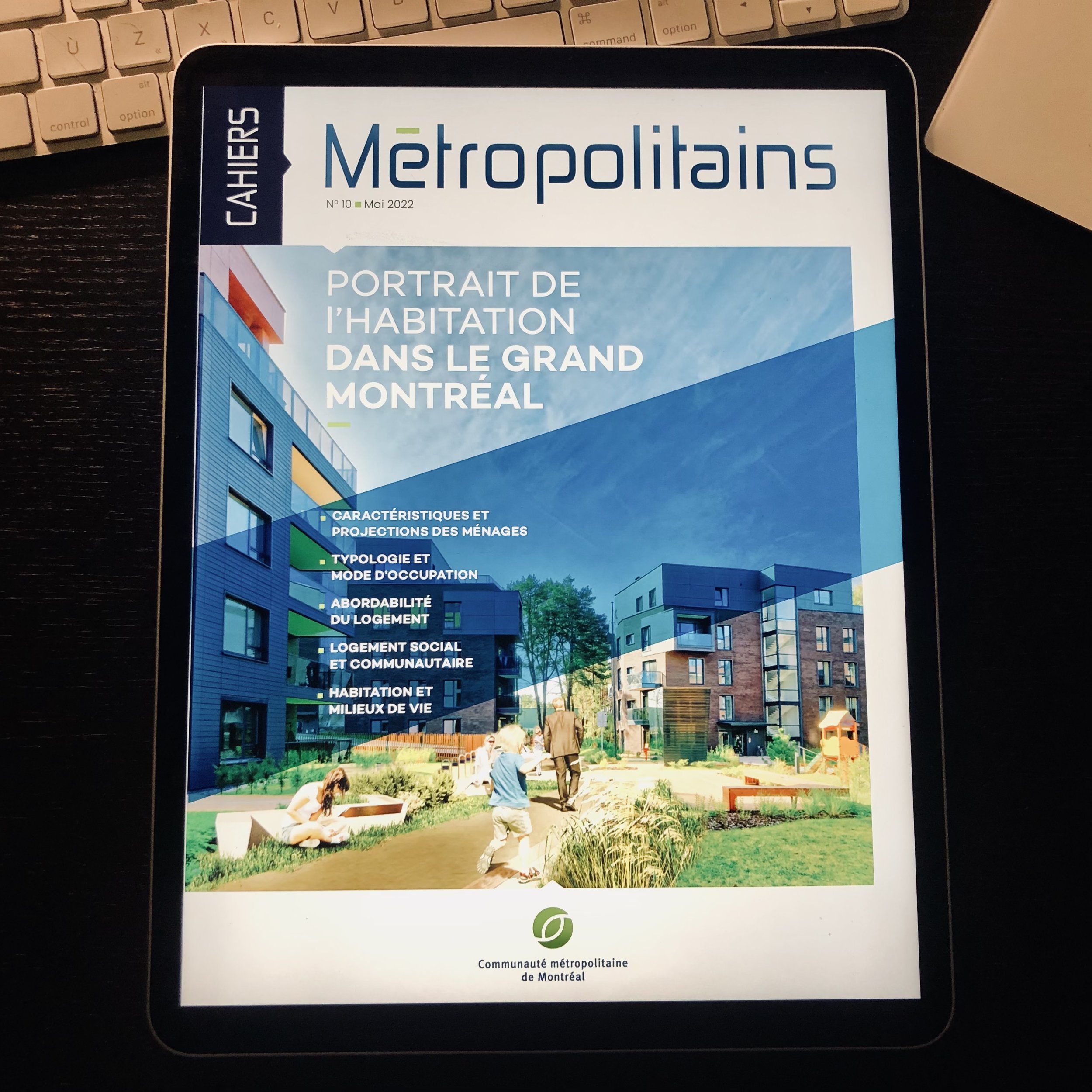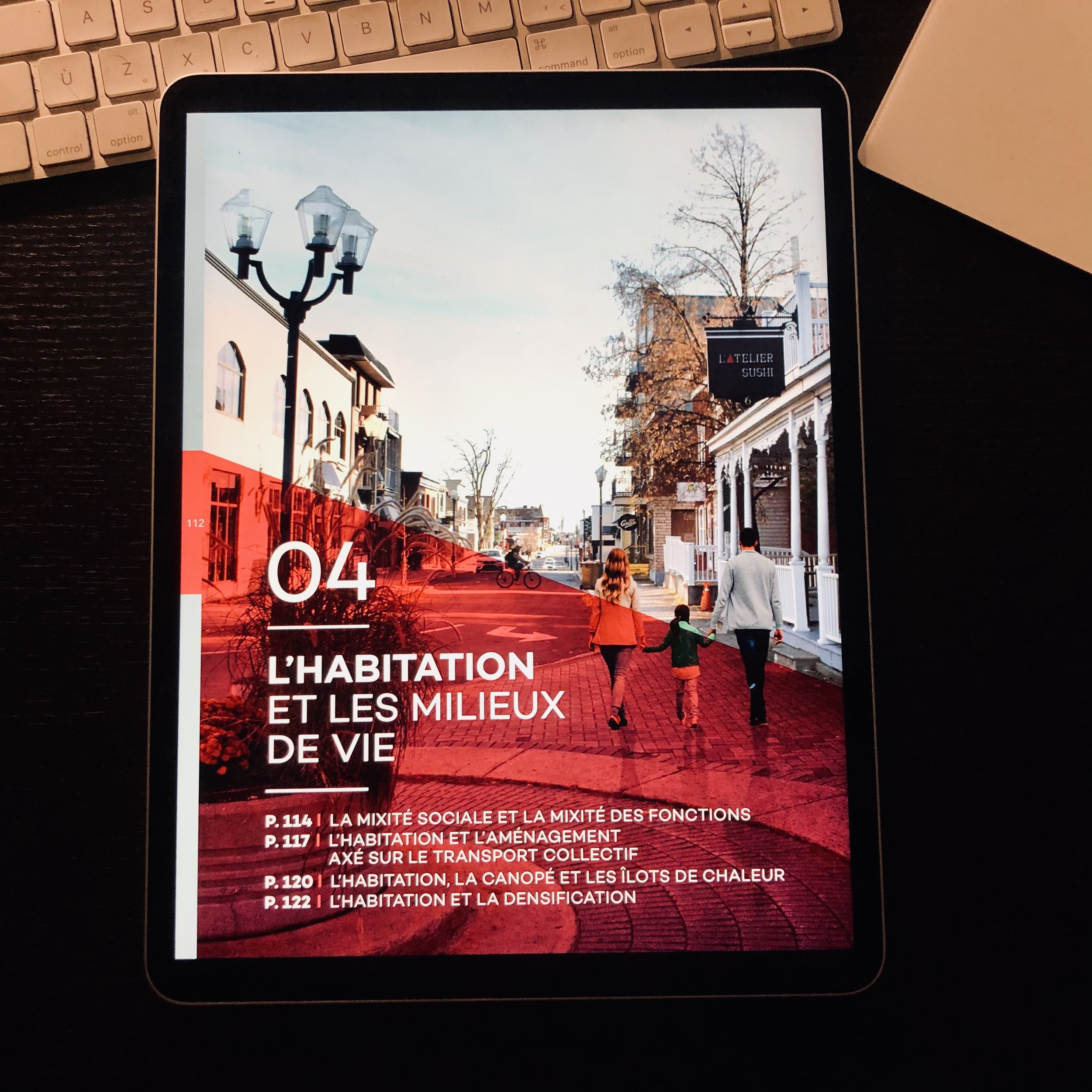The Decorated Tenement—How Immigrant Builders and Architects Transformed the Slum in the Gilded Age. Zachary J. Violette, University of Minnesota Press, 2019, 279 pages
Cette chronique fait partie de notre série Housing in NYC [4/5]
Il est plutôt difficile de trouver dans la littérature (architecturale, historique, urbaine, de santé publique ou sociologique) une perspective positive sur le sujet des tenements, ces immeubles à multiples logements, typiquement de 4-5 étages, souvent sans ascenseur, des équipements sanitaires parfois rudimentaires, mais avec des espaces commerciaux au rez-de-chaussée ou en demi-sous-sol.
Leur heure de gloire commence vers 1850-60, prend son élan vers 1880-90, avec cette dernière décennie comme l’apothéose de cette typologie urbaine, surtout à New York, mais aussi à Boston et d’autres villes de Nouvelle-Angleterre. Des modèles continueront d’être perfectionnés jusque dans la première décennie du 20e siècle, mais une série de changements, réglementaires et démographiques, entrainera un déclin précipité à l’orée de la Grande Guerre.
Quelques décennies plus tard, lorsque la tendance sera au Slum clearance et qu’on cherchera ainsi à faire de la place en ville pour les tours d’habitations «dans un parc» ou pour le passage des nouvelles autoroutes, c’est le plus souvent dans ces quartiers urbains structuré autour des tenements, densément habité et utilisé de façon productive, toujours caractérisé par une culture et une économie locale vigoureuse et au potentiel régénérateur puissant, qui seront tragiquement et terriblement rasés. L’urbanité perdue durant ces «grands chantiers», au nom de la modernité, est une perte qu’il est difficile de qualifier et qui nous fait probablement encore très mal. Comment pouvons-nous l’affirmer? Simplement parce que nous constatons que les quartiers urbains de ce type qui nous sont parvenus sont encore parmi les plus productives et dynamiques.
L’ironie cruelle est que même durant l’apogée dans la construction des tenements, entre 1880-1900, il n’y a jamais eu de moments où ce type de bâtiment recevait l’aval ou même un regard favorable de la par des classes intellectuelles influentes, que ce soit en architecture, en santé publique ou de la par des groupes progressistes ou religieux qui se donnaient comme mission de «sauver», matériellement et spirituellement, les classes urbaines laborieuses, le plus souvent aussi nouvellement immigré. Dans ce contexte, comment expliquer l’omniprésence, dans les quartiers urbains d’alors, des tenements et dans le meilleur des cas, des decorated tenements?
Sur les trace de The Decorated Tenement
C’est à cette étape qu’un livre comme celui de Monsieur Zachary J. Violette se présente en guide parfait afin de retrouver l’histoire perdue derrière cette typologie urbaine si répandue. Par sa mise en contexte (historique, sociologique, architectural, urbaine) qui ne connait pas vraiment de parallèle dans la littérature, on peut comprendre et enfin voir ces trésors urbains à échelle humaine telle que ses bâtisseurs les envisageaient et de la manière dont les gens qui choisissaient d’y vivre pouvaient les percevoir et les chérir.
Ces immeubles ont pour la plupart été construits par et pour la population immigrante d’Europe centrale et de l’Est (Russie, Pologne et territoire maintenant ukrainien) qui affluait alors dans la métropole américaine, pour fuir les pogroms, mais aussi pour exercer leurs entrepreneuriats, ce qui était impossible à cause des législations explicitement antisémites dans leur pays d’origine. Dans ce groupe d’immigrants pauvres, mais extrêmement industrieux, on trouvait des entrepreneurs en bâtiment, des architectes, mais aussi beaucoup d’hommes de métier. Grâce aux institutions financières propre à la communauté, il était possible d’effectuer les montages nécessaires au développement spéculatif, du type des decorated tenements.
Sur le plan démographique et sociologique, c’était aussi une population qui provenait de zones urbanisées, de villes à la population qui appréciait déjà fortement la culture urbaine. Cette attitude se combine à la volonté de communiquer esthétiquement, avec un bâtiment aux proportions élégantes et à la décoration culturellement évocatrice (autant en façade que sur les surfaces intérieures communes, dans les pièces privées d’apparat des logements et dans les locaux commerciaux) le prestige de l’appartenance à sa communauté dans cette nouvelle grande métropole.
Même dans ce contexte, comment expliquer ces formes élaborées sur des bâtiments spéculatifs destinés à une population immigrante aux ressources limitées? Parce que les bâtisseurs et les architectes étaient familiers avec l’école allemande de la production architecturale décorative industrialisée et standardisée naissante. Ces nouvelles populations urbaines en Amérique avaient beau être pauvres, elle voulait vivre dans un cadre urbain qui projetait dans le domaine public la dignité de leurs êtres et de leurs cultures. Les decorated tenements* en étaient l’incarnation, et bien plus.
Une lecture essentielle.
* En lisant ce livre, j’ai appris qu’il y avait un film, *batteries not included, datant de 1987 et produit par nul autre que Steven Spielberg qui se déroule autour d’un tenement building dans le East Village à Manhattan. Pas encore vue, mais toujours disponible sur Apple+, lorsque l’occasion se présentera!