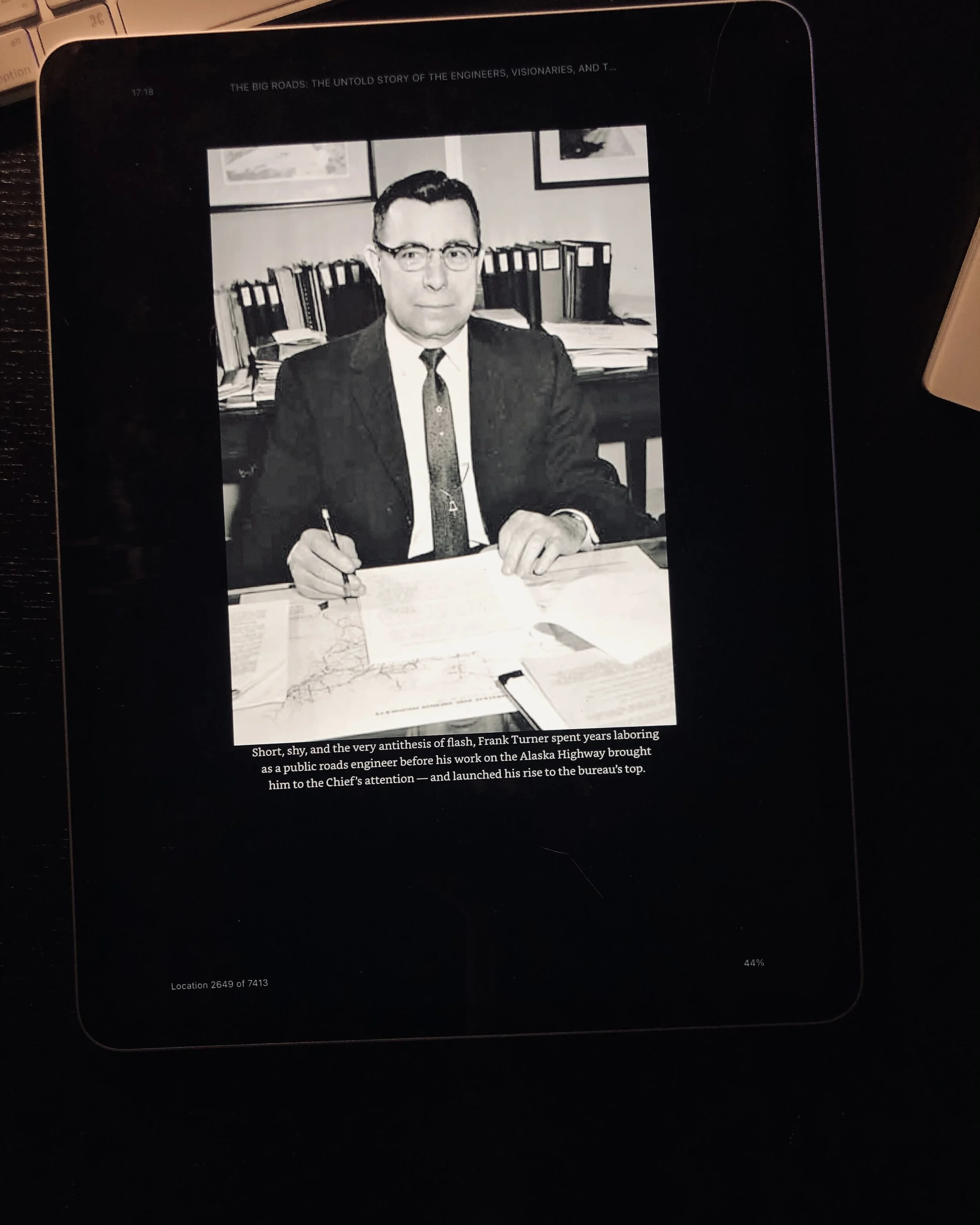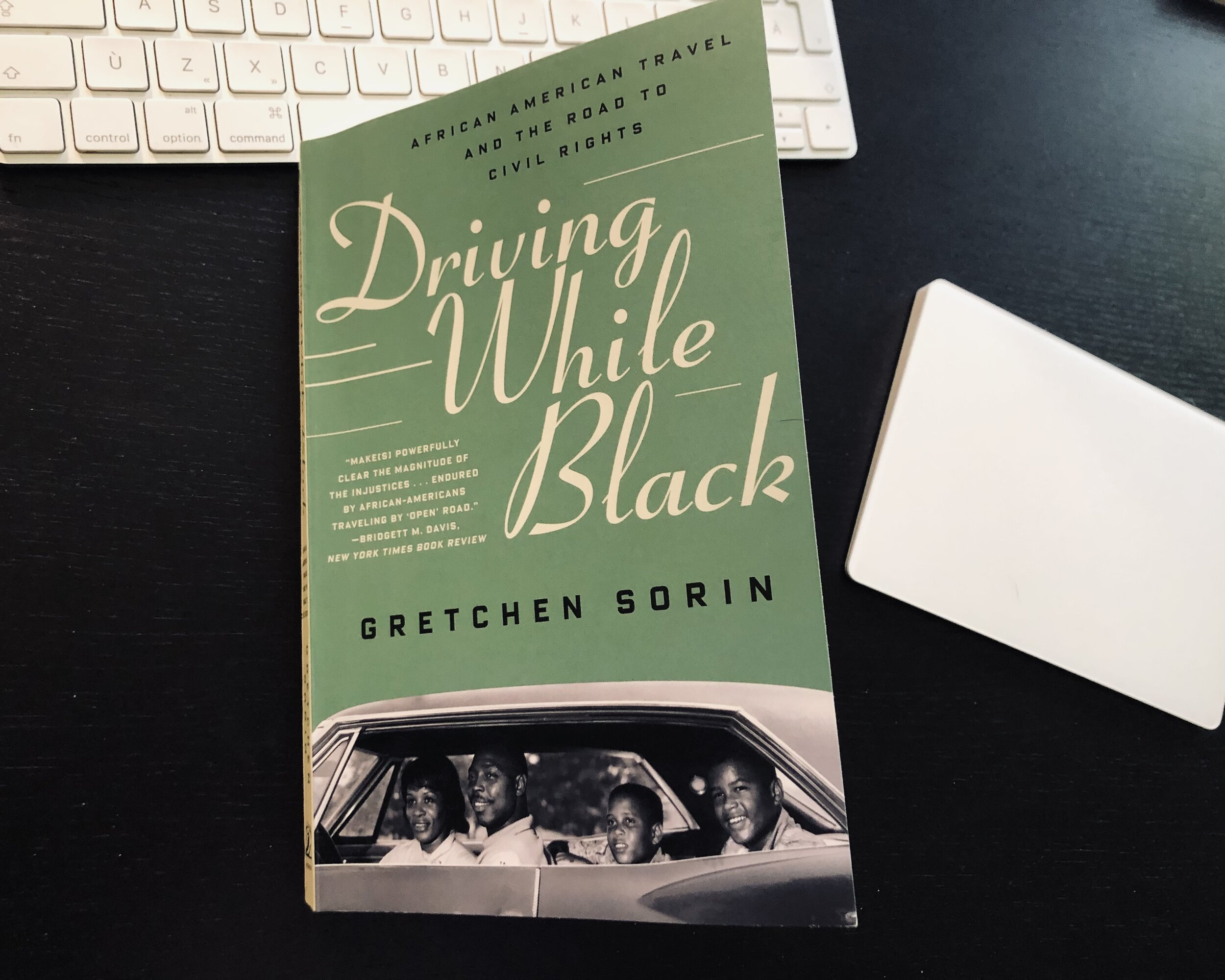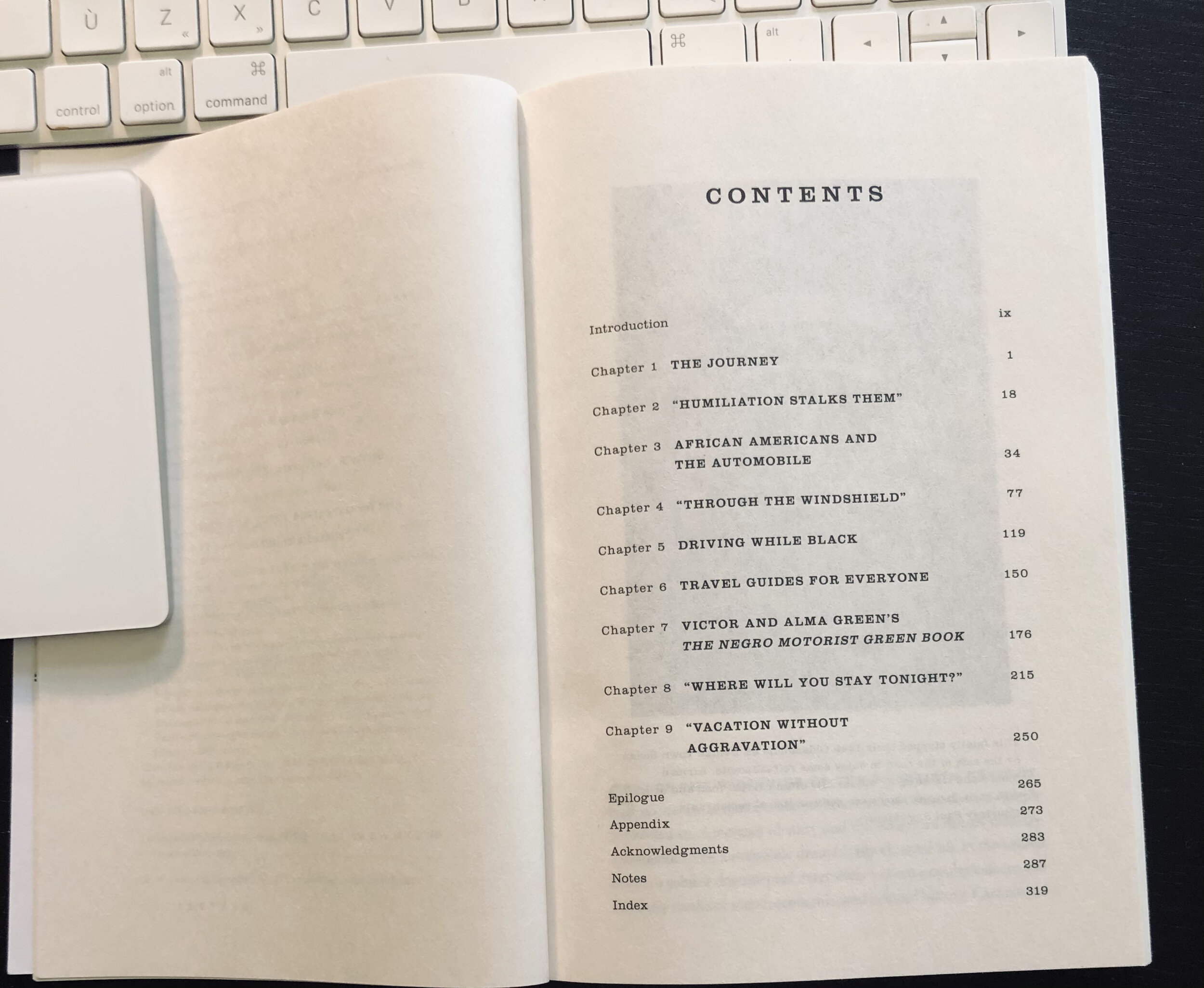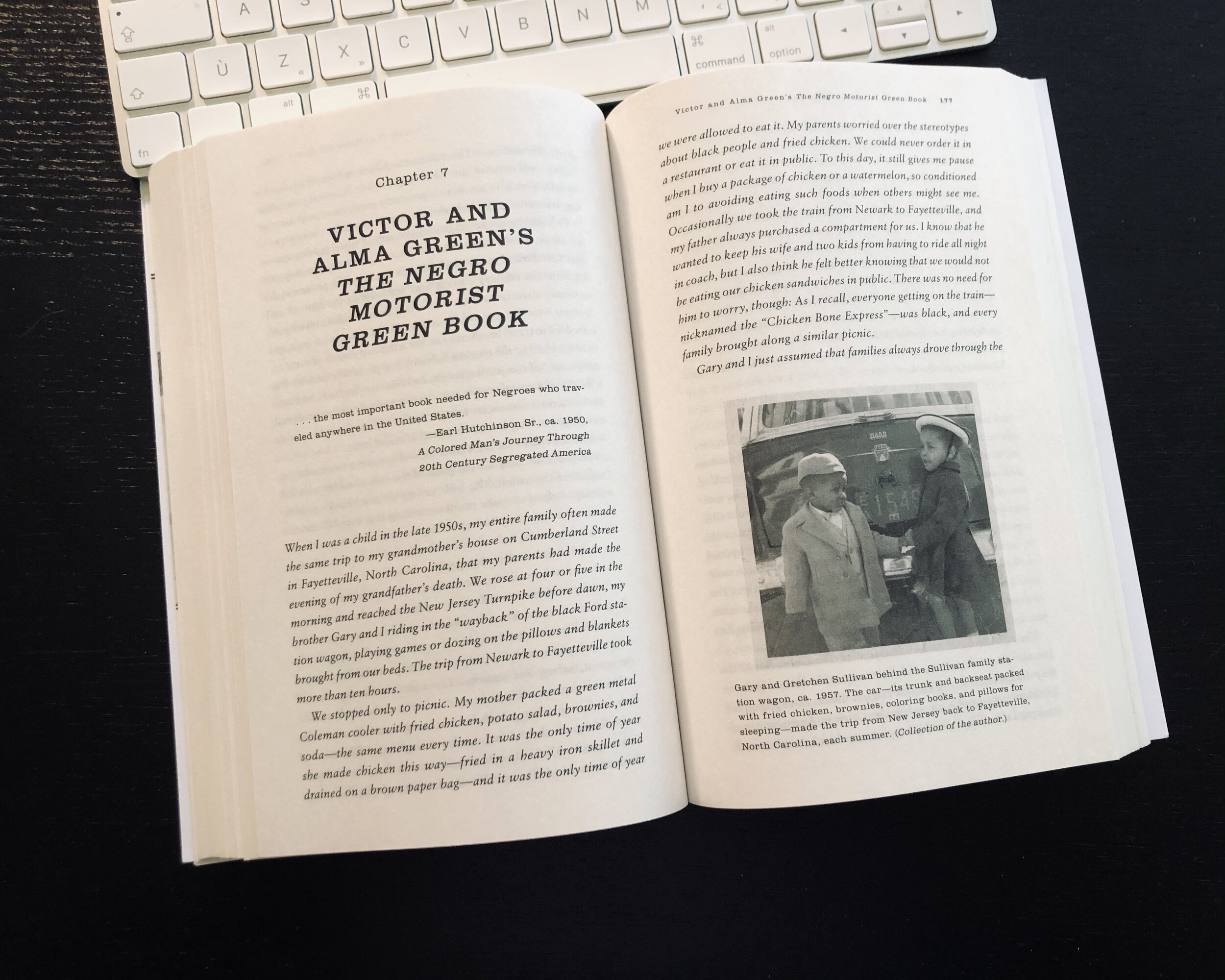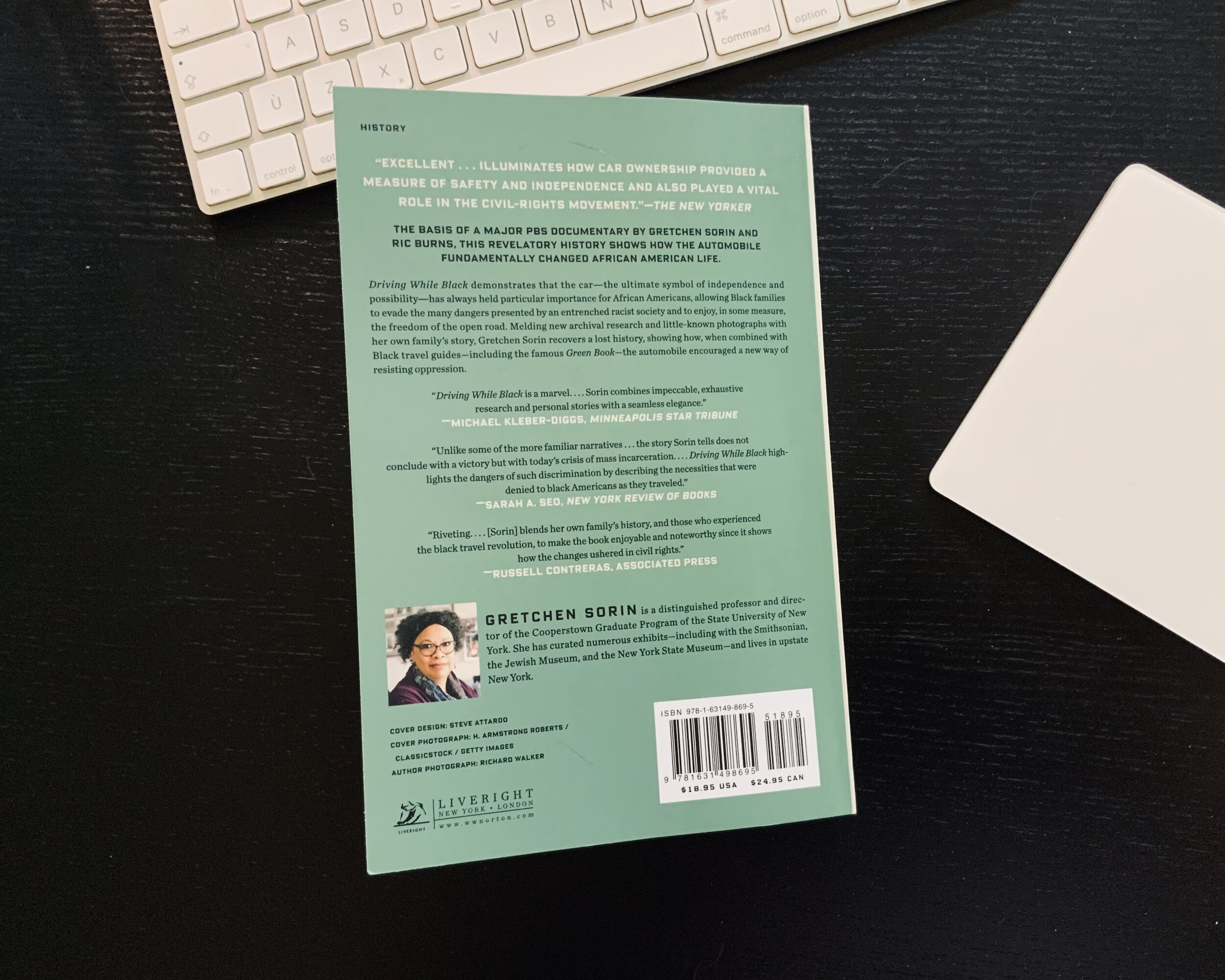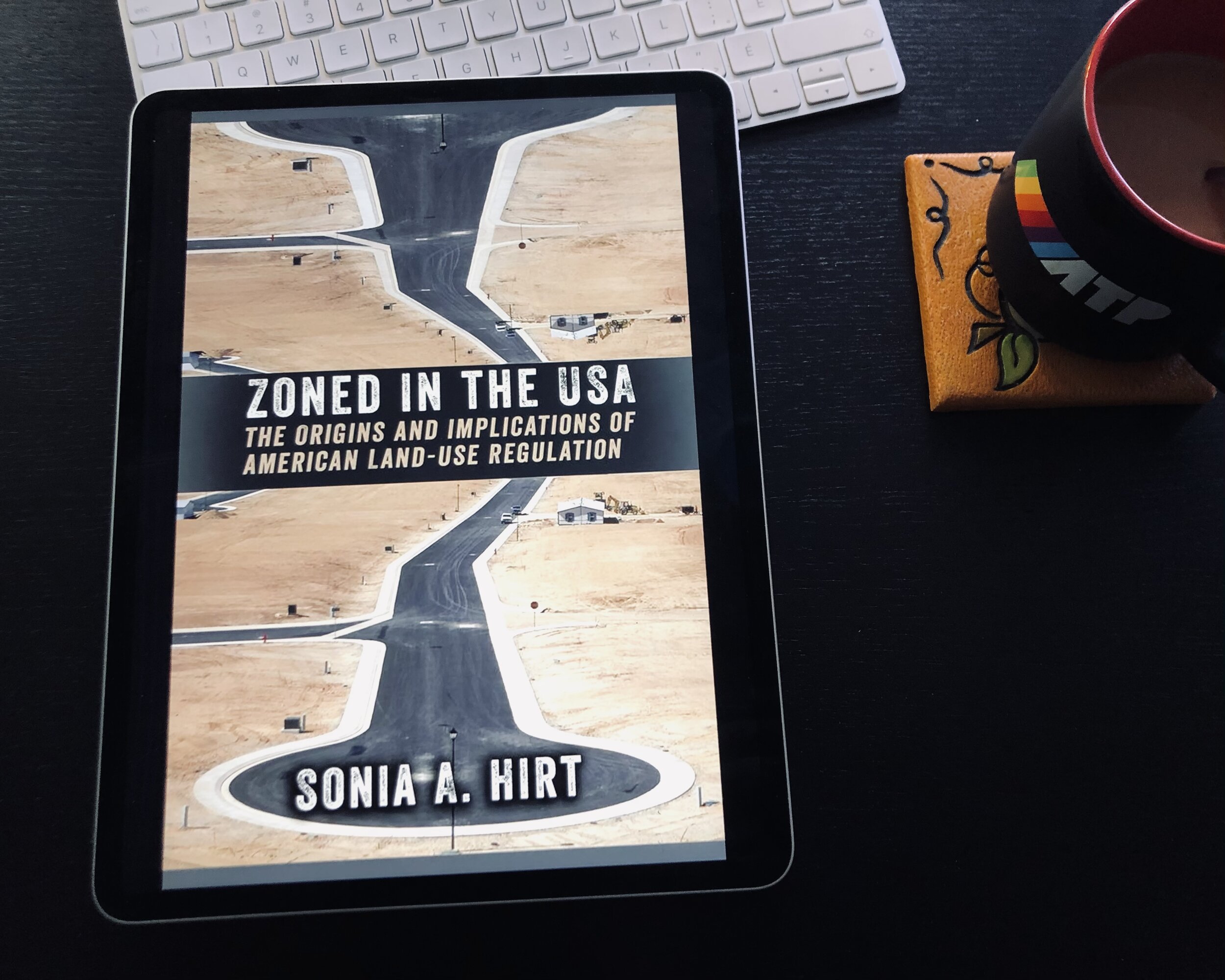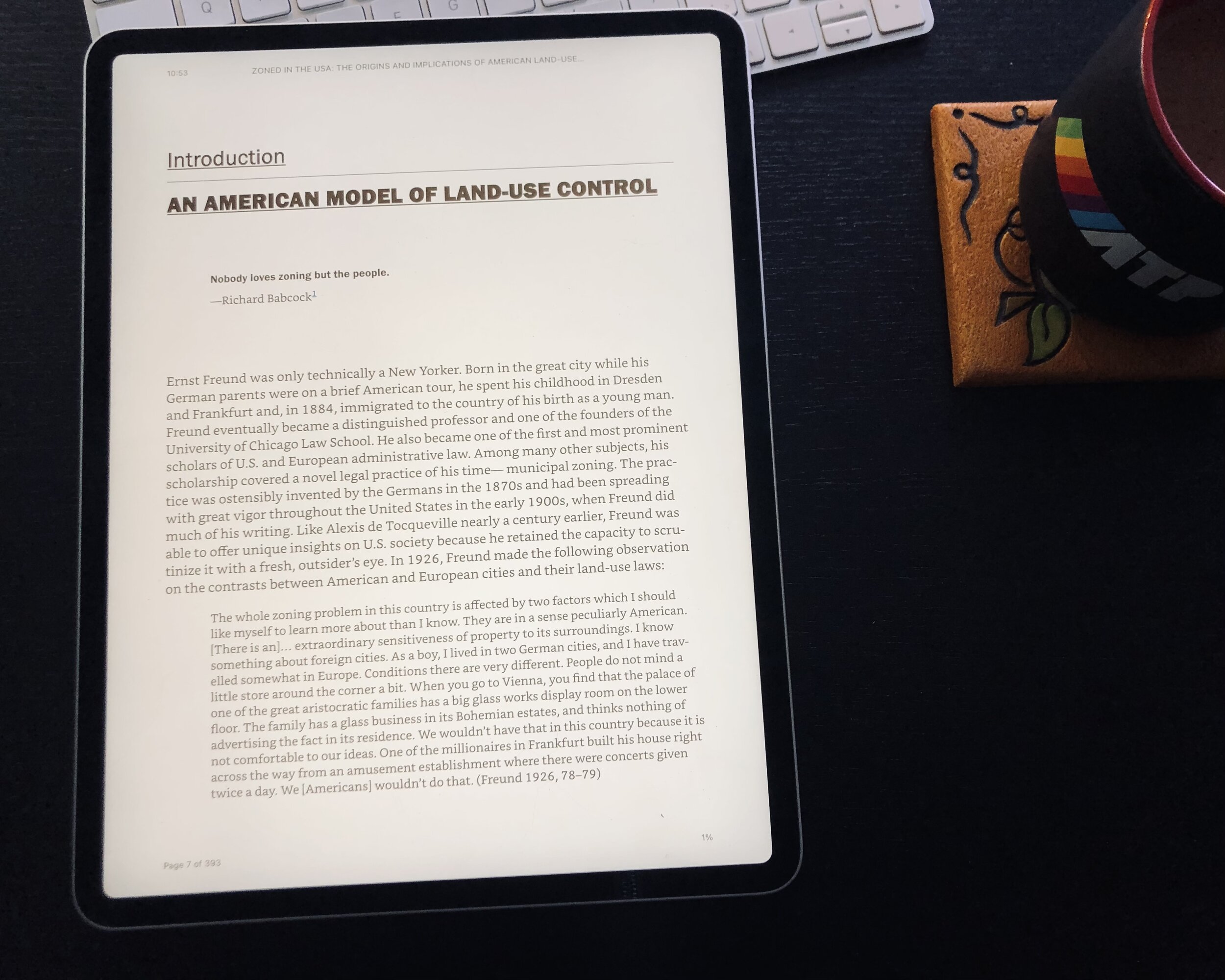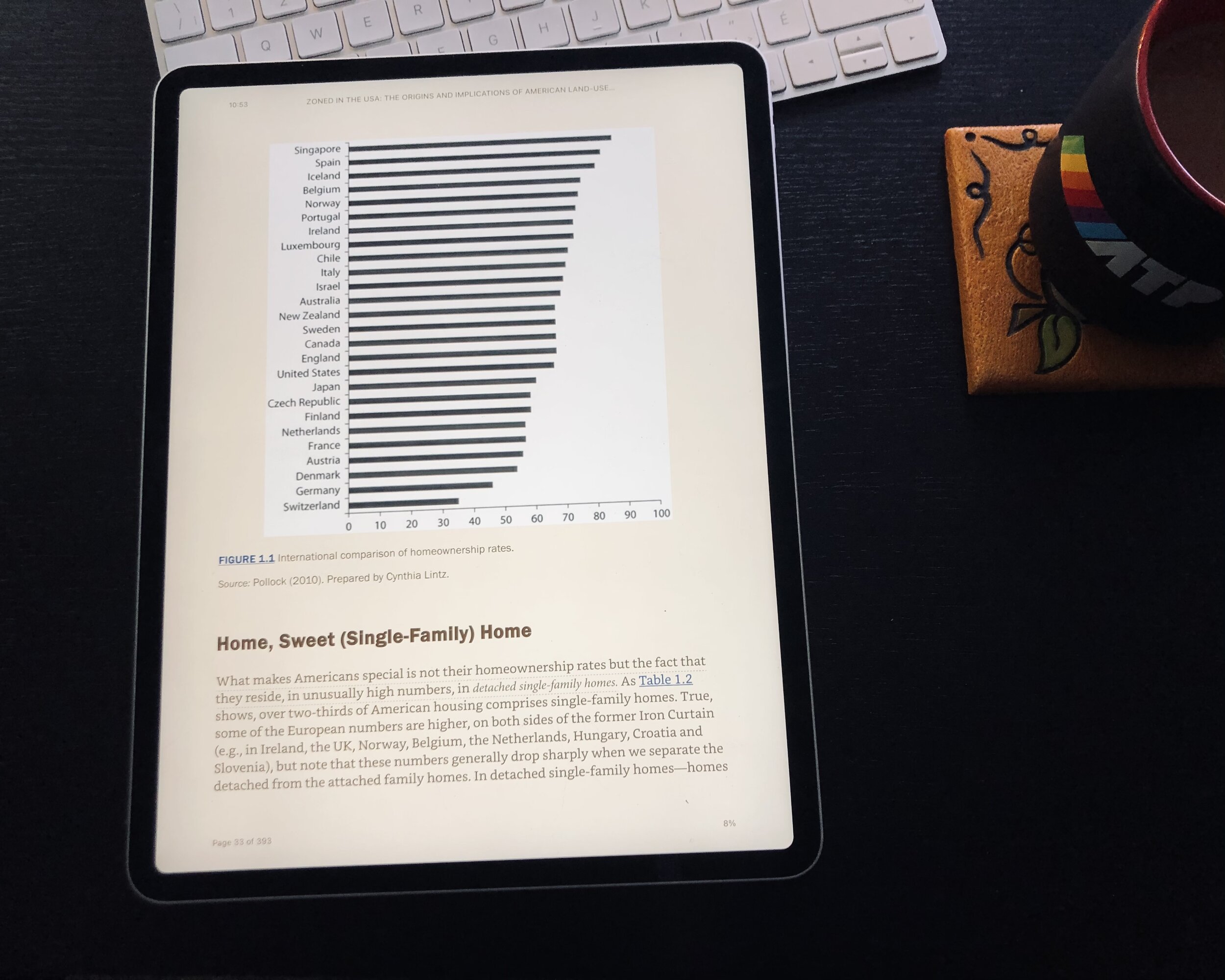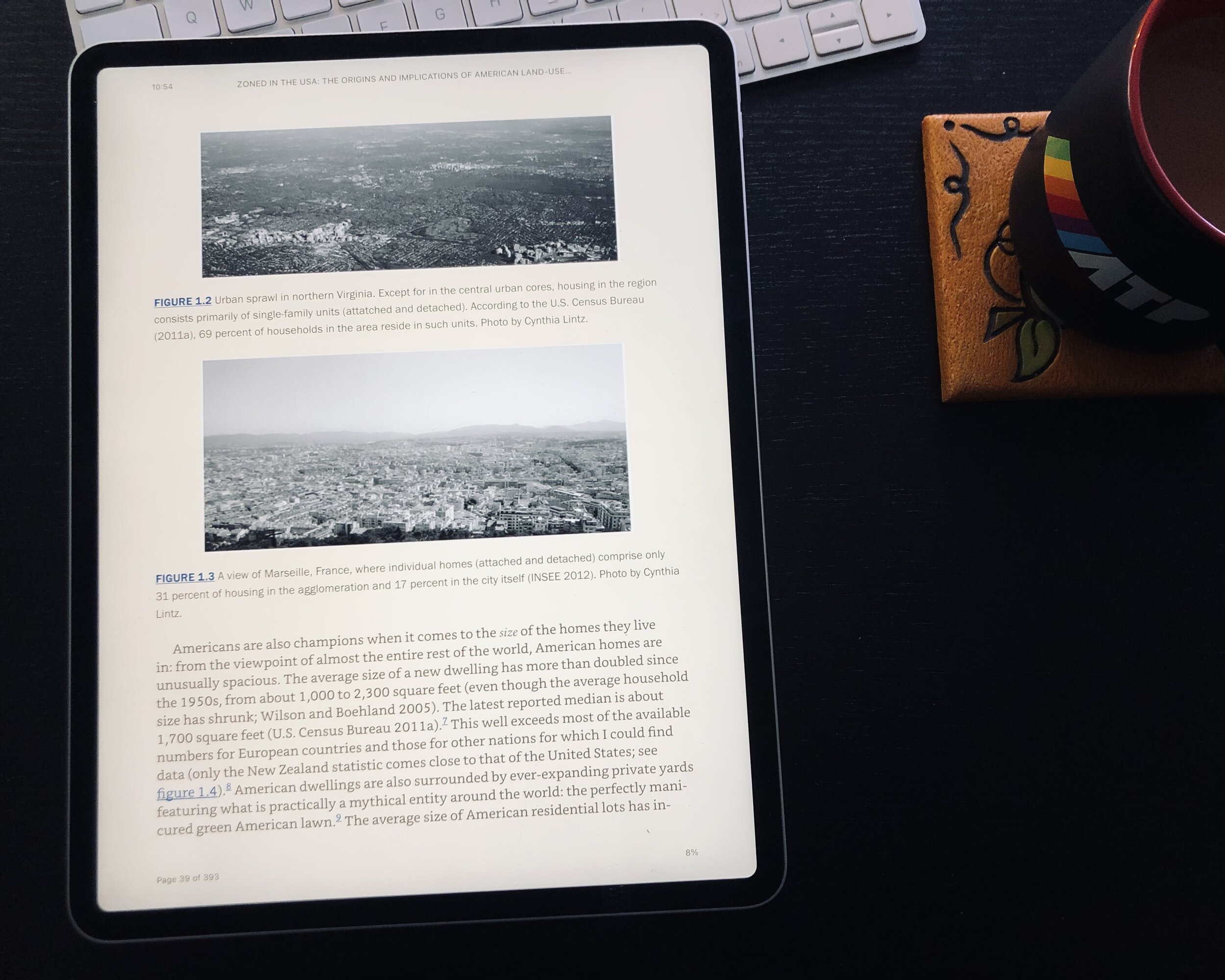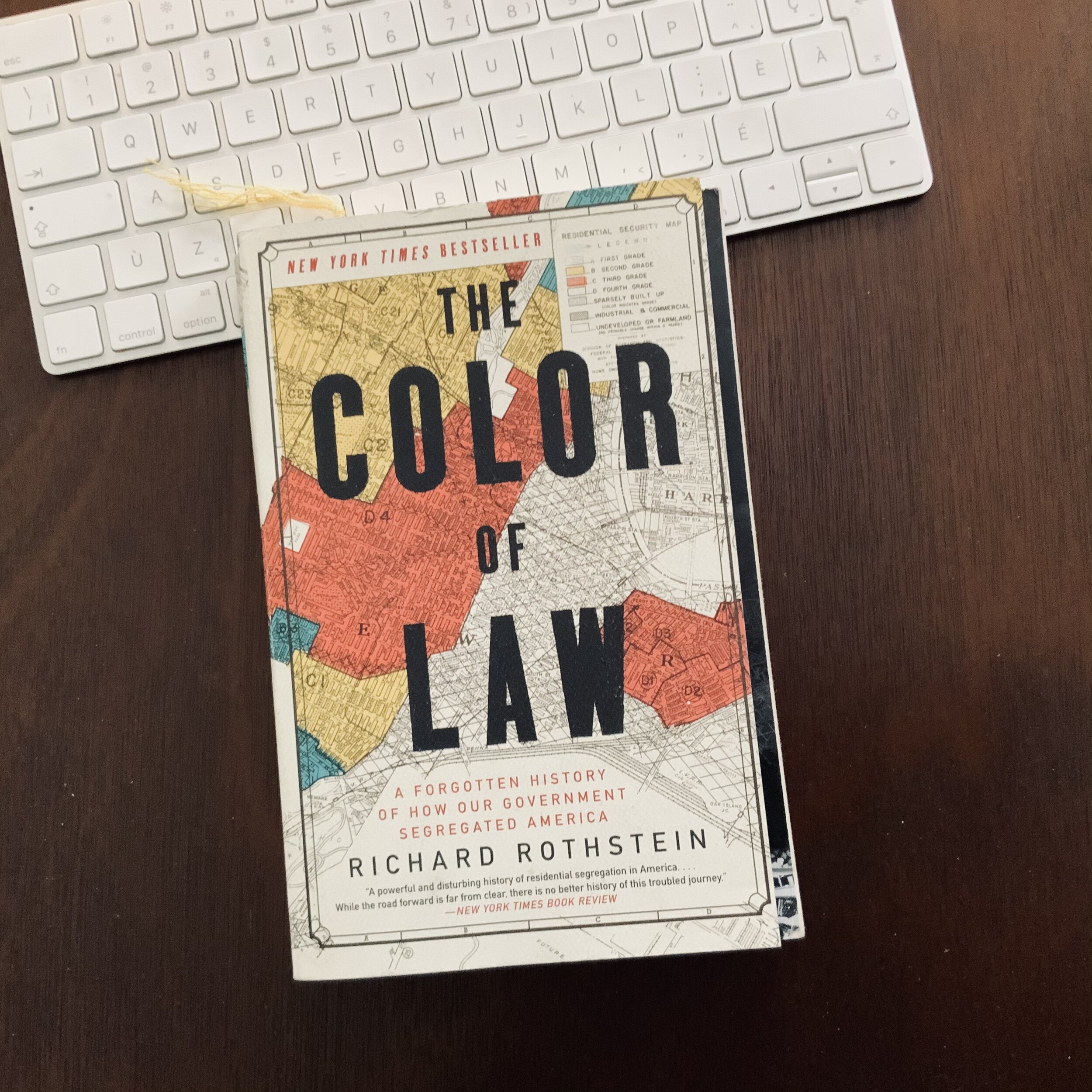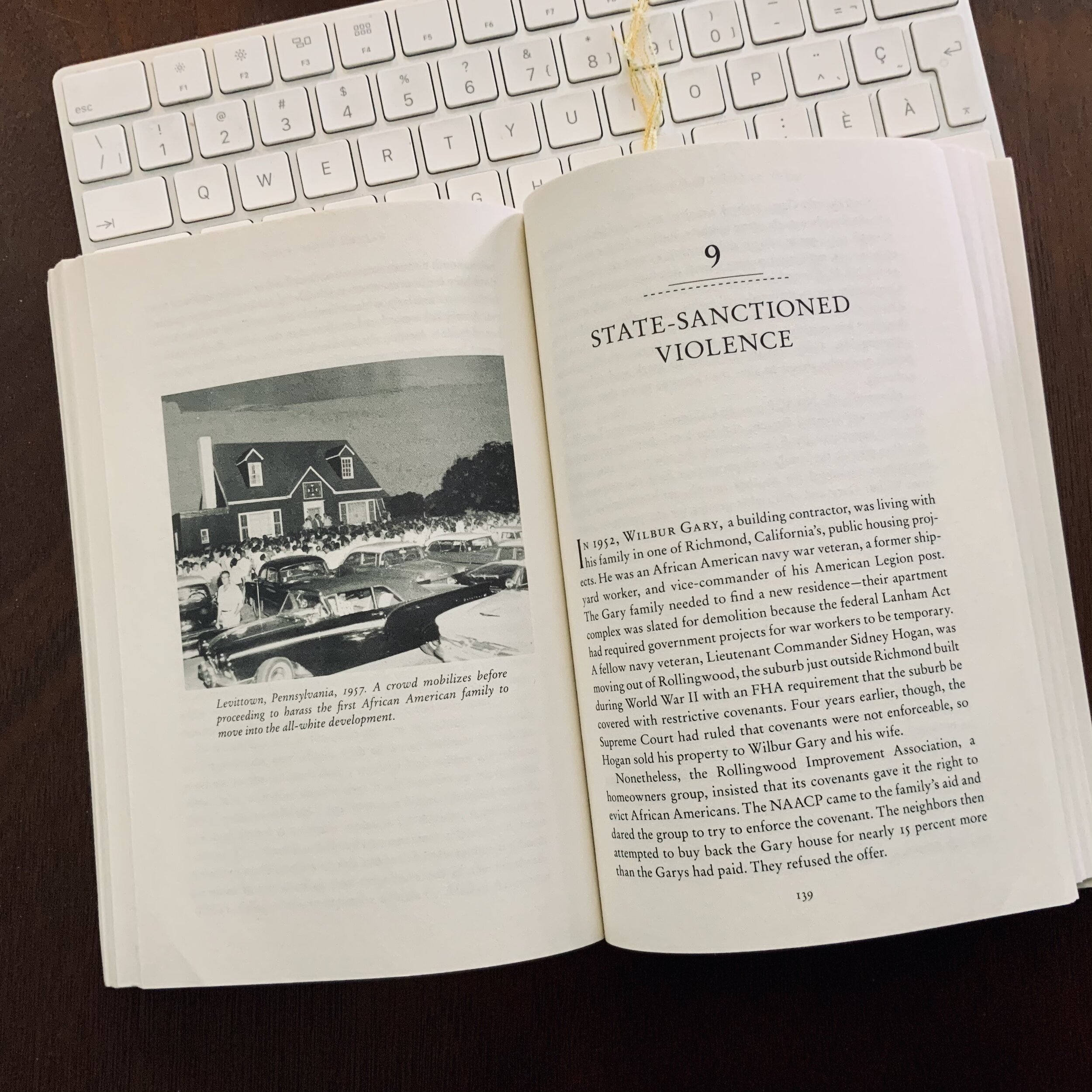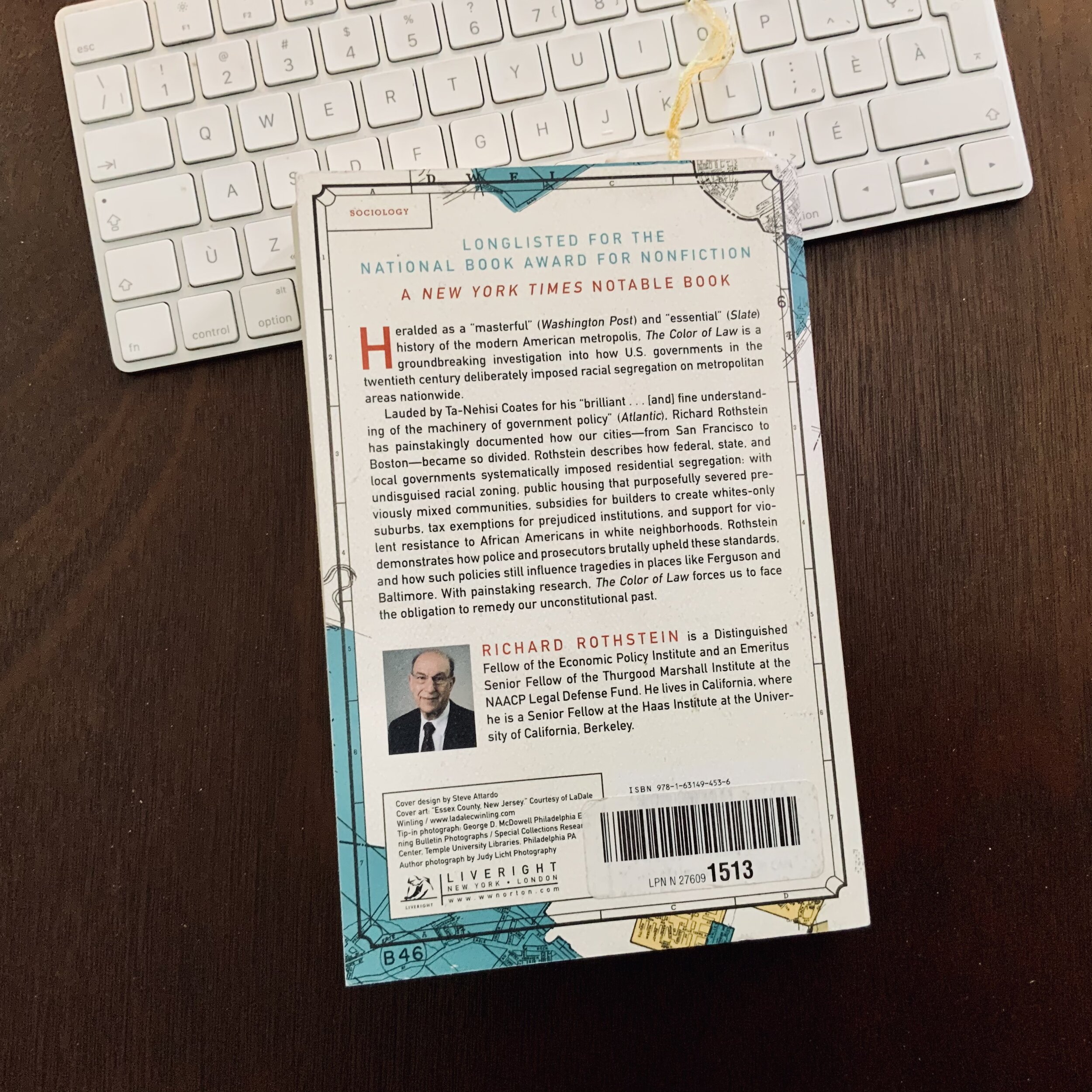The Big Roads—The Untold Story of the Engineers, Vionaries, and Trailblazers who Created the American Superhighways. Earl Swift, Houghton Mifflin Harcourt, 2011, 400 pages. [lu en version ebook sur Kindle]
Avant que le public soit épris de leurs voitures, il était épris de ses vélos, alors il ne faudrait pas être trop choqué d’apprendre que les premiers initiateurs du mouvement pour l’amélioration des routes ont été les propriétaires et marchands de vélos. Mais comme on peut l’imaginer, ils ont bien vite été rattrapés, en nombre et en ferveur, par les aventuriers des premières automobiles. On parle ici du temps, au début du siècle dernier, où les rues des villes n’étaient pas toutes pavées, ou celles qui l’étaient se voyaient envahies par la multitude, et où du moment que l’on voulait s’aventurer à l’extérieur de ladite ville, le chemin de terre (à peine) battue se présentait comme seule voie. Si cette situation était pour changer, qui allait planifier, coordonner et surtout, payer pour la construction de ce nouveau réseau public à l’échelle nationale ?
C’est dans ce livre que nous allons découvrir l’histoire de ce groupe hétéroclite, qui sur une période de plus de 60 ans, va planifier, concevoir et systématiser ce qui était alors l’infrastructure principale des échanges commerciaux et déplacements privés. Lors de la mise en place des « highways », il y eut partout des choix déchirants dans les tracés : les villes qui n’étaient pas incluses allaient péricliter. Lorsque ce réseau devint désuet et surchargé, manifeste avant même le début de la Deuxième Guerre, c’est le président Roosevelt, en 1938, qui donne l’impulsion pour concevoir le système des « interstates ». Mais c’est seulement en 1956 qu’un autre président, Eisenhower, signe la législation pour financer leurs constructions.
Le vrai « blind spot » de ce réseau fut évidemment l’interface avec les villes et agglomérations existantes ; la dévastation causée par ces intrusions est un lègue universel des « interstates » et autres autoroutes. Le tiers de l’ouvrage, dans un chapitre intitulé « The Human Obstacle », est consacré à contextualiser les villes, les personnages et les luttes (parfois victorieuses, mais le plus souvent de type Pyrrhus) des citoyens pour leurs quartiers urbains. En ce sens, l’auteur nous présente ici une histoire de ce réseau supérieur vraiment méconnue et bien équilibrée afin de mieux alimenter et mûrir la réflexion sur notre situation présente et future.
Sur les traces de The Big Roads
Je ne peux malheureusement pas me souvenir de ma source pour l’ouvrage, mais j’ai retrouvé cette entrevue très informative avec l’auteur. J’ai aussi constaté qu’il avait depuis écrit un autre livre, qui reste dans les mêmes teintes, mais à une échelle plutôt, si l’on compare à l’autre, atomique: Auto Biography—A Classic Car, an Outlaw Motorhead, and 57 Years of the American Dream. On peut en apprendre plus grâce à cette entrevue.
Le livre ne comporte aucune bibliographie, mais des notes assez copieuses, et dans l’édition électronique que j’ai lu, elles sont sans véritable lien dans le texte. Mais voici donc quelques généralités que je me réserve le droit d’étoffer lors d’un prochain passage.
C’est en lisant ce livre que j’ai découvert à quel point Lewis Mumford avait été prophétique et éloquent dans ses essais, parus dans les magazines de l’époque, sur le sujet des interfaces autoroutes/villes. C’était aussi le cas de ses textes sur le phénomène automobile et les accommodations sans contraintes qui leur sont assurées en milieux urbains. Je le paraphrase en disant que le droit de l’automobile d’aller partout en ville équivaut au droit de détruire la ville. Je vais certainement tenter de retrouver et lire ses textes de cette période.
Quand on parle d’autoroutes et de leurs effets sur la ville, je me sens presque contractuellement obligé de mentionner Robert Moses et la biographie que lui a consacré Robert A. Caro : The Power Broker—Robert Moses and the Fall of New York. Il y a un chapitre, 37. One mile, particulièrement dévastateur pour comprendre la brutalité de ces incursions et toute l’urbanité irrémédiablement disparue à la suite de ces opérations. Robert Moses, durant ses 40 ans de pouvoir, est responsable pour 627 de ces miles, dans la ville et ses environs.
En dernier lieu, j’ai fait la découverte d’un livre d’E. B. White (oui, lui) dont je ne connaissais absolument pas l’existence : Farewell to Model T/From Sea to Shining Sea. Deux essais écrits dans les années 1930 pour le New Yorker et évoquant les routes des années 1920, à bord d’un Model T. Probablement une lecture pour de prochaines escapades sur les « highways ».