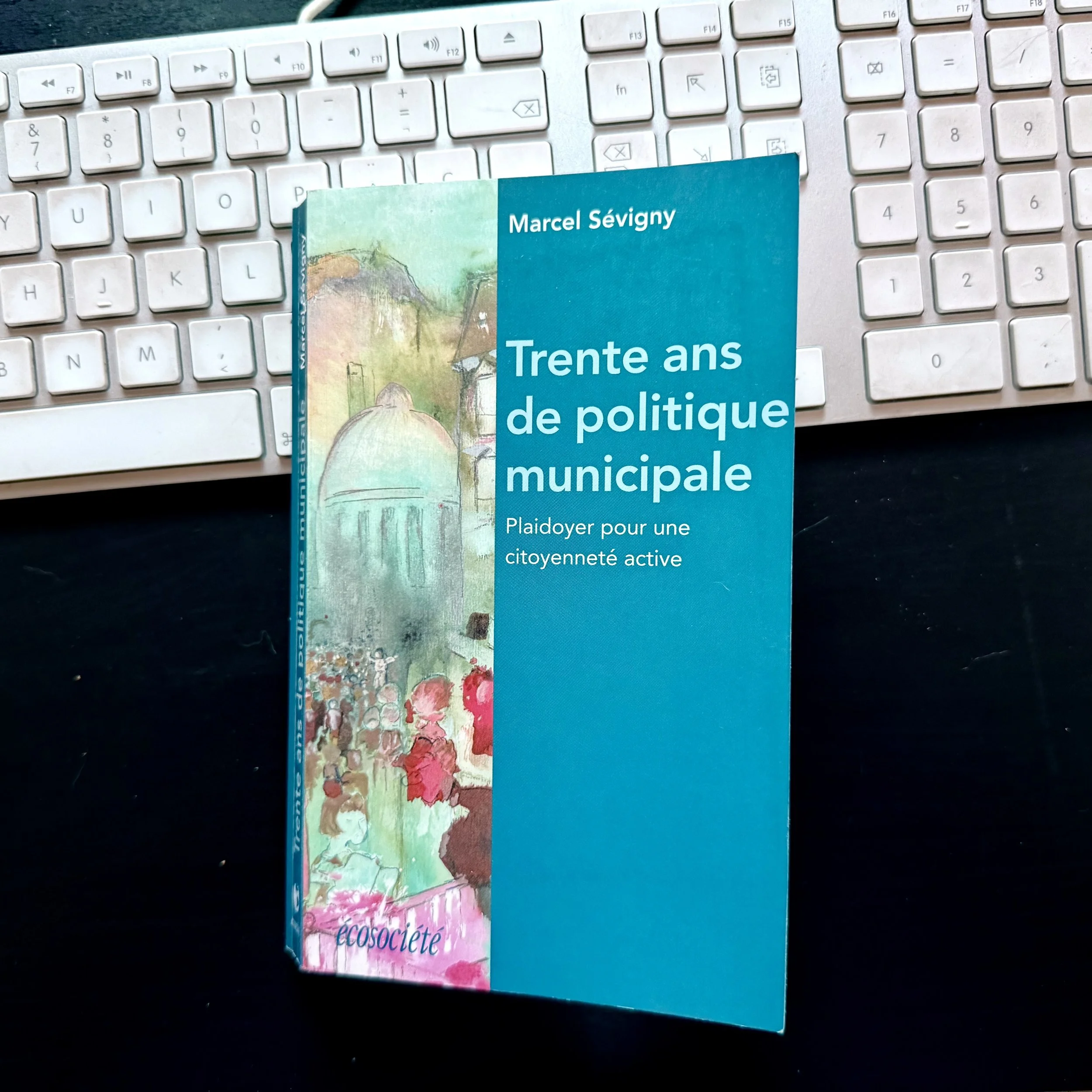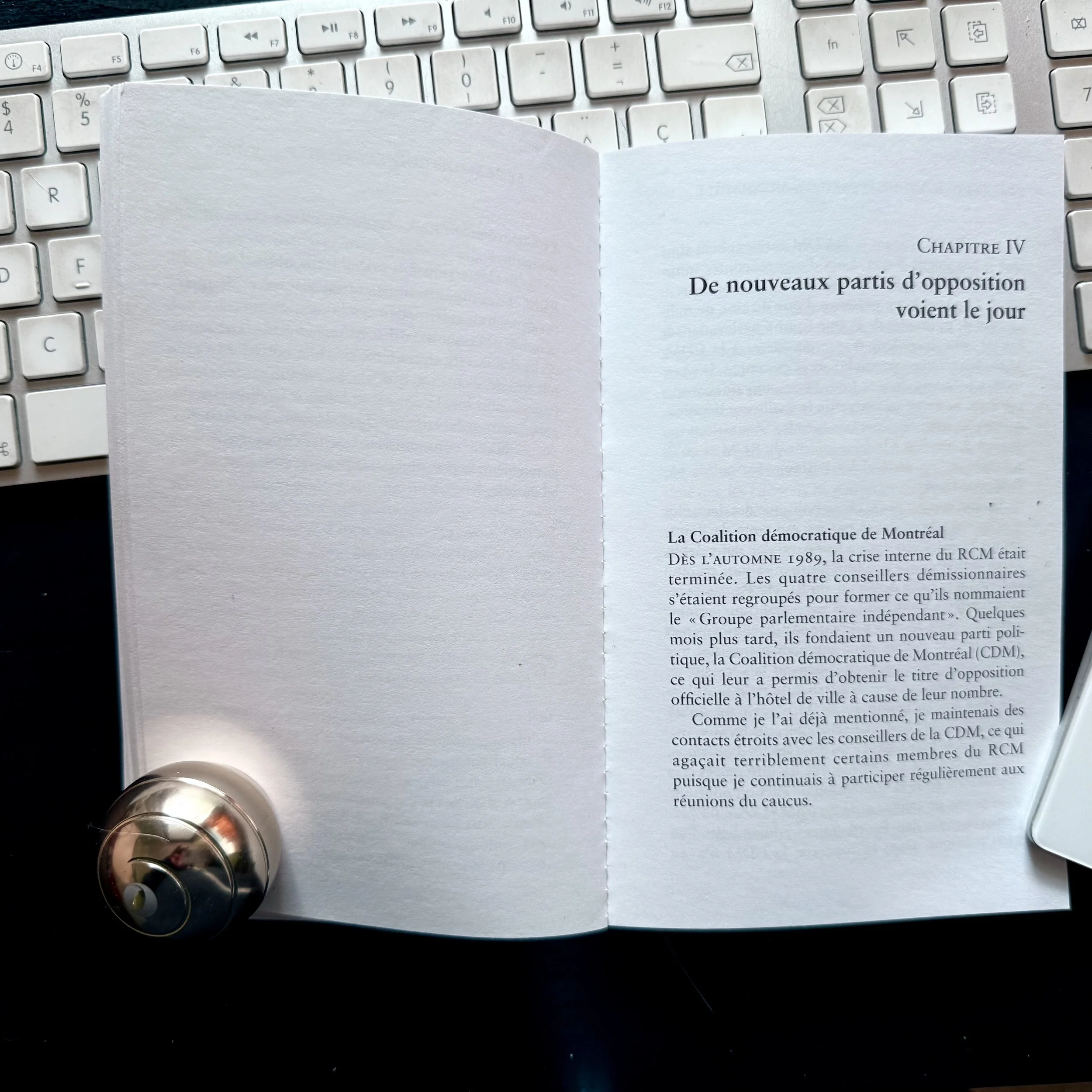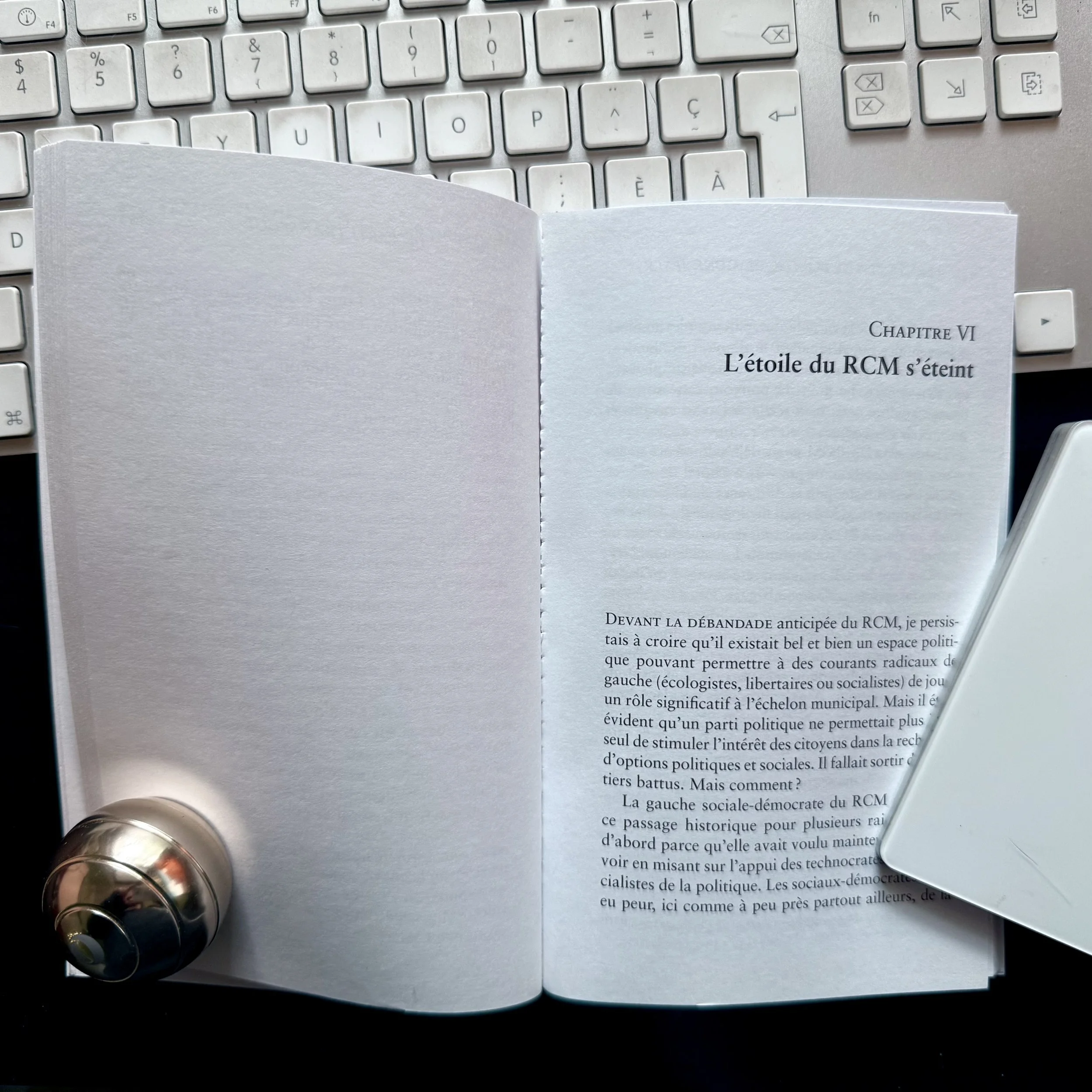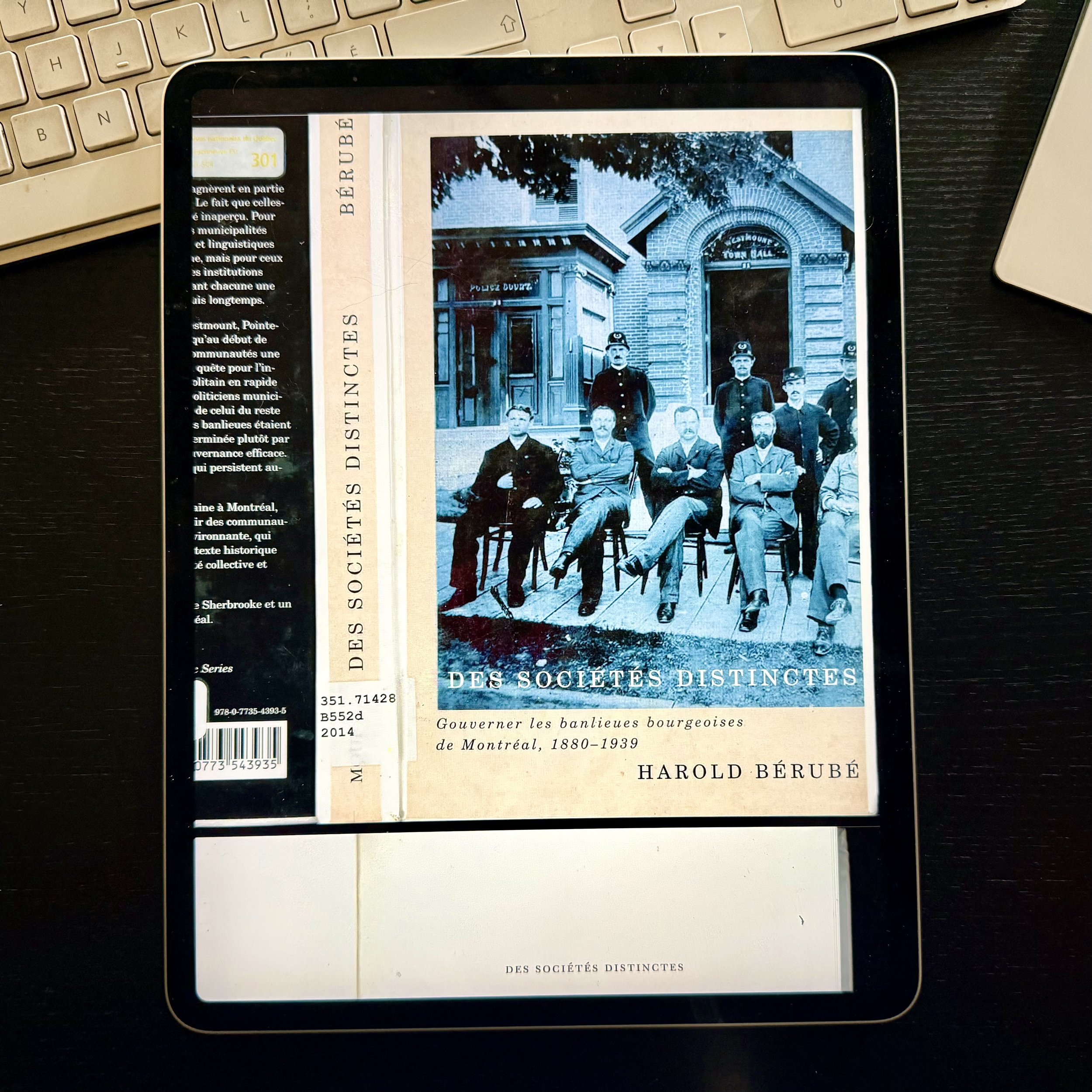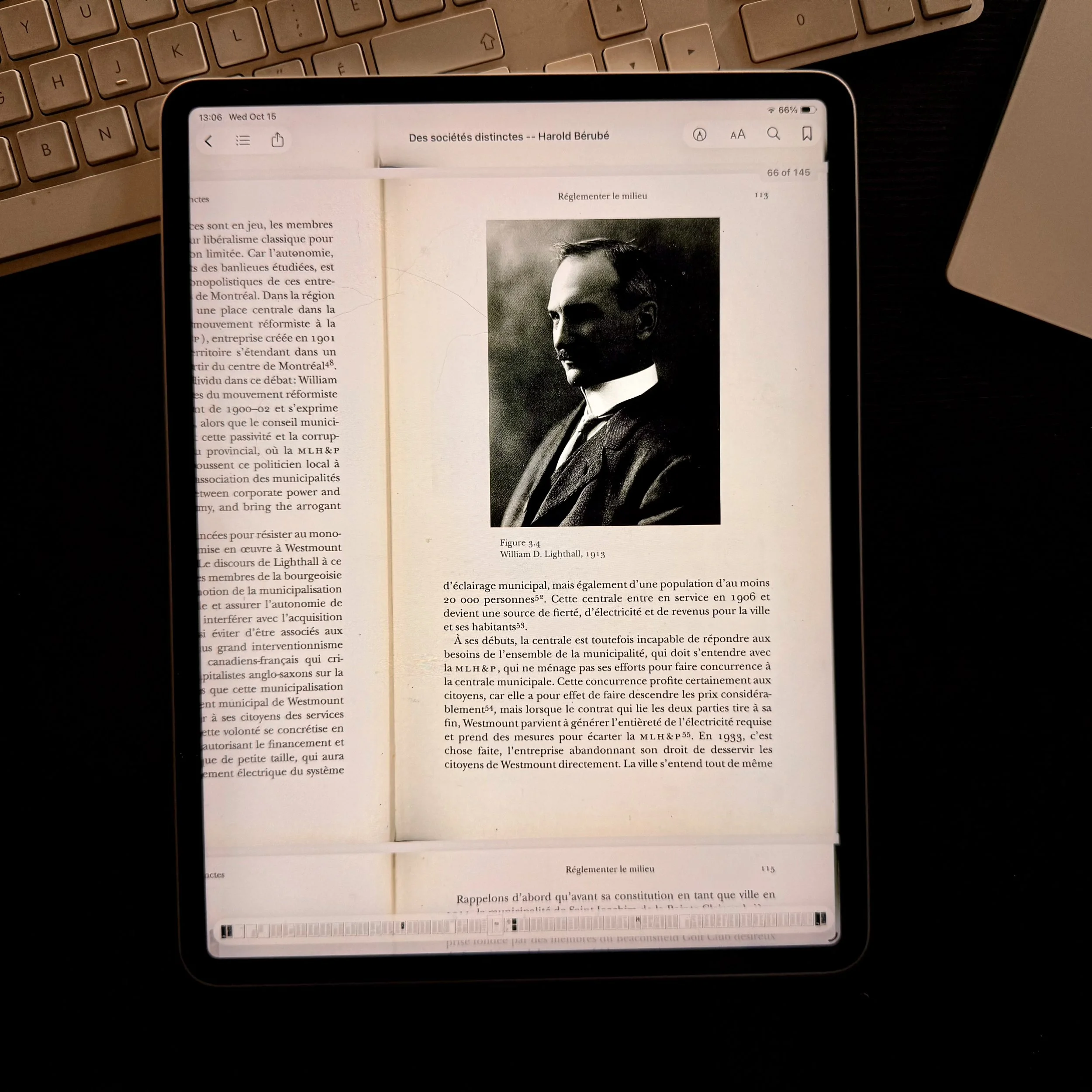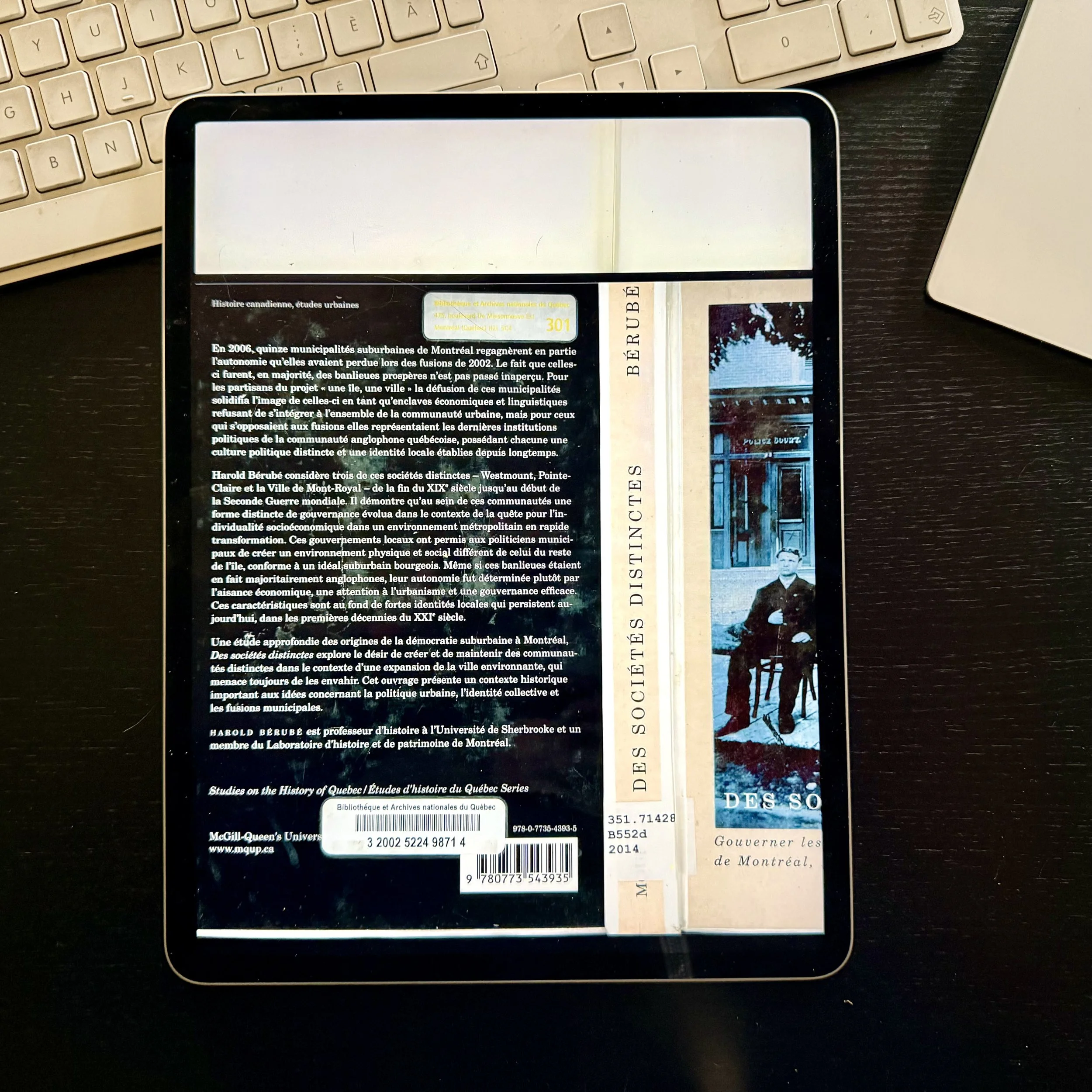Combattre la gentrification—Témoignai d’une ex-conseillère municipale. Sophie Thiébaut, M éditeur, 2025, 254 page.
Série Élections municipales 2025
Il y a en moi un léger conflit en abordant cet ouvrage à ce moment précis, juste avant les élections de dimanche. Je me rappelle qu’au moment de lire ce livre (mes notes me renvoient au mois de juillet), j’avais été presque choqué par la terrible expérience que la politique municipale lui avait fait vivre et du coup affligé de constater qu’elle en avait pris pour douze ans en tant qu’élue. Ce qui rend encore plus perplexe est que cette expérience avait été, en grande partie, non pas le résultat d’une opposition de forces résolues à faire barrière à ses politiques, mais plutôt de la part de personnes qui étaient nominalement ses alliées, des membres élus de son parti ou encore pire, de la part d’une bureaucratie réfractaire.
Madame Sophie Thiébaut fut élue comme une des deux conseillères de l’arrondissement du Sud-Ouest (qui inclut les quartiers de Ville-Émard, Côte-Saint-Paul, Saint-Henri, Petite-Bourgogne, Griffintown et Pointe-Saint-Charles) pour trois mandats de 4 ans, de 2009 à 2021, pour un total de 12 ans, sous la bannière de Projet Montréal. Mis à part son premier mandat, son parti contrôlait le conseil d’arrondissement, et durant son dernier mandat (2017-21), était également au pouvoir à l’hôtel de ville de Montréal.
Durant cette même période, Projet Montréal, fondé dans presque le même sciage et regroupant plus ou moins la même coalition que le Rassemblement des citoyens de Montréal (RCM), est passé sous le contrôle de son fondateur, Richard Bergeron, au chef intérimaire que fut Luc Ferrandez et finalement celle qui remporta la mairie pour le parti, Valérie Plante. À la veille des élections de dimanche, Projet Montréal est sous la direction de Luc Rabouin, l’ex-bras droit de la mairesse et maire de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Tout ça pour souligner à quel point Projet Montréal a connu plusieurs styles de direction et que cela pouvait difficilement faire autrement que de laisser des traces, pas toujours agréable, pour ceux qui ne se trouvaient pas du côté de la « clique » victorieuse.
Considérant le niveau de contrôle du parti sur toutes les instances municipales de Montréal (ville centre et arrondissements), cela donnait théoriquement beaucoup de pouvoir à qui voulait bien s’en servir à bon escient. Mais s’il faut en croire le récit que madame Thiébaut ici, on doit voir cette période comme celle d’un parti qui a trahi ses engagements et ses principes et du coup, ses militants et les personnes engagés, comme elle.
SANS EN FAIRE STRICTEMENT L’HISTOIRE d’une machination orchestrée par un parti (Projet Montréal) qui, d’un côté, une fois au pouvoir, se laisse capturer par la pensée magique règlementaire (incarné dans le désastre qu’est le Règlement pour une métropole mixte) et, de l’autre, des élus qui finissent, ironiquement, par se faire eux-mêmes capturer par le jeu des faveurs, autant de l’intérieur de la machine (contre des positions sur différentes commissions ou conseils) qu’envers certains commettants qui en déplace. C’est comme s’ils oubliaient qu’ils doivent leurs postes aux électeurs. Mais le doivent-ils vraiment? Quand on sait qu’au dernier scrutin municipal, à peine 38,32 % des électeurs s’étaient prononcés.
Toujours est-il que madame Thiébaut s’est très vite trouvée seule à défendre ce qu’elle croyait être le programme de son parti. Mais les autres membres de son équipe, et à premier titre le maire de l’arrondissement, ne semblaient pas vouloir emprunter le chemin qui devait conduire, selon elle, à la réalisation de leurs programmes. Encore plus injurieux, l’équipe du maire (ceci est en partie mon interprétation) semble avoir transmis, dans plusieurs dossiers, son mépris par rapport à la posture de l’élue. Des comportements hors du cadre professionnel, de la part de certains fonctionnaires (entre autres des urbanistes) en résultat. En fait, on peut donner cet ouvrage à toute personne qui aurait des questions sur comment il est facile de se retrouver isolé à l’intérieur d’une organisation dont on croyait partager les objectifs globaux. Plusieurs chemins peuvent être empruntés pour les atteindre, et c’est souvent en divergeant dans ceux-ci qu’on finit par se perdre.
Il n’empêche, pour recentrer sur ce qui se veut le fond nominal de l’ouvrage (Combattre la gentrification), les difficultés en logements sont clairement à la racine des enjeux municipaux de l’heure. Mais c’était aussi le cas lors des élections de 2009, de 2013, de 2017, de 2021 et c’est le cas maintenant, en 2025. Une période de 15 ans. Les solutions proposées par Projet Montréal ont même jadis raisonné. Mais, confronté au réel, les élus du parti, Valérie Plante en tête, se sont tourné vers des lubies bureaucratiques (règlementaire), pensant pouvoir ainsi n’investir rien en retour de quelque chose. Dans les faits, il faut municipaliser la solution (du logement) et se (re)mettre à bâtir!
Pourtant, à trois jours du vote, aucun parti n’offre cette option, dont l’efficacité est universelle et démontrée. Le bon temps pour s’engager sur ce chemin était hier, le meilleur temps est demain; à quand demain?